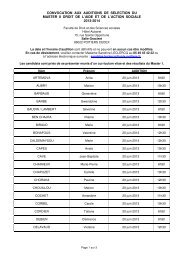Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales
Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales
Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
caché (333) ". Ripert n'est ni l'un, ni l'autre. Il est positiviste pour condamner les<br />
thèses jusnaturalistes mais il abhorre par dessus tout les anticléricaux. Il est<br />
antipositiviste pour s'opposer aux législations du travail (334) . Nous<br />
conviendrons que le terme le plus adéquat pour désigner la philosophie de<br />
Ripert est celui de "pseudo-positivisme (335) ", car il a donné à sa conception de<br />
l'ordre juridique une assise contradictoire. "Le véritable progrès du droit<br />
consiste à régler l’organisation de la société de telle façon que chaque homme<br />
puisse vivre <strong>et</strong> agir avec sécurité, en étant obligé de reconnaître ce qu’il doit<br />
aux autres, mais en pouvant exiger aussi l’accomplissement de ce qu’ils lui<br />
doivent. Rendre à chacun le sien (336) ". C'est une tentative de conciliation des<br />
perspectives naturaliste <strong>et</strong> positiviste réservant sa part à la Morale, pour que<br />
suum cuique tribuere soit un gage de sécurité (337) .<br />
60. Le "pseudo-positivisme" de Ripert - "On opposait autrefois la doctrine <strong>et</strong> la<br />
jurisprudence parce que les hommes de la science pure paraissaient maintenir<br />
plus strictement le sens réel des lois que les juges enclins à en adoucir<br />
l'application suivant les circonstances. Les temps ont changé. Ce sont<br />
maintenant les juristes qui réclament “ la libre recherche scientifique ” (338) ".<br />
(333)<br />
M. TROPER, "Le positivisme juridique", Rev. de synthèse 1985, n°118-119, p.198 note (27).<br />
(334)<br />
G. RIPERT, Le régime démocratique <strong>et</strong> le droit civil moderne, précité, p.68 s. sur "la protection des<br />
faibles".<br />
(335)<br />
M. TROPER, "La doctrine <strong>et</strong> le positivisme", in D. LOCHAK (dir.), Les usages sociaux du droit, Paris,<br />
CURAPP—PUF, 1989, p.291 : "La doctrine ne doit décrire les valeurs qui justifient les normes positives <strong>et</strong> en<br />
général la ratio legis que si elle entend exprimer des normes, qui régissent des situations non prévues par le<br />
législateur. Mais on ne doit pas oublier ce truisme que le droit positif, c'est seulement le droit posé. Les<br />
normes que la doctrine prétend exprimer relèvent au contraire du droit non posé. En réalité, lorsqu'elle est<br />
ainsi conçue <strong>et</strong> pratiquée, elle ne sert qu'à produire des arguments visant à persuader un juge. Elle n'est pas un<br />
véritable métalangage <strong>et</strong> les juristes qui la pratiquent agissent en réalité de sentencia ferenda. Ils ne sont en<br />
réalité que des pseudo-positivistes" ; v. J.-L. HALPERIN, Histoire du droit privé français, précité, p.204 ;<br />
comp. A. ROSS : Le pseudo-positivisme de Kelsen, in C. GRZEGORCZYK, F. MICHAUT <strong>et</strong> M. TROPER (dir.), Le<br />
positivisme juridique, Paris, LGDJ, Story scientia, 1992, p.204.<br />
(336)<br />
G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, 2ème éd., 1955, précité, p.67 ; adde J. BOULANGER, "Notations<br />
sur le pouvoir créateur de la jurisprudence civile", RTD civ. 1961, p.423.<br />
(337)<br />
Kelsen soulignait justement c<strong>et</strong>te confusion entr<strong>et</strong>enue par la doctrine : "La théorie du droit prétend<br />
devenir source du droit. Cela traduit les intérêts corporatistes des juristes qui, naturellement, n’éprouvent<br />
guère de satisfaction dans le rôle très modeste qui consiste à exprimer en concepts <strong>et</strong> à systématiser le droit<br />
positif, mais qui en trouvent à participer au processus de formation du droit : ils entendent ainsi acquérir une<br />
influence politique. Cependant, dans la mesure où ils enfreignent les principes du positivisme, admis au moins<br />
jusqu’à une date récente, par la science du droit moderne, ils sont contraints de dissimuler c<strong>et</strong>te tendance.<br />
Telle est la fonction idéologique de l’annulation des frontières entre le droit <strong>et</strong> la science du droit, entre la<br />
connaissance <strong>et</strong> son obj<strong>et</strong>", (H. KELSEN, La théorie générale du droit <strong>et</strong> le matérialisme historique, 1931) cité<br />
par M. TROPER, "La doctrine <strong>et</strong> le positivisme", in Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 1989, p.286<br />
(p.291).<br />
(338)<br />
G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, 2ème éd., 1955, précité, p.16 citant GENY, Méthode<br />
d'interprétation <strong>et</strong> sources en droit privé positif, tome 2, n°155.<br />
97





![validation du choix du projet tutoré » [PDF - 26 Ko ]](https://img.yumpu.com/51944655/1/184x260/validation-du-choix-du-projet-tutorac-a-pdf-26-ko-.jpg?quality=85)



![Master 1 droit du patrimoine [PDF - 53 Ko ]](https://img.yumpu.com/51943630/1/184x260/master-1-droit-du-patrimoine-pdf-53-ko-.jpg?quality=85)


![Master 1 droit de l'environnement [PDF - 56 Ko ]](https://img.yumpu.com/51941855/1/184x260/master-1-droit-de-lenvironnement-pdf-56-ko-.jpg?quality=85)
![matières avec tirage au sort [PDF - 66 Ko ]](https://img.yumpu.com/51940843/1/184x260/matiares-avec-tirage-au-sort-pdf-66-ko-.jpg?quality=85)
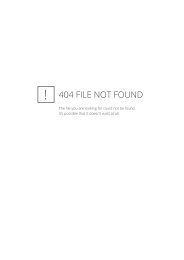
![Liste principale [PDF - 76 Ko ]](https://img.yumpu.com/51938849/1/184x260/liste-principale-pdf-76-ko-.jpg?quality=85)
![Master 1 carrières judiciaires [PDF - 53 Ko ]](https://img.yumpu.com/51938063/1/184x260/master-1-carriares-judiciaires-pdf-53-ko-.jpg?quality=85)