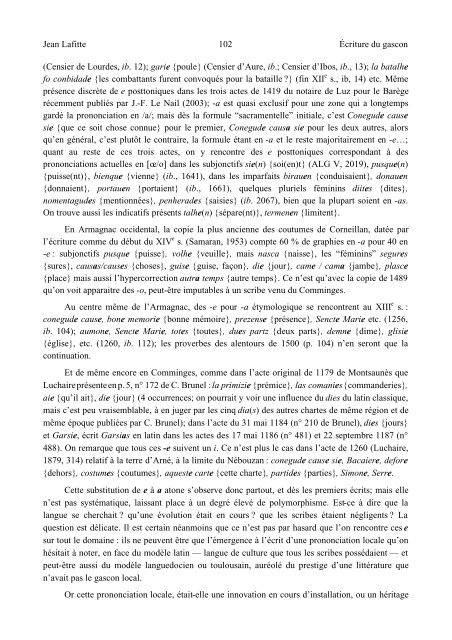Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jean <strong>Lafitte</strong> 102 Écriture du gascon<br />
(Censier de Lourdes, ib. 12); garie {poule} (Censier d’Aure, ib.; Censier d’Ibos, ib., 13); la batalhe<br />
fo conbidade {les combattants furent convoqués pour la bataille ?} (fin XII e s., ib, 14) etc. Même<br />
présence discrète de e posttoniques dans les trois actes de 1419 du notaire de Luz pour le Barège<br />
récemment publiés par J.-F. Le Nail (2003); -a est quasi exclusif pour une zone qui a longtemps<br />
gardé la prononciation en /a/; mais dès la formule “sacramentelle” initiale, c’est Conegude cause<br />
sie {que ce soit chose connue} pour le premier, Conegude causa sie pour les deux autres, alors<br />
qu’en général, c’est plutôt le contraire, la formule étant en -a et le reste majoritairement en -e…;<br />
quant au reste de ces trois actes, on y rencontre des e posttoniques correspondant à des<br />
prononciations actuelles en [œ/o] dans les subjonctifs sie(n) {soi(en)t} (ALG V, 2019), pusque(n)<br />
{puisse(nt)}, bienque {vienne} (ib., 1641), dans les imparfaits birauen {conduisaient}, donauen<br />
{donnaient}, portauen {portaient} (ib., 1661), quelques pluriels féminins diites {dites},<br />
nomentagudes {mentionnées}, penherades {saisies} (ib. 2067), bien que la plupart soient en -as.<br />
On trouve aussi les indicatifs présents talhe(n) {sépare(nt)}, termenen {limitent}.<br />
En Armagnac occidental, la copie la plus ancienne des coutumes de Corneillan, datée par<br />
l’écriture comme du début du XIV e s. (Samaran, 1953) compte 60 % de graphies en -a pour 40 en<br />
-e : subjonctifs pusque {puisse}, volhe {veuille}, mais nasca {naisse}, les “féminins” segures<br />
{sures}, causas/causes {choses}, guise {guise, façon}, die {jour}, came / cama {jambe}, plasce<br />
{place} mais aussi l’hypercorrection autra temps {autre temps}. Ce n’est qu’avec la copie de 1489<br />
qu’on voit apparaitre des -o, peut-être imputables à un scribe venu du Comminges.<br />
Au centre même de l’Armagnac, des -e pour -a étymologique se rencontrent au XIII e s. :<br />
conegude cause, bone memorie {bonne mémoire}, prezense {présence}, Sencte Marie etc. (1256,<br />
ib. 104); aumone, Sencte Marie, totes {toutes}, dues partz {deux parts}, demne {dime}, glisie<br />
{église}, etc. (1260, ib. 112); les proverbes des alentours de 1500 (p. 104) n’en seront que la<br />
continuation.<br />
Et de même encore en Comminges, comme dans l’acte original de 1179 de Montsaunès que<br />
Luchaire présente en p. 5, n° 172 de C. Brunel : la primizie {prémice}, las comanies {commanderies},<br />
aie {qu’il ait}, die {jour} (4 occurrences; on pourrait y voir une influence du dies du latin classique,<br />
mais c’est peu vraisemblable, à en juger par les cinq dia(s) des autres chartes de même région et de<br />
même époque publiées par C. Brunel); dans l’acte du 31 mai 1184 (n° 210 de Brunel), dies {jours}<br />
et Garsie, écrit Garsias en latin dans les actes des 17 mai 1186 (n° 481) et 22 septembre 1187 (n°<br />
488). On remarque que tous ces -e suivent un i. Ce n’est plus le cas dans l’acte de 1260 (Luchaire,<br />
1879, 314) relatif à la terre d’Arné, à la limite du Nébouzan : conegude cause sie, Bacaiere, defore<br />
{dehors}, costumes {coutumes}, aqueste carte {cette charte}, partides {parties}, Simone, Serre.<br />
Cette substitution de e à a atone s’observe donc partout, et dès les premiers écrits; mais elle<br />
n’est pas systématique, laissant place à un degré élevé de polymorphisme. Est-ce à dire que la<br />
langue se cherchait ? qu’une évolution était en cours ? que les scribes étaient négligents ? La<br />
question est délicate. Il est certain néanmoins que ce n’est pas par hasard que l’on rencontre ces e<br />
sur tout le domaine : ils ne peuvent être que l’émergence à l’écrit d’une prononciation locale qu’on<br />
hésitait à noter, en face du modèle latin — langue de culture que tous les scribes possédaient — et<br />
peut-être aussi du modèle languedocien ou toulousain, auréolé du prestige d’une littérature que<br />
n’avait pas le gascon local.<br />
Or cette prononciation locale, était-elle une innovation en cours d’installation, ou un héritage