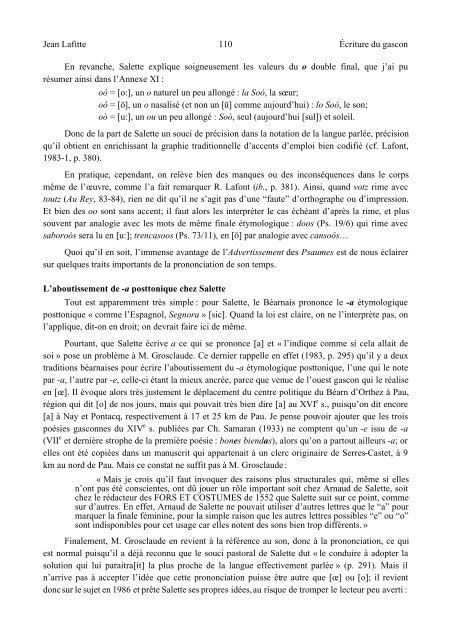Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jean <strong>Lafitte</strong> 110 Écriture du gascon<br />
En revanche, Salette explique soigneusement les valeurs du o double final, que j’ai pu<br />
résumer ainsi dans l’Annexe XI :<br />
oó = [o:], un o naturel un peu allongé : la Soó, la sœur;<br />
oô = [õ], un o nasalisé (et non un [,] comme aujourd’hui) : lo Soô, le son;<br />
oò = [u:], un ou un peu allongé : Soò, seul (aujourd’hui [sul]) et soleil.<br />
Donc de la part de Salette un souci de précision dans la notation de la langue parlée, précision<br />
qu’il obtient en enrichissant la graphie traditionnelle d’accents d’emploi bien codifié (cf. Lafont,<br />
1983-1, p. 380).<br />
En pratique, cependant, on relève bien des manques ou des inconséquences dans le corps<br />
même de l’œuvre, comme l’a fait remarquer R. Lafont (ib., p. 381). Ainsi, quand votz rime avec<br />
toutz (Au Rey, 83-84), rien ne dit qu’il ne s’agit pas d’une “faute” d’orthographe ou d’impression.<br />
Et bien des oo sont sans accent; il faut alors les interpréter le cas échéant d’après la rime, et plus<br />
souvent par analogie avec les mots de même finale étymologique : doos (Ps. 19/6) qui rime avec<br />
saboroòs sera lu en [u:]; trencasoos (Ps. 73/11), en [(] par analogie avec cansoôs…<br />
Quoi qu’il en soit, l’immense avantage de l’Advertissement des Psaumes est de nous éclairer<br />
sur quelques traits importants de la prononciation de son temps.<br />
L’aboutissement de -a posttonique chez Salette<br />
Tout est apparemment très simple : pour Salette, le <strong>Béarnais</strong> prononce le -a étymologique<br />
posttonique « comme l’Espagnol, Segnora » [sic]. Quand la loi est claire, on ne l’interprète pas, on<br />
l’applique, dit-on en droit; on devrait faire ici de même.<br />
Pourtant, que Salette écrive a ce qui se prononce [a] et « l’indique comme si cela allait de<br />
soi » pose un problème à M. Grosclaude. Ce dernier rappelle en effet (1983, p. 295) qu’il y a deux<br />
traditions béarnaises pour écrire l’aboutissement du -a étymologique posttonique, l’une qui le note<br />
par -a, l’autre par -e, celle-ci étant la mieux ancrée, parce que venue de l’ouest gascon qui le réalise<br />
en [œ]. Il évoque alors très justement le déplacement du centre politique du Béarn d’Orthez à Pau,<br />
région qui dit [o] de nos jours, mais qui pouvait très bien dire [a] au XVI e s., puisqu’on dit encore<br />
[a] à Nay et Pontacq, respectivement à 17 et 25 km de Pau. Je pense pouvoir ajouter que les trois<br />
poésies gasconnes du XIV e s. publiées par Ch. Samaran (1933) ne comptent qu’un -e issu de -a<br />
(VII e et dernière strophe de la première poésie : bones biendas), alors qu’on a partout ailleurs -a; or<br />
elles ont été copiées dans un manuscrit qui appartenait à un clerc originaire de Serres-Castet, à 9<br />
km au nord de Pau. Mais ce constat ne suffit pas à M. Grosclaude :<br />
« Mais je crois qu’il faut invoquer des raisons plus structurales qui, même si elles<br />
n’ont pas été conscientes, ont dû jouer un rôle important soit chez Arnaud de Salette, soit<br />
chez le rédacteur des FORS ET COSTUMES de 1552 que Salette suit sur ce point, comme<br />
sur d’autres. En effet, Arnaud de Salette ne pouvait utiliser d’autres lettres que le “a” pour<br />
marquer la finale féminine, pour la simple raison que les autres lettres possibles “e” ou “o”<br />
sont indisponibles pour cet usage car elles notent des sons bien trop différents. »<br />
Finalement, M. Grosclaude en revient à la référence au son, donc à la prononciation, ce qui<br />
est normal puisqu’il a déjà reconnu que le souci pastoral de Salette dut « le conduire à adopter la<br />
solution qui lui paraitra[it] la plus proche de la langue effectivement parlée » (p. 291). Mais il<br />
n’arrive pas à accepter l’idée que cette prononciation puisse être autre que [œ] ou [o]; il revient<br />
donc sur le sujet en 1986 et prête Salette ses propres idées, au risque de tromper le lecteur peu averti :