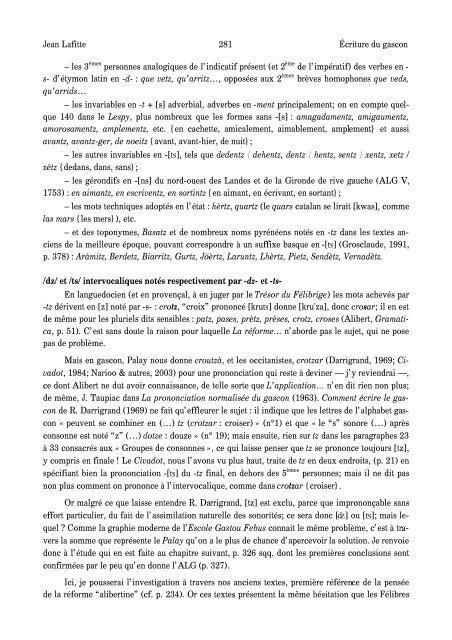Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jean <strong>Lafitte</strong> 281 Écriture du gascon<br />
– les 3 èmes personnes analogiques de l’indicatif présent (et 2 ème de l’impératif) des verbes en -<br />
s- d’étymon latin en -d- : que vetz, qu’arritz…, opposées aux 2 èmes brèves homophones que veds,<br />
qu’arrids…<br />
– les invariables en -t + [s] adverbial, adverbes en -ment principalement; on en compte quelque<br />
140 dans le Lespy, plus nombreux que les formes sans -[s] : amagadamentz, amigaumentz,<br />
amorosamentz, amplementz, etc. {en cachette, amicalement, aimablement, amplement} et aussi<br />
avantz, avantz-ger, de noeitz {avant, avant-hier, de nuit};<br />
– les autres invariables en -[1], tels que dedentz / dehentz, dentz / hentz, sentz / xentz, xetz /<br />
xètz {dedans, dans, sans};<br />
– les gérondifs en -[ns] du nord-ouest des Landes et de la Gironde de rive gauche (ALG V,<br />
1753) : en aimantz, en escriventz, en sortintz {en aimant, en écrivant, en sortant};<br />
– les mots techniques adoptés en l’état : hèrtz, quartz (le quars catalan se lirait [kwas], comme<br />
las mars {les mers}), etc.<br />
– et des toponymes, Basatz et de nombreux noms pyrénéens notés en -tz dans les textes anciens<br />
de la meilleure époque, pouvant correspondre à un suffixe basque en -[1] (Grosclaude, 1991,<br />
p. 378) : Aràmitz, Berdetz, Biarritz, Gurtz, Jöèrtz, Laruntz, Lhèrtz, Pietz, Sendètz, Vernadètz.<br />
/dz/ et /ts/ intervocaliques notés respectivement par -dz- et -ts-<br />
En languedocien (et en provençal, à en juger par le Trésor du Félibrige) les mots achevés par<br />
-tz dérivent en [z] noté par -s- : crotz, “croix” prononcé [kru1] donne [kru'za], donc crosar; il en est<br />
de même pour les pluriels dits sensibles : patz, pases, prètz, prèses, crotz, croses (Alibert, Gramatica,<br />
p. 51). C’est sans doute la raison pour laquelle La réforme… n’aborde pas le sujet, qui ne pose<br />
pas de problème.<br />
Mais en gascon, Palay nous donne croutzà, et les occitanistes, crotzar (Darrigrand, 1969; Civadot,<br />
1984; Narioo & autres, 2003) pour une prononciation qui reste à deviner — j’y reviendrai —,<br />
ce dont Alibert ne dut avoir connaissance, de telle sorte que L’application… n’en dit rien non plus;<br />
de même, J. Taupiac dans La prononciation normalisée du gascon (1963). Comment écrire le gascon<br />
de R. Darrigrand (1969) ne fait qu’effleurer le sujet : il indique que les lettres de l’alphabet gascon<br />
« peuvent se combiner en (…) tz (crotzar : croiser) » (n°1) et que « le “s” sonore (…) après<br />
consonne est noté “z” (…) dotze : douze » (n° 19); mais ensuite, rien sur tz dans les paragraphes 23<br />
à 33 consacrés aux « Groupes de consonnes », ce qui laisse penser que tz se prononce toujours [tz],<br />
y compris en finale ! Le Civadot, nous l’avons vu plus haut, traite de tz en deux endroits, (p. 21) en<br />
spécifiant bien la prononciation -[1] du -tz final, en dehors des 5 èmes personnes; mais il ne dit pas<br />
non plus comment on prononce à l’intervocalique, comme dans crotzar {croiser}.<br />
Or malgré ce que laisse entendre R. Darrigrand, [tz] est exclu, parce que imprononçable sans<br />
effort particulier, du fait de l’assimilation naturelle des sonorités; ce sera donc [+] ou [1]; mais lequel<br />
? Comme la graphie moderne de l’Escole Gastou Febus connait le même problème, c’est à travers<br />
la somme que représente le Palay qu’on a le plus de chance d’apercevoir la solution. Je renvoie<br />
donc à l’étude qui en est faite au chapitre suivant, p. 326 sqq. dont les premières conclusions sont<br />
confirmées par le peu qu’en donne l’ALG (p. 327).<br />
Ici, je pousserai l’investigation à travers nos anciens textes, première référence de la pensée<br />
de la réforme “alibertine” (cf. p. 234). Or ces textes présentent la même hésitation que les Félibres