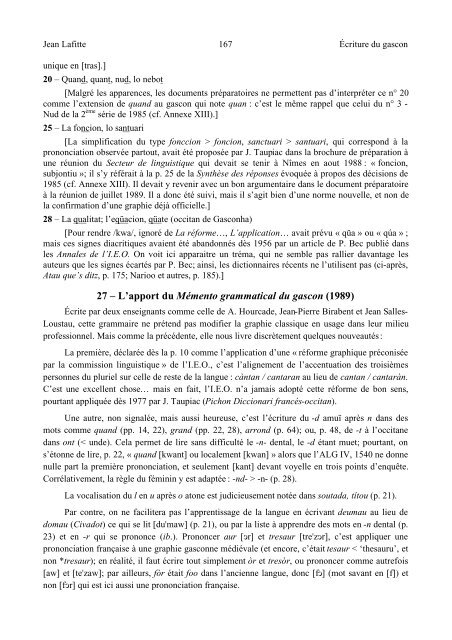Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jean <strong>Lafitte</strong> 167 Écriture du gascon<br />
unique en [tras].]<br />
20 – Quand, quant, nud, lo nebot<br />
[Malgré les apparences, les documents préparatoires ne permettent pas d’interpréter ce n° 20<br />
comme l’extension de quand au gascon qui note quan : c’est le même rappel que celui du n° 3 -<br />
Nud de la 2 ème série de 1985 (cf. Annexe XIII).]<br />
25 – La foncion, lo santuari<br />
[La simplification du type fonccion > foncion, sanctuari > santuari, qui correspond à la<br />
prononciation observée partout, avait été proposée par J. Taupiac dans la brochure de préparation à<br />
une réunion du Secteur de linguistique qui devait se tenir à Nîmes en aout 1988 : « foncion,<br />
subjontiu »; il s’y référait à la p. 25 de la Synthèse des réponses évoquée à propos des décisions de<br />
1985 (cf. Annexe XIII). Il devait y revenir avec un bon argumentaire dans le document préparatoire<br />
à la réunion de juillet 1989. Il a donc été suivi, mais il s’agit bien d’une norme nouvelle, et non de<br />
la confirmation d’une graphie déjà officielle.]<br />
28 – La qualitat; l’eqüacion, qüate (occitan de <strong>Gascon</strong>ha)<br />
[Pour rendre /kwa/, ignoré de La réforme…, L’application… avait prévu « q(a » ou « qúa » ;<br />
mais ces signes diacritiques avaient été abandonnés dès 1956 par un article de P. Bec publié dans<br />
les Annales de l’I.E.O. On voit ici apparaitre un tréma, qui ne semble pas rallier davantage les<br />
auteurs que les signes écartés par P. Bec; ainsi, les dictionnaires récents ne l’utilisent pas (ci-après,<br />
Atau que’s ditz, p. 175; Narioo et autres, p. 185).]<br />
27 – L’apport du Mémento grammatical du gascon (1989)<br />
Écrite par deux enseignants comme celle de A. Hourcade, Jean-Pierre Birabent et Jean Salles-<br />
Loustau, cette grammaire ne prétend pas modifier la graphie classique en usage dans leur milieu<br />
professionnel. Mais comme la précédente, elle nous livre discrètement quelques nouveautés :<br />
La première, déclarée dès la p. 10 comme l’application d’une « réforme graphique préconisée<br />
par la commission linguistique » de l’I.E.O., c’est l’alignement de l’accentuation des troisièmes<br />
personnes du pluriel sur celle de reste de la langue : càntan / cantaran au lieu de cantan / cantaràn.<br />
C’est une excellent chose… mais en fait, l’I.E.O. n’a jamais adopté cette réforme de bon sens,<br />
pourtant appliquée dès 1977 par J. Taupiac (Pichon Diccionari francés-occitan).<br />
Une autre, non signalée, mais aussi heureuse, c’est l’écriture du -d amuï après n dans des<br />
mots comme quand (pp. 14, 22), grand (pp. 22, 28), arrond (p. 64); ou, p. 48, de -t à l’occitane<br />
dans ont (< unde). Cela permet de lire sans difficulté le -n- dental, le -d étant muet; pourtant, on<br />
s’étonne de lire, p. 22, « quand [kwant] ou localement [kwan] » alors que l’ALG IV, 1540 ne donne<br />
nulle part la première prononciation, et seulement [kant] devant voyelle en trois points d’enquête.<br />
Corrélativement, la règle du féminin y est adaptée : -nd- > -n- (p. 28).<br />
La vocalisation du l en u après o atone est judicieusement notée dans soutada, títou (p. 21).<br />
Par contre, on ne facilitera pas l’apprentissage de la langue en écrivant deumau au lieu de<br />
domau (Civadot) ce qui se lit [du'maw] (p. 21), ou par la liste à apprendre des mots en -n dental (p.<br />
23) et en -r qui se prononce (ib.). Prononcer aur [%r] et tresaur [tre'z%r], c’est appliquer une<br />
prononciation française à une graphie gasconne médiévale (et encore, c’était tesaur < ‘thesauru’, et<br />
non *tresaur); en réalité, il faut écrire tout simplement òr et tresòr, ou prononcer comme autrefois<br />
[aw] et [te'zaw]; par ailleurs, fòr était foo dans l’ancienne langue, donc [f%] (mot savant en [f]) et<br />
non [f%r] qui est ici aussi une prononciation française.