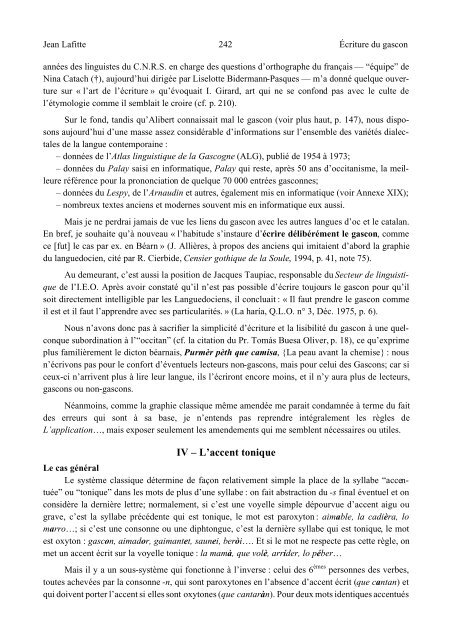Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Jean <strong>Lafitte</strong> 242 Écriture du gascon<br />
années des linguistes du C.N.R.S. en charge des questions d’orthographe du français — “équipe” de<br />
Nina Catach (†), aujourd’hui dirigée par Liselotte Bidermann-Pasques — m’a donné quelque ouverture<br />
sur « l’art de l’écriture » qu’évoquait I. Girard, art qui ne se confond pas avec le culte de<br />
l’étymologie comme il semblait le croire (cf. p. 210).<br />
Sur le fond, tandis qu’Alibert connaissait mal le gascon (voir plus haut, p. 147), nous disposons<br />
aujourd’hui d’une masse assez considérable d’informations sur l’ensemble des variétés dialectales<br />
de la langue contemporaine :<br />
– données de l’Atlas linguistique de la Gascogne (ALG), publié de 1954 à 1973;<br />
– données du Palay saisi en informatique, Palay qui reste, après 50 ans d’occitanisme, la meilleure<br />
référence pour la prononciation de quelque 70 000 entrées gasconnes;<br />
– données du Lespy, de l’Arnaudin et autres, également mis en informatique (voir Annexe XIX);<br />
– nombreux textes anciens et modernes souvent mis en informatique eux aussi.<br />
Mais je ne perdrai jamais de vue les liens du gascon avec les autres langues d’oc et le catalan.<br />
En bref, je souhaite qu’à nouveau « l’habitude s’instaure d’écrire délibérément le gascon, comme<br />
ce [fut] le cas par ex. en Béarn » (J. Allières, à propos des anciens qui imitaient d’abord la graphie<br />
du languedocien, cité par R. Cierbide, Censier gothique de la Soule, 1994, p. 41, note 75).<br />
Au demeurant, c’est aussi la position de Jacques Taupiac, responsable du Secteur de linguistique<br />
de l’I.E.O. Après avoir constaté qu’il n’est pas possible d’écrire toujours le gascon pour qu’il<br />
soit directement intelligible par les Languedociens, il concluait : « Il faut prendre le gascon comme<br />
il est et il faut l’apprendre avec ses particularités. » (La haría, Q.L.O. n° 3, Déc. 1975, p. 6).<br />
Nous n’avons donc pas à sacrifier la simplicité d’écriture et la lisibilité du gascon à une quelconque<br />
subordination à l’“occitan” (cf. la citation du Pr. Tomás Buesa Oliver, p. 18), ce qu’exprime<br />
plus familièrement le dicton béarnais, Purmèr pèth que camisa, {La peau avant la chemise} : nous<br />
n’écrivons pas pour le confort d’éventuels lecteurs non-gascons, mais pour celui des <strong>Gascon</strong>s; car si<br />
ceux-ci n’arrivent plus à lire leur langue, ils l’écriront encore moins, et il n’y aura plus de lecteurs,<br />
gascons ou non-gascons.<br />
Néanmoins, comme la graphie classique même amendée me parait condamnée à terme du fait<br />
des erreurs qui sont à sa base, je n’entends pas reprendre intégralement les règles de<br />
L’application…, mais exposer seulement les amendements qui me semblent nécessaires ou utiles.<br />
IV – L’accent tonique<br />
Le cas général<br />
Le système classique détermine de façon relativement simple la place de la syllabe “accentuée”<br />
ou “tonique” dans les mots de plus d’une syllabe : on fait abstraction du -s final éventuel et on<br />
considère la dernière lettre; normalement, si c’est une voyelle simple dépourvue d’accent aigu ou<br />
grave, c’est la syllabe précédente qui est tonique, le mot est paroxyton : aimable, la cadièra, lo<br />
marro…; si c’est une consonne ou une diphtongue, c’est la dernière syllabe qui est tonique, le mot<br />
est oxyton : gascon, aimador, gaimantet, saunei, beròi…. Et si le mot ne respecte pas cette règle, on<br />
met un accent écrit sur la voyelle tonique : la mamà, que volè, arríder, lo péber…<br />
Mais il y a un sous-système qui fonctionne à l’inverse : celui des 6 èmes personnes des verbes,<br />
toutes achevées par la consonne -n, qui sont paroxytones en l’absence d’accent écrit (que cantan) et<br />
qui doivent porter l’accent si elles sont oxytones (que cantaràn). Pour deux mots identiques accentués