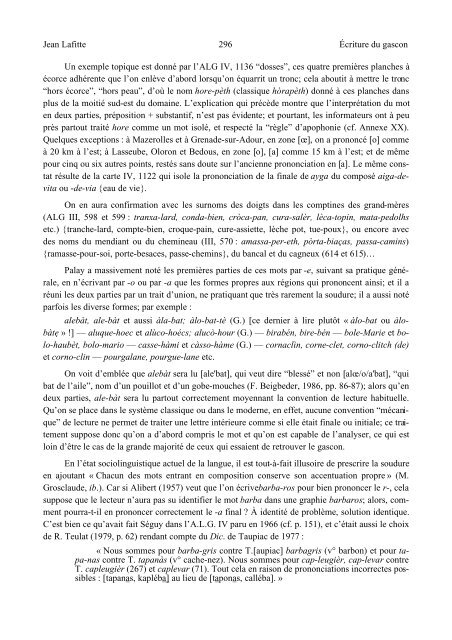Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jean <strong>Lafitte</strong> 296 Écriture du gascon<br />
Un exemple topique est donné par l’ALG IV, 1136 “dosses”, ces quatre premières planches à<br />
écorce adhérente que l’on enlève d’abord lorsqu’on équarrit un tronc; cela aboutit à mettre le tronc<br />
“hors écorce”, “hors peau”, d’où le nom hore-pèth (classique hòrapèth) donné à ces planches dans<br />
plus de la moitié sud-est du domaine. L’explication qui précède montre que l’interprétation du mot<br />
en deux parties, préposition + substantif, n’est pas évidente; et pourtant, les informateurs ont à peu<br />
près partout traité hore comme un mot isolé, et respecté la “règle” d’apophonie (cf. Annexe XX).<br />
Quelques exceptions : à Mazerolles et à Grenade-sur-Adour, en zone [œ], on a prononcé [o] comme<br />
à 20 km à l’est; à Lasseube, Oloron et Bedous, en zone [o], [a] comme 15 km à l’est; et de même<br />
pour cinq ou six autres points, restés sans doute sur l’ancienne prononciation en [a]. Le même constat<br />
résulte de la carte IV, 1122 qui isole la prononciation de la finale de ayga du composé aiga-devita<br />
ou -de-via {eau de vie}.<br />
On en aura confirmation avec les surnoms des doigts dans les comptines des grand-mères<br />
(ALG III, 598 et 599 : tranxa-lard, conda-bien, cròca-pan, cura-salèr, lèca-topin, mata-pedolhs<br />
etc.) {tranche-lard, compte-bien, croque-pain, cure-assiette, lèche pot, tue-poux}, ou encore avec<br />
des noms du mendiant ou du chemineau (III, 570 : amassa-per-eth, pòrta-biaças, passa-camins)<br />
{ramasse-pour-soi, porte-besaces, passe-chemins}, du bancal et du cagneux (614 et 615)…<br />
Palay a massivement noté les premières parties de ces mots par -e, suivant sa pratique générale,<br />
en n’écrivant par -o ou par -a que les formes propres aux régions qui prononcent ainsi; et il a<br />
réuni les deux parties par un trait d’union, ne pratiquant que très rarement la soudure; il a aussi noté<br />
parfois les diverse formes; par exemple :<br />
alebàt, ale-bàt et aussi àla-bat; àlo-bat-tè (G.) [ce dernier à lire plutôt « àlo-bat ou àlobàt"<br />
» !] — aluque-hoec et alùco-hoécs; alucò-hour (G.) — birabén, bire-bén — bole-Marie et bolo-haubèt,<br />
bolo-mario — casse-hàmi et càsso-hàme (G.) — cornaclìn, corne-clet, corno-clitch (de)<br />
et corno-clin — pourgalane, pourgue-lane etc.<br />
On voit d’emblée que alebàt sera lu [ale'bat], qui veut dire “blessé” et non [alœ/o/a'bat], “qui<br />
bat de l’aile”, nom d’un pouillot et d’un gobe-mouches (F. Beigbeder, 1986, pp. 86-87); alors qu’en<br />
deux parties, ale-bàt sera lu partout correctement moyennant la convention de lecture habituelle.<br />
Qu’on se place dans le système classique ou dans le moderne, en effet, aucune convention “mécanique”<br />
de lecture ne permet de traiter une lettre intérieure comme si elle était finale ou initiale; ce traitement<br />
suppose donc qu’on a d’abord compris le mot et qu’on est capable de l’analyser, ce qui est<br />
loin d’être le cas de la grande majorité de ceux qui essaient de retrouver le gascon.<br />
En l’état sociolinguistique actuel de la langue, il est tout-à-fait illusoire de prescrire la soudure<br />
en ajoutant « Chacun des mots entrant en composition conserve son accentuation propre » (M.<br />
Grosclaude, ib.). Car si Alibert (1957) veut que l’on écrivebarba-ros pour bien prononcer le r-, cela<br />
suppose que le lecteur n’aura pas su identifier le mot barba dans une graphie barbaros; alors, comment<br />
pourra-t-il en prononcer correctement le -a final ? À identité de problème, solution identique.<br />
C’est bien ce qu’avait fait Séguy dans l’A.L.G. IV paru en 1966 (cf. p. 151), et c’était aussi le choix<br />
de R. Teulat (1979, p. 62) rendant compte du Dic. de Taupiac de 1977 :<br />
« Nous sommes pour barba-gris contre T.[aupiac] barbagris (v° barbon) et pour tapa-nas<br />
contre T. tapanàs (v° cache-nez). Nous sommes pour cap-leugièr, cap-levar contre<br />
T. capleugièr (267) et caplevar (71). Tout cela en raison de prononciations incorrectes possibles<br />
: [tapanas, kapléba] au lieu de [taponas, calléba]. »