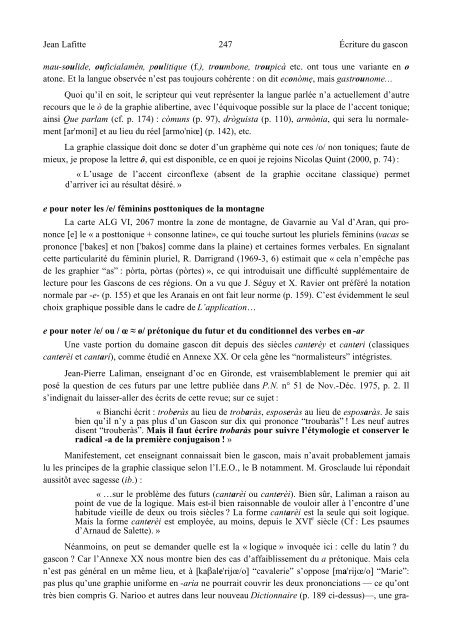Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
Thèse J. Lafitte - Tome I - Institut Béarnais Gascon
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jean <strong>Lafitte</strong> 247 Écriture du gascon<br />
mau-soulide, oufìcialamén, poulitique (f.), troumbone, troupicà etc. ont tous une variante en o<br />
atone. Et la langue observée n’est pas toujours cohérente : on dit econòm", mais gastrounome…<br />
Quoi qu’il en soit, le scripteur qui veut représenter la langue parlée n’a actuellement d’autre<br />
recours que le ò de la graphie alibertine, avec l’équivoque possible sur la place de l’accent tonique;<br />
ainsi Que parlam (cf. p. 174) : còmuns (p. 97), dròguista (p. 110), armònia, qui sera lu normalement<br />
[ar'moni] et au lieu du réel [armo'niœ] (p. 142), etc.<br />
La graphie classique doit donc se doter d’un graphème qui note ces /o/ non toniques; faute de<br />
mieux, je propose la lettre ô, qui est disponible, ce en quoi je rejoins Nicolas Quint (2000, p. 74) :<br />
« L’usage de l’accent circonflexe (absent de la graphie occitane classique) permet<br />
d’arriver ici au résultat désiré. »<br />
e pour noter les /e/ féminins posttoniques de la montagne<br />
La carte ALG VI, 2067 montre la zone de montagne, de Gavarnie au Val d’Aran, qui prononce<br />
[e] le « a posttonique + consonne latine», ce qui touche surtout les pluriels féminins (vacas se<br />
prononce ['bakes] et non ['bakos] comme dans la plaine) et certaines formes verbales. En signalant<br />
cette particularité du féminin pluriel, R. Darrigrand (1969-3, 6) estimait que « cela n’empêche pas<br />
de les graphier “as” : pòrta, pòrtas (pòrtes) », ce qui introduisait une difficulté supplémentaire de<br />
lecture pour les <strong>Gascon</strong>s de ces régions. On a vu que J. Séguy et X. Ravier ont préféré la notation<br />
normale par -e- (p. 155) et que les Aranais en ont fait leur norme (p. 159). C’est évidemment le seul<br />
choix graphique possible dans le cadre de L’application…<br />
e pour noter /e/ ou / œ ! ø/ prétonique du futur et du conditionnel des verbes en -ar<br />
Une vaste portion du domaine gascon dit depuis des siècles canterèy et canteri (classiques<br />
canterèi et cantarí), comme étudié en Annexe XX. Or cela gêne les “normalisteurs” intégristes.<br />
Jean-Pierre Laliman, enseignant d’oc en Gironde, est vraisemblablement le premier qui ait<br />
posé la question de ces futurs par une lettre publiée dans P.N. n° 51 de Nov.-Déc. 1975, p. 2. Il<br />
s’indignait du laisser-aller des écrits de cette revue; sur ce sujet :<br />
« Bianchi écrit : troberàs au lieu de trobaràs, esposeràs au lieu de esposaràs. Je sais<br />
bien qu’il n’y a pas plus d’un <strong>Gascon</strong> sur dix qui prononce “troubaràs” ! Les neuf autres<br />
disent “trouberàs”. Mais il faut écrire trobaràs pour suivre l’étymologie et conserver le<br />
radical -a de la première conjugaison ! »<br />
Manifestement, cet enseignant connaissait bien le gascon, mais n’avait probablement jamais<br />
lu les principes de la graphie classique selon l’I.E.O., le B notamment. M. Grosclaude lui répondait<br />
aussitôt avec sagesse (ib.) :<br />
« …sur le problème des futurs (cantarèi ou canterèi). Bien sûr, Laliman a raison au<br />
point de vue de la logique. Mais est-il bien raisonnable de vouloir aller à l’encontre d’une<br />
habitude vieille de deux ou trois siècles ? La forme cantarèi est la seule qui soit logique.<br />
Mais la forme canterèi est employée, au moins, depuis le XVI e siècle (Cf : Les psaumes<br />
d’Arnaud de Salette). »<br />
Néanmoins, on peut se demander quelle est la « logique » invoquée ici : celle du latin ? du<br />
gascon ? Car l’Annexe XX nous montre bien des cas d’affaiblissement du a prétonique. Mais cela<br />
n’est pas général en un même lieu, et à [ka.ale'rijœ/o] “cavalerie” s’oppose [ma'rijœ/o] “Marie”:<br />
pas plus qu’une graphie uniforme en -aria ne pourrait couvrir les deux prononciations — ce qu’ont<br />
très bien compris G. Narioo et autres dans leur nouveau Dictionnaire (p. 189 ci-dessus)—, une gra-