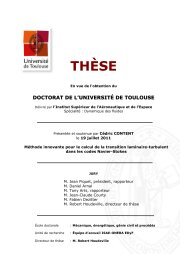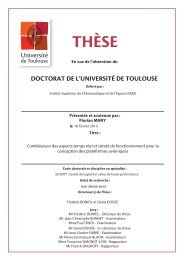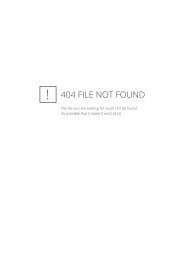Commande boucle fermée multivariable pour le vol en ... - ISAE
Commande boucle fermée multivariable pour le vol en ... - ISAE
Commande boucle fermée multivariable pour le vol en ... - ISAE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5.1 Revue bibliographique 185Planet Finder. Ce modè<strong>le</strong> compr<strong>en</strong>d la dynamique de la structure f<strong>le</strong>xib<strong>le</strong>, des modè<strong>le</strong>s des bruitsd’actuation et de mesure, ainsi qu’un modè<strong>le</strong> de l’optique (qui est établi <strong>en</strong> ayant recours à un logicielde modélisation optique et <strong>en</strong> effectuant une analyse de s<strong>en</strong>sibilité). Une analyse détaillée desperformances stochastiques <strong>en</strong> <strong>bouc<strong>le</strong></strong> <strong>fermée</strong> est effectuée.Pan et Kapila [135] prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t un modè<strong>le</strong> non-linéaire qui décrit à la fois <strong>le</strong>s ori<strong>en</strong>tations et <strong>le</strong>stranslations relatives d’une formation bi-satellite. Ensuite, <strong>le</strong>s auteurs propos<strong>en</strong>t une loi de commandeadaptative dont la stabilité est démontrée grâce à une fonction de Lyapunov. Des paramètres inconnustels que <strong>le</strong>s masses et <strong>le</strong>s inerties des deux vaisseaux sont estimées.Wong et al. [196] conçoiv<strong>en</strong>t un correcteur de retour de sortie qui utilise seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s positionset ori<strong>en</strong>tations relatives, mais pas <strong>le</strong>s vitesses. Cel<strong>le</strong>s-ci sont estimées grâce à un filtre passe-haut. Lecorrecteur est capab<strong>le</strong> de suivre une consigne variante. Sa stabilité est montré avec une fonction deLyapunov.Aung et al. [11] donn<strong>en</strong>t une vue globa<strong>le</strong> de la mission Terrestrial Planet Finder. Les principauxdéfis technologiques sont m<strong>en</strong>tionnés, par exemp<strong>le</strong> évitem<strong>en</strong>t de collisions ou contrô<strong>le</strong> à haute précisionp<strong>en</strong>dant <strong>le</strong> mode d’observation. Un point intéressant que <strong>le</strong>s auteurs prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t est la séqu<strong>en</strong>ce temporel<strong>le</strong>opérationnel<strong>le</strong> de la formation, c’est-à-dire l’<strong>en</strong>chaînem<strong>en</strong>t des différ<strong>en</strong>ts modes opérationnelset <strong>le</strong> temps prévu <strong>pour</strong> chacun d’<strong>en</strong>tre eux. En outre, <strong>le</strong>s précisions requises <strong>en</strong> termes de positionrelative <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s différ<strong>en</strong>ts modes opérationnels sont montrées.Brown et al. [28] effectu<strong>en</strong>t une analyse très globa<strong>le</strong> des besoins <strong>pour</strong> la mission StarLight qui estcomposée de deux vaisseaux, un col<strong>le</strong>cteur et un recombinateur. Les points étudiés sont l’architecturedu système de <strong>vol</strong>, c’est-à-dire la charge uti<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s moy<strong>en</strong>s de communication et <strong>le</strong>s s<strong>en</strong>seurs, ainsi que<strong>le</strong>s modes opérationnels avec <strong>le</strong>s performances associées.Lee et Li [100] modélis<strong>en</strong>t <strong>le</strong>s dynamiques <strong>en</strong> translation et <strong>en</strong> ori<strong>en</strong>tation dans des repèresinertiels avant d’introduire des translations et des ori<strong>en</strong>tations relatives. Les auteurs propos<strong>en</strong>t unedécomposition de la dynamique <strong>en</strong> une dynamique moy<strong>en</strong>ne et des dynamiques dites de forme, c’està-direrelatives à la moy<strong>en</strong>ne. Afin d’obt<strong>en</strong>ir la dynamique moy<strong>en</strong>ne, <strong>le</strong>s moy<strong>en</strong>nes de la quantité demouvem<strong>en</strong>t et du mom<strong>en</strong>t cinétique sont calculées <strong>pour</strong> la dynamique de translation et d’ori<strong>en</strong>tation,respectivem<strong>en</strong>t. Les auteurs montr<strong>en</strong>t l’effet d’une tel<strong>le</strong> décomposition sur la synthèse de correcteurs.En outre, ils propos<strong>en</strong>t une ext<strong>en</strong>sion hiérarchique sur plusieurs niveaux de <strong>le</strong>ur approche.Bourga et al. [22] décriv<strong>en</strong>t <strong>le</strong> sous-système radiofréqu<strong>en</strong>ce <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s missions Darwin et Smart-2.Ce système est composé de plusieurs ant<strong>en</strong>nes réceptrices et émettrices à bord des différ<strong>en</strong>ts vaisseaux(six à sept ant<strong>en</strong>nes <strong>en</strong> fonction du vaisseau considéré). Les auteurs abord<strong>en</strong>t éga<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t deuxpoints cruciaux de ce système, <strong>le</strong> problème de synchronisation des signaux transmis et la questionde la précision atteignab<strong>le</strong>. En outre, ils discut<strong>en</strong>t différ<strong>en</strong>tes architectures d’estimation (estimationc<strong>en</strong>tralisée, distribuée et déc<strong>en</strong>tralisée).Chabot et Udrea [35] considèr<strong>en</strong>t la mission XEUS (angl. X-ray E<strong>vol</strong>ving Universe Spectroscopy)qui consiste <strong>en</strong> deux vaisseaux spatiaux situés sur une orbite halo autour du point de Lagrange L 2 .Dans la phase de modélisation, <strong>le</strong>s auteurs se sont inspirés de nos travaux, <strong>en</strong> particulier du modè<strong>le</strong>linéarisé prés<strong>en</strong>té dans <strong>le</strong> Chapitre 3 et dans [57, 58]. Deux correcteurs sont synthétisés, un correcteurH 2 <strong>pour</strong> <strong>le</strong> mode d’observation et un correcteur PD (proportionnel-dérivé) axe-par-axe <strong>pour</strong> <strong>le</strong> modede changem<strong>en</strong>t d’ori<strong>en</strong>tation.Yamanaka [198] considère un contrô<strong>le</strong> simultané des dynamiques de translation <strong>en</strong> orbite terrestreet d’attitude. Cep<strong>en</strong>dant, <strong>le</strong>s synthèses des correcteurs de translation et d’attitude sont effectuéesséparém<strong>en</strong>t. Cette approche est justifiée par <strong>le</strong> fait que l’asservissem<strong>en</strong>t sert à changer l’ori<strong>en</strong>tation etla forme d’une formation de satellites. Il ne sert pas à satisfaire des spécifications exigeantes comme<strong>Commande</strong> <strong>bouc<strong>le</strong></strong> <strong>fermée</strong> <strong>multivariab<strong>le</strong></strong> <strong>pour</strong> <strong>le</strong> <strong>vol</strong> <strong>en</strong> formation de vaisseaux spatiaux