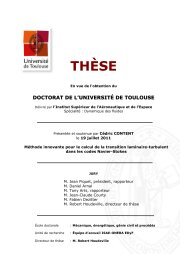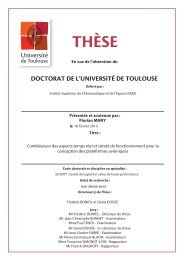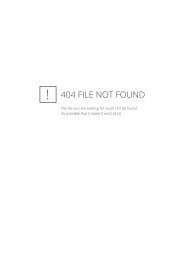Commande boucle fermée multivariable pour le vol en ... - ISAE
Commande boucle fermée multivariable pour le vol en ... - ISAE
Commande boucle fermée multivariable pour le vol en ... - ISAE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
5.3 Modélisation de la mission Pegase 187base. Les détails, par exemp<strong>le</strong> la forme standard utilisée <strong>pour</strong> la synthèse, seront développés dans laSection 5.4.Ensuite, il est important de t<strong>en</strong>ir compte des biais, par exemp<strong>le</strong> des biais de mesure et d’actuationet des biais dûs aux perturbations orbita<strong>le</strong>s, car ces biais sont susceptib<strong>le</strong>s de consommer unegrande partie du budget alloué à chaque sortie contrôlée. Pour cela, la forme standard utilisée <strong>pour</strong> <strong>le</strong>correcteur de base doit être <strong>en</strong>richie afin de comporter des estimateurs de biais. Les détails de cetteapproche se trouv<strong>en</strong>t toujours dans la Section 5.4.Le mode d’observation est celui dans <strong>le</strong>quel la performance ultime est atteinte, c’est-à-dire laperformance nécessaire afin d’effectuer <strong>le</strong>s mesures d’interférométrie. L’importance de ce mode esttout à fait justifiée. Cep<strong>en</strong>dant, il faut d’abord trouver un moy<strong>en</strong> <strong>pour</strong> y arriver. La problématiqueest liée au fait de disposer de capteurs à haute précision, mais à champ de vue restreint d’un côté etde capteurs à champ de vue large, mais grossiers. Nous prés<strong>en</strong>terons dans la Section 5.5 une approchequi permet de commuter <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>s modes (et correcteurs associés) précéd<strong>en</strong>t <strong>le</strong> mode d’observationet d’effectuer un asservissem<strong>en</strong>t de plus <strong>en</strong> plus précis jusqu’au mode d’observation. Nous ti<strong>en</strong>dronséga<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t compte des bruits et proposeront un critère de commutation garantissant la stabilité.Un autre objectif très important est la synthèse de correcteurs déc<strong>en</strong>tralisés, c’est-à-dire de correcteurslocaux embarqués sur chacun des vaisseaux. Les différ<strong>en</strong>ts correcteurs locaux ne communiqu<strong>en</strong>tpas <strong>en</strong>tre eux. Par conséqu<strong>en</strong>t, ils ne connaiss<strong>en</strong>t que <strong>le</strong>s mesures loca<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t disponib<strong>le</strong>s et ne command<strong>en</strong>tque <strong>le</strong>s actionneurs sur <strong>le</strong> même vaisseau. Plusieurs avantages sont associés à un correcteurdéc<strong>en</strong>tralisé, par exemp<strong>le</strong> la distribution des calculs sur plusieurs vaisseaux ou la possibilité de réduire<strong>le</strong>s moy<strong>en</strong>s de communication et de faire ainsi des économies <strong>en</strong> termes de masse. Comme nous <strong>le</strong>verrons dans la Section 5.6, la synthèse de correcteurs déc<strong>en</strong>tralisés est un problème dont la solutionest diffici<strong>le</strong> à obt<strong>en</strong>ir. Il est donc indisp<strong>en</strong>sab<strong>le</strong> de concevoir une méthode adaptée au problème <strong>en</strong>question.5.3 Modélisation de la mission PegaseBeaucoup de détails ont déjà été donnés sur la mission Pegase dans l’introduction, cf. page 10,et nous <strong>en</strong> donnerons plus au fur et à mesure que cette section est parcourue. Par ail<strong>le</strong>urs, Absil [1]donne une description détaillée des objectifs sci<strong>en</strong>tifiques et du fonctionnem<strong>en</strong>t de la mission Pegase.Un point important à savoir est que, dans <strong>le</strong> cadre de la mission Pegase, <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> est séparé <strong>en</strong>deux étages. Le premier étage correspond au contrô<strong>le</strong> des vaisseaux (ou plateformes), tandis que <strong>le</strong>deuxième étage est <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de la charge uti<strong>le</strong> à l’intérieur des vaisseaux.Pour une meil<strong>le</strong>ure compréh<strong>en</strong>sion, nous m<strong>en</strong>tionnons deux exemp<strong>le</strong>s de <strong>bouc<strong>le</strong></strong>s de commande àl’intérieur des vaisseaux (deuxième étage) :1. pilotage de la différ<strong>en</strong>ce de marche grâce à une ligne de retard (actionneur) et un s<strong>en</strong>seur defranges (capteur)2. pilotage de la direction du faisceau optique à l’intérieur du vaisseau avec des miroirs mobi<strong>le</strong>s(actionneurs) et des capteurs d’incid<strong>en</strong>ce des faisceaux optiques (FRAS, capteurs)Les <strong>bouc<strong>le</strong></strong>s internes fourniss<strong>en</strong>t la performance ultime, c’est-à-dire cel<strong>le</strong> nécessaire <strong>pour</strong> effectuer<strong>le</strong>s mesures dans <strong>le</strong> mode nulling.Or, <strong>le</strong>s <strong>bouc<strong>le</strong></strong>s internes demand<strong>en</strong>t une certaine précision <strong>en</strong> termes d’asservissem<strong>en</strong>ts des vaisseauxafin de fonctionner. Par exemp<strong>le</strong>, la ligne à retard a un débattem<strong>en</strong>t de quelques c<strong>en</strong>timètres.Les vaisseaux doiv<strong>en</strong>t être positionnés suffisamm<strong>en</strong>t précisém<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> que la ligne à retard puisse<strong>Commande</strong> <strong>bouc<strong>le</strong></strong> <strong>fermée</strong> <strong>multivariab<strong>le</strong></strong> <strong>pour</strong> <strong>le</strong> <strong>vol</strong> <strong>en</strong> formation de vaisseaux spatiaux