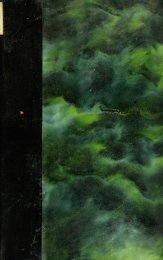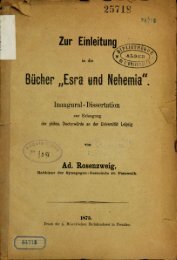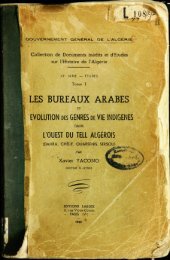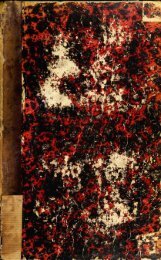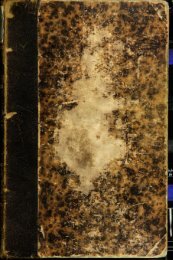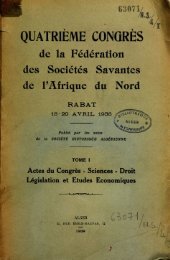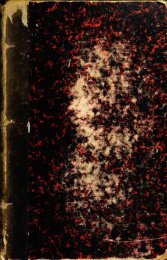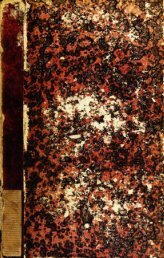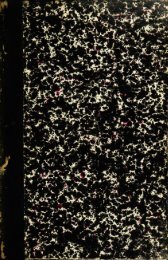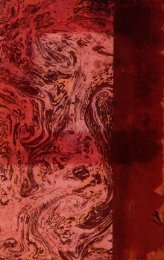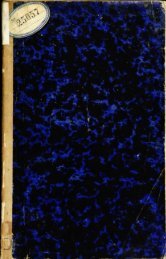You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
166 <strong>SPINOZA</strong> ET LA PENSEE FRANÇAISE<br />
acte gratuit et inexplicable, à la célèbre méthode et à sa rigueur<br />
rationnelle? Comment inscrire le miracle, fait contingent, dans<br />
le mécanisme universel? Comment enfin un esprit aussi logique<br />
pourrait-il exclure le miracle, preuve historique, de sa condam<br />
nation générale de l'histoire, toujours confuse, soumise à l'ima<br />
gination, étrangère à l'entendement? Il n'en est rien pourtant.<br />
Nul n'est plus prudent que ce révolutionnaire. « On a vu Des<br />
cartes déserter une méthode sublime et dès le second pas rai<br />
sonner comme un moine », disait Stendhal (1). Descartes a<br />
revendiqué contre la scolastique les droits de la raison,<br />
mais ce<br />
ne sera en aucun cas contre les droits de la divinité. Nous sommes<br />
finis, Dieu est infini; donc il pense et agit sans que notre raison<br />
puisse le comprendre : « Nous ne devons pas trouver étrange<br />
qu'il y ait, dans sa nature qui est immense et en ce qu'il a fait,<br />
beaucoup de choses qui surpassent la capacité de notre esprit (2). »<br />
Dès lors, une cloison étanche est dressée entre la foi et la raison,<br />
entre l'histoire et la science. La seconde satisfait seule notre<br />
entendement; mais à la première, Descartes accorde néanmoins<br />
une crédibilité appuyée sur l'autorité établie et l'illumination<br />
de la grâce. Il n'y a donc aucune raison de mettre en doute le<br />
miracle. Descartes l'accepte les yeux fermés. Dieu peut, quand il<br />
le veut, et par simple « promulgation », rompre l'ordre de la<br />
nature et créer ce qu'il lui plaît. Car, « à quoi servirait l'infinie<br />
puissance de cet infini imaginaire s'il ne pouvait jamais rien<br />
créer (3) ». « Puisque Dieu est infini, ce n'est pas à moi à pres<br />
crire aucune fin à ses ouvrages (4). » En un mot, le Père La<br />
Berthonnière résume (5) cette doctrine implicite : « Pour qu'il<br />
y ait miracle, il suffit que Dieu se détermine à faire quelque chose<br />
autrement que conformément aux lois selon lesquelles il a<br />
constitué le monde. »<br />
Mais Descartes n'est pas un théologien médiéval. D'autres<br />
avant lui avaient proclamé l'exclusion réciproque de la foi par<br />
la science et de la science par la foi. Mais les théologiens antérieurs<br />
avaient pour but de diminuer la science. Au contraire, Descartes<br />
ne pratique cette tolérance respectueuse à l'égard du miracle<br />
et des autres vérités de foi que par une désaffection réelle; son<br />
séparatisme est au fond une exaltation de la science, qui tendait<br />
(1) Histoire de la peinture en Italie, Épilogue (cité par Alain, Stendhal,<br />
Paris, Rieder, 1935, p. 15).<br />
(2) Principes, 1" partie, t. IX, p. 35-36 (édit. Adam-Tannery, Hachette).<br />
(3) Secondes réponses (ibid., t. IX, p. 111).<br />
(4) Lettre à Clerselier (23 avril 1649, ibid., t. V, p. 355).<br />
(5) La Religion de Descartes (in Annales de Philosophie juillet-<br />
chrétienne,<br />
septiimbre 1911, p. 384).