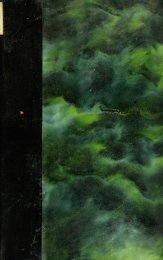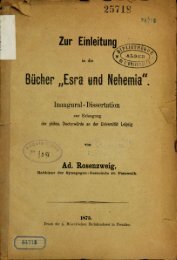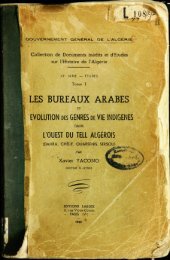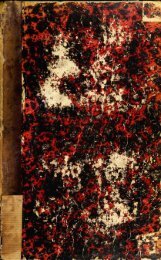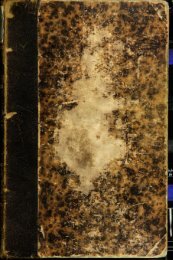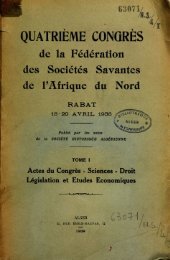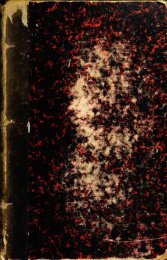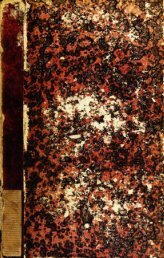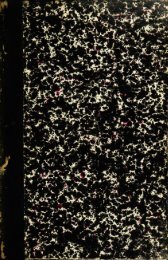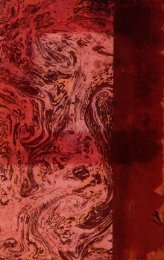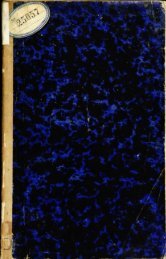You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
80 <strong>SPINOZA</strong> ET LA PENSÉE FRANÇAISE<br />
d'Idumée voit devant lui la mer chassée par le vent, il n'y a pas<br />
miracle, car Alexandre ne l'a pas prévu et n'en a pas été informé.<br />
Ce n'est pas le cas de Moïse franchissant la mer Rouge : « Si les<br />
faits miraculeux étaient des effets extraordinaires de causes<br />
naturelles mais inconnues, il est visible qu'on ne les pourrait pas<br />
prévoir (1). » Tels sont tous les miracles du Christ et surtout la<br />
Résurrection. Dès lors, Jean Leclerc, sans s'en rendre compte,<br />
édifie une doctrine solide que l'orthodoxie catholique reprendra<br />
plus tard (2) : le miracle est un prodige appuyé sur une prophétie;<br />
le miracle n'est pas seulement un prodige, mais un signe.<br />
Jean Leclerc ne va pas plus loin, mais il marque clairement<br />
la limite de son rationalisme. Alors que Spinoza prétend nier<br />
le miracle au nom d'une philosophie déterministe, le professeur<br />
d'Amsterdam demeure fidèle à l'histoire. Il ne s'agit pas de<br />
démontrer rationnellement l'impossibilité du miracle, mais d'éta<br />
blir des faits et de critiquer les témoignages. Mais ce que, dans<br />
la candeur de sa foi, Leclerc ne veut pas faire, sera l'ouvrage de<br />
Fontenelle et de Voltaire en France, de Toland et de Woolston<br />
en Angleterre.<br />
Avec une étonnante loyauté intellectuelle, Jean Leclerc a<br />
essayé sinon de concilier,<br />
du moins de sauvegarder les exigences<br />
critiques de sa raison et le fondement précieux d'une foi que,<br />
somme toute, comme beaucoup de réformés, il place beaucoup<br />
plus dans le témoignage intérieur de l'Esprit Saint que dans une<br />
légalité d'ordre juridique. C'est cela surtout qui le heurte chez<br />
Richard Simon. Mais en face de Spinoza, son attitude est révé<br />
latrice. Il le connaît à fond et le suit, même quand il l'injurie le<br />
plus, tant qu'il demeure fidèle à sa méthode d'exégèse fondée<br />
sur l'histoire et sur la philologie : c'était d'ailleurs demeurer<br />
dans l'esprit de l'arminianisme et continuer l'œuvre critique de<br />
Grotius et d'Episcopius. Mais lorsque au-dessus Spinoza, des<br />
humbles conclusions de l'exégèse prétend biblique, fonder une<br />
doctrine rationnelle du miracle sous-tendue par le déterminisme<br />
de l'Éthique, Leclerc, au nom de sa foi, mais aussi au nom de la<br />
méthode historique, reprend sa liberté (3), donnant par là au<br />
(1) De Fincrédulité..., p. 362 (Leclerc avait déjà reproché à R. Simon l'as<br />
similation scandaleuse des deux miracles dans ses Sentimens de quelques<br />
théologiens, 4° lettre, p. 76).<br />
(2) Dictionnaire apologétique de la foi catholique (édit. d'Alès, Beauchesne,<br />
Paris, 1919, article Miracle).<br />
(3) En 1705, Leclerc sera plus dédaigneux encore : « Je sais que l'auteur<br />
du Traité théologico-politique prétend que les miracles ne sont que des effets<br />
extraordinaires de la nature et que s'il se faisait quelque chose qui fût<br />
au-dessus de ses forces, cela affaiblirait plutôt la créance que nous avons