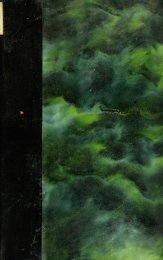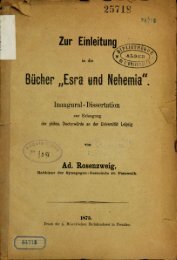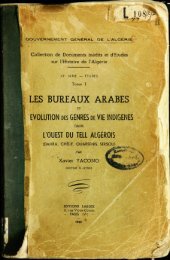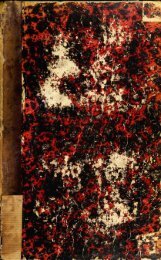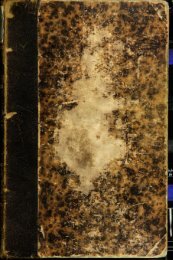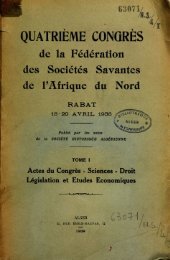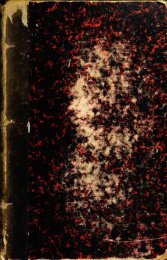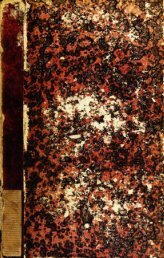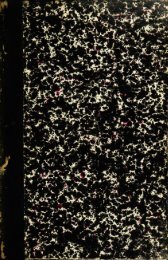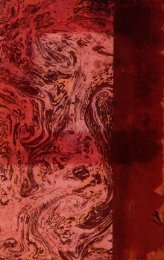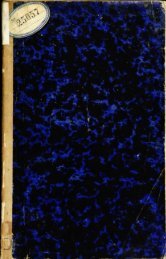Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BAYLE ET BOULAINVILLER 289<br />
ne savent choisir entre Bayle critique de l'Éthique et Bayle défen<br />
seur de l'athée vertueux; les modernes s'étonnent du heurt de<br />
deux pensées libres dont l'influence historique devait rapide<br />
ment devenir convergente. Peut-on encore accepter que la pen<br />
sée baylienne manque d'unité, peut-on prendre ses prudences<br />
et ses indécisions pour des condamnations? Dans la mesure où<br />
l'interprétation baylienne du spinozisme paraîtra définitive aux<br />
esprits français et même encore à l'école cousinienne (1), il est<br />
nécessaire d'en reprendre l'étude et d'en séparer définitivement,<br />
à la lumière de toute une œuvre, la part évidente de sincérité<br />
et la part plus mystérieuse d'une habile tactique.<br />
Il est possible que le jeune « proposant » qu'était Bayle à<br />
et qui suivait avec passion l'exégèse<br />
Genève, féru de livres,<br />
biblique de son maître Sartory, ait entendu parler du Tracta<br />
tus. Au cours d'un séjour à Rouen auprès de M. Le Moine,<br />
érudit hébraïsant, à la fin de l'année 1674, ou lors de son stage<br />
de précepteur à Paris, au printemps de 1675 chez M. de Béringhen,<br />
les échos du livre impie sont peut être arrivés jusqu'à<br />
lui. Sa correspondance ne permet pas de l'affirmer. Ses thèses<br />
de Sedan, rédigées en 1675 et soutenues en 1676, ne pouvaient<br />
faire aucune allusion à la doctrine inconnue de l'Éthique que<br />
devaient révéler l'année suivante les Opéra Posthuma (2). C'est<br />
dans une lettre à son frère aîné, datée de Sedan, le 29 novembre<br />
1677, que nous trouvons la première référence à Spinoza : « On<br />
a imprimé en Hollande une réponse à ce livre qui a fait tant<br />
de bruit et dans lequel on traite d'une manière si impie des<br />
affaires de la religion. Vous comprenez bien que je parle du<br />
Tractatus iheologo-politicus (sic), fait par un Juif espagnol<br />
nommé Spinoza, si je ne me trompe. La réponse dont je parle<br />
phique, 1882, t. XIII, p. 109), est très rapide sur la question; celui de F. Pillon,<br />
La critique de Bayle du panthéisme spinoziste (in Année philosophique,<br />
1899), dénué de tout sens historique, relève du kantisme universitaire. Seul<br />
M. Delvolvé (Essai sur Pierre Bayle, Paris, Alcan, 1906, p. 259 sq.) a<br />
quelques remarquables intuitions.<br />
(1) C'est le cas de Bouillier, Histoire de la philosophie cartésienne (Paris,<br />
1854, t. II), et de Nourrisson, Spinoza et le naturalisme contemporain<br />
(Paris, 1866).<br />
(2) Le passage suivant des Thèses philosophiques, reproduit dans le<br />
Recueil de quelques pièces curieuses concernant la philosophie de M Descaries<br />
(Amsterdam, Desbordes, 1684), est un remaniement du cours de Sedan, car<br />
l'Éthique, I, 14, y est citée : « Spinoza qui, dans un ouvrage posthume,<br />
obscur et embarrassé au dernier point, obscurissimo et intricatissimo, n'a<br />
pas fait difficulté d'avouer qu'il ne peut y avoir et qu'on ne saurait concevoir<br />
qu'une seule substance qu'on appelle Dieu » (Œuvres diverses, t. IV, p. 134).<br />
Y, VERNIÈRE, I<br />
*°