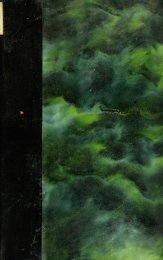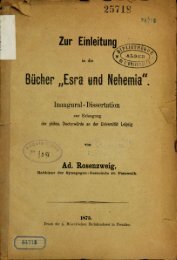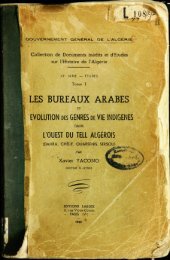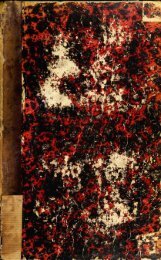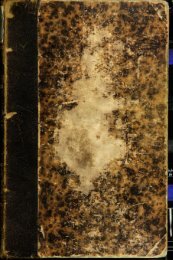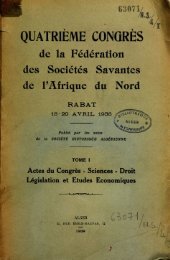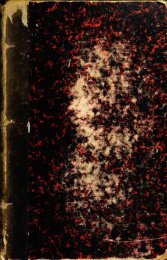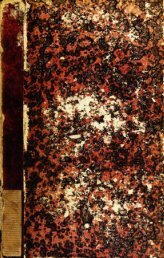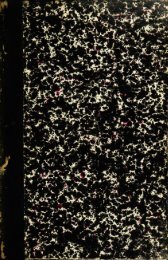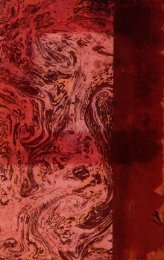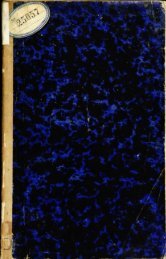Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
178 <strong>SPINOZA</strong> ET LA PENSÉE FRANÇAISE<br />
possible et Spinoza « ignorait les suites de son principe lorsqu'il<br />
disait (on m'a affirmé qu'il disait cela à ses amis) que, s'il eût<br />
pu se persuader la résurrection de Lazare, il aurait brisé en<br />
pièces tout son système (1) ».<br />
N'insistons pas. Il est certain que l'antipathie de Bayle pour<br />
le panthéisme spinoziste, que d'ailleurs il ne comprend guère,<br />
est sincère. L'occasion est belle d'étaler son zèle contre un athée<br />
pour excuser ses propres hardiesses. Bayle, au sujet du miracle,<br />
se replie donc sur une position cartésienne modérée;<br />
son ratio<br />
nalisme, étayé sur le sens commun, l'éloigné des subtilités gnostiques<br />
de Malebranche et de ses interventions angéliques pour<br />
préserver le déterminisme divin. Mais quelle est la valeur pro<br />
fonde de cette orthodoxie? Quelle est la mesure de sa sincérité?<br />
Quelles sont les limites de sa prudence? Avec quel soin ne pré-<br />
cise-t-il pas dans le Dictionnaire le domaine réservé qu'il ne<br />
veut pas entamer! Le miracle est possible, certes, mais unique<br />
ment dans le monde de l'Écriture Sainte (2). Et pour Bayle,<br />
comme pour Spinoza, comme pour Balthasar Bekker (3), le<br />
but essentiel du philosophe est de « désenchanter » le monde,<br />
à savoir le nôtre.<br />
Il faut donc avouer que le problème du miracle n'est abordé<br />
en France qu'avec beaucoup de réserve et de pudeur; les esprits<br />
religieux se méfient de toute controverse sur ce sujet délicat<br />
et les libertins n'y font que des allusions détournées. Au fond,<br />
un même rationalisme les unit dont la source est Descartes. Il<br />
fallait un franc-tireur pour attaquer Spinoza de front, pour mettre<br />
au jour les impiétés du VIe chapitre du Tractatus : ce fut Pierre-<br />
Valentin Faydit. Né à Riom en 1644 et petit-neveu du R. P. Sir-<br />
mond confesseur du roi, entré à dix-huit ans à l'Oratoire, il se<br />
fit remarquer très tôt par la singularité de sa conduite et de ses<br />
opinions. En 1669, ses supérieurs faillirent l'exclure et s'y<br />
résolvent en 1671. Esprit sans profondeur, d'une érudition fan<br />
taisiste, très caustique, il adore la polémique. Toute querelle<br />
théologique le met en joie, excite sa verve, provoque ses bons<br />
mots et ses anecdotes méchantes. Somme toute, une caricature<br />
(1) Dictionnaire critique.<br />
(2) Ibid. : « Je veux dire, afin d'ôter toute équivoque, la possibilité des<br />
événements racontés dans l'Écriture. »<br />
(3) De betoverde Weereld, Leuwarden, 1691 (traduit e* édité à Amster<br />
dam en 1694 sous le titre le Monde enchanté).