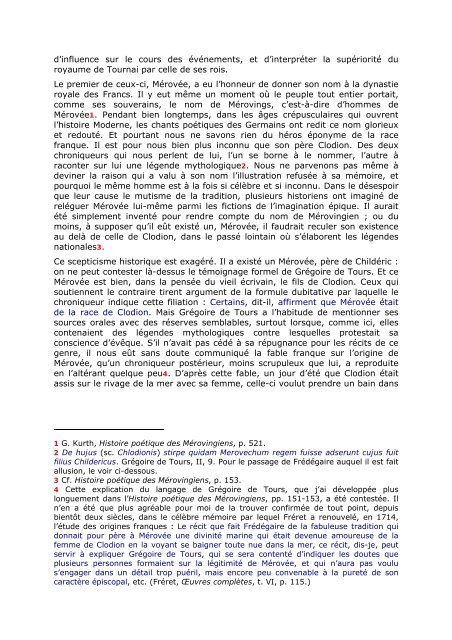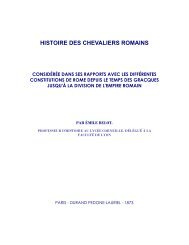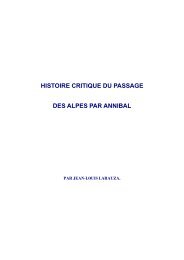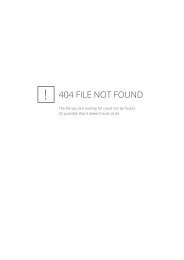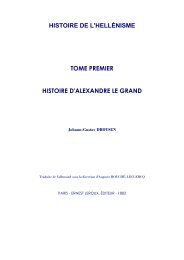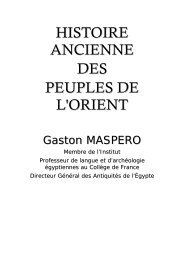clovis - L'Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée
clovis - L'Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée
clovis - L'Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
d’influence sur le cours <strong><strong>de</strong>s</strong> événements, <strong>et</strong> d’interpréter <strong>la</strong> supériorité du<br />
royaume <strong>de</strong> Tournai par celle <strong>de</strong> ses rois.<br />
Le premier <strong>de</strong> ceux-ci, Mérovée, a eu l’honneur <strong>de</strong> donner son nom à <strong>la</strong> dynastie<br />
royale <strong><strong>de</strong>s</strong> Francs. Il y eut même un moment où le peuple tout entier portait,<br />
comme ses souverains, le nom <strong>de</strong> Mérovings, c’est-à-dire d’<strong>hommes</strong> <strong>de</strong><br />
Mérovée1. Pendant bien longtemps, dans les âges crépuscu<strong>la</strong>ires qui ouvrent<br />
l’histoire Mo<strong>de</strong>rne, les chants poétiques <strong><strong>de</strong>s</strong> Germains ont redit ce nom glorieux<br />
<strong>et</strong> redouté. Et pourtant nous ne savons rien du héros éponyme <strong>de</strong> <strong>la</strong> race<br />
franque. Il est pour nous bien plus inconnu que son père Clodion. Des <strong>de</strong>ux<br />
chroniqueurs qui nous perlent <strong>de</strong> lui, l’un se borne à le nommer, l’autre à<br />
raconter sur lui une légen<strong>de</strong> mythologique2. Nous ne parvenons pas même à<br />
<strong>de</strong>viner <strong>la</strong> raison qui a valu à son nom l’illustration refusée à sa mémoire, <strong>et</strong><br />
pourquoi le même homme est à <strong>la</strong> fois si célèbre <strong>et</strong> si inconnu. Dans le désespoir<br />
que leur cause le mutisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradition, plusieurs historiens ont imaginé <strong>de</strong><br />
reléguer Mérovée lui-même parmi les fictions <strong>de</strong> l’imagination épique. Il aurait<br />
été simplement inventé pour rendre compte du nom <strong>de</strong> Mérovingien ; ou du<br />
moins, à supposer qu’il eût existé un, Mérovée, il faudrait reculer son existence<br />
au <strong>de</strong>là <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> Clodion, dans le passé lointain où s’é<strong>la</strong>borent les légen<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
nationales3.<br />
Ce scepticisme historique est exagéré. Il a existé un Mérovée, père <strong>de</strong> Childéric :<br />
on ne peut contester là-<strong><strong>de</strong>s</strong>sus le témoignage formel <strong>de</strong> Grégoire <strong>de</strong> Tours. Et ce<br />
Mérovée est bien, dans <strong>la</strong> pensée du vieil écrivain, le fils <strong>de</strong> Clodion. Ceux qui<br />
soutiennent le contraire tirent argument <strong>de</strong> <strong>la</strong> formule dubitative par <strong>la</strong>quelle le<br />
chroniqueur indique c<strong>et</strong>te filiation : Certains, dit-il, affirment que Mérovée était<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> race <strong>de</strong> Clodion. Mais Grégoire <strong>de</strong> Tours a l’habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> mentionner ses<br />
sources orales avec <strong><strong>de</strong>s</strong> réserves semb<strong>la</strong>bles, surtout lorsque, comme ici, elles<br />
contenaient <strong><strong>de</strong>s</strong> légen<strong><strong>de</strong>s</strong> mythologiques contre lesquelles protestait sa<br />
conscience d’évêque. S’il n’avait pas cédé à sa répugnance pour les récits <strong>de</strong> ce<br />
genre, il nous eût sans doute communiqué <strong>la</strong> fable franque sur l’origine <strong>de</strong><br />
Mérovée, qu’un chroniqueur postérieur, moins scrupuleux que lui, a reproduite<br />
en l’altérant quelque peu4. D’après c<strong>et</strong>te fable, un jour d’été que Clodion était<br />
assis sur le rivage <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer avec sa femme, celle-ci voulut prendre un bain dans<br />
1 G. Kurth, Histoire poétique <strong><strong>de</strong>s</strong> Mérovingiens, p. 521.<br />
2 De hujus (sc. Chlodionis) stirpe quidam Merovechum regem fuisse adserunt cujus fuit<br />
filius Chil<strong>de</strong>ricus. Grégoire <strong>de</strong> Tours, II, 9. Pour le passage <strong>de</strong> Frédégaire auquel il est fait<br />
allusion, le voir ci-<strong><strong>de</strong>s</strong>sous.<br />
3 Cf. Histoire poétique <strong><strong>de</strong>s</strong> Mérovingiens, p. 153.<br />
4 C<strong>et</strong>te explication du <strong>la</strong>ngage <strong>de</strong> Grégoire <strong>de</strong> Tours, que j’ai développée plus<br />
longuement dans l’Histoire poétique <strong><strong>de</strong>s</strong> Mérovingiens, pp. 151-153, a été contestée. Il<br />
n’en a été que plus agréable pour moi <strong>de</strong> <strong>la</strong> trouver confirmée <strong>de</strong> tout point, <strong>de</strong>puis<br />
bientôt <strong>de</strong>ux siècles, dans le célèbre mémoire par lequel Frér<strong>et</strong> a renouvelé, en 1714,<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> origines franques : Le récit que fait Frédégaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> fabuleuse tradition qui<br />
donnait pour père à Mérovée une divinité marine qui était <strong>de</strong>venue amoureuse <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
femme <strong>de</strong> Clodion en <strong>la</strong> voyant se baigner toute nue dans <strong>la</strong> mer, ce récit, dis-je, peut<br />
servir à expliquer Grégoire <strong>de</strong> Tours, qui se sera contenté d’indiquer les doutes que<br />
plusieurs personnes formaient sur <strong>la</strong> légitimité <strong>de</strong> Mérovée, <strong>et</strong> qui n’aura pas voulu<br />
s’engager dans un détail trop puéril, mais encore peu convenable à <strong>la</strong> pur<strong>et</strong>é <strong>de</strong> son<br />
caractère épiscopal, <strong>et</strong>c. (Frér<strong>et</strong>, Œuvres complètes, t. VI, p. 115.)