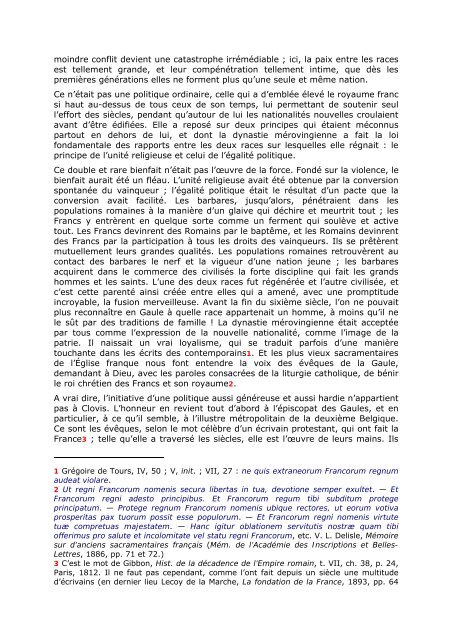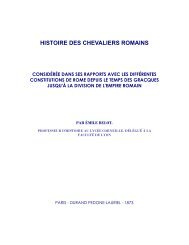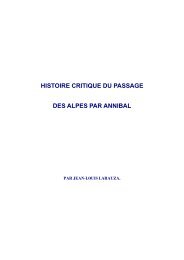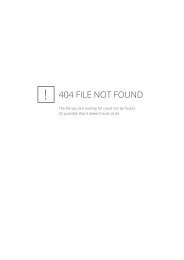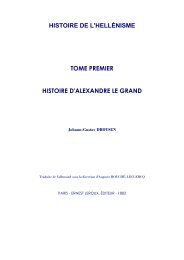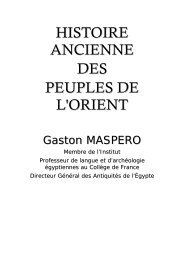clovis - L'Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée
clovis - L'Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée
clovis - L'Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
moindre conflit <strong>de</strong>vient une catastrophe irrémédiable ; ici, <strong>la</strong> paix entre les races<br />
est tellement gran<strong>de</strong>, <strong>et</strong> leur compénétration tellement intime, que dès les<br />
premières générations elles ne forment plus qu’une seule <strong>et</strong> même nation.<br />
Ce n’était pas une politique ordinaire, celle qui a d’emblée élevé le royaume franc<br />
si haut au-<strong><strong>de</strong>s</strong>sus <strong>de</strong> tous ceux <strong>de</strong> son temps, lui perm<strong>et</strong>tant <strong>de</strong> soutenir seul<br />
l’effort <strong><strong>de</strong>s</strong> siècles, pendant qu’autour <strong>de</strong> lui les nationalités nouvelles crou<strong>la</strong>ient<br />
avant d’être édifiées. Elle a reposé sur <strong>de</strong>ux principes qui étaient méconnus<br />
partout en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> lui, <strong>et</strong> dont <strong>la</strong> dynastie mérovingienne a fait <strong>la</strong> loi<br />
fondamentale <strong><strong>de</strong>s</strong> rapports entre les <strong>de</strong>ux races sur lesquelles elle régnait : le<br />
principe <strong>de</strong> l’unité religieuse <strong>et</strong> celui <strong>de</strong> l’égalité politique.<br />
Ce double <strong>et</strong> rare bienfait n’était pas l’œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> force. Fondé sur <strong>la</strong> violence, le<br />
bienfait aurait été un fléau. L’unité religieuse avait été obtenue par <strong>la</strong> conversion<br />
spontanée du vainqueur ; l’égalité politique était le résultat d’un pacte que <strong>la</strong><br />
conversion avait facilité. Les barbares, jusqu’alors, pénétraient dans les<br />
popu<strong>la</strong>tions romaines à <strong>la</strong> manière d’un g<strong>la</strong>ive qui déchire <strong>et</strong> meurtrit tout ; les<br />
Francs y entrèrent en quelque sorte comme un ferment qui soulève <strong>et</strong> active<br />
tout. Les Francs <strong>de</strong>vinrent <strong><strong>de</strong>s</strong> Romains par le baptême, <strong>et</strong> les Romains <strong>de</strong>vinrent<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> Francs par <strong>la</strong> participation à tous les droits <strong><strong>de</strong>s</strong> vainqueurs. Ils se prêtèrent<br />
mutuellement leurs gran<strong><strong>de</strong>s</strong> qualités. Les popu<strong>la</strong>tions romaines r<strong>et</strong>rouvèrent au<br />
contact <strong><strong>de</strong>s</strong> barbares le nerf <strong>et</strong> <strong>la</strong> vigueur d’une nation jeune ; les barbares<br />
acquirent dans le commerce <strong><strong>de</strong>s</strong> civilisés <strong>la</strong> forte discipline qui fait les grands<br />
<strong>hommes</strong> <strong>et</strong> les saints. L’une <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux races fut régénérée <strong>et</strong> l’autre civilisée, <strong>et</strong><br />
c’est c<strong>et</strong>te parenté ainsi créée entre elles qui a amené, avec une promptitu<strong>de</strong><br />
incroyable, <strong>la</strong> fusion merveilleuse. Avant <strong>la</strong> fin du sixième siècle, l’on ne pouvait<br />
plus reconnaître en Gaule à quelle race appartenait un homme, à moins qu’il ne<br />
le sût par <strong><strong>de</strong>s</strong> traditions <strong>de</strong> famille ! La dynastie mérovingienne était acceptée<br />
par tous comme l’expression <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle nationalité, comme l’image <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
patrie. Il naissait un vrai loyalisme, qui se traduit parfois d’une manière<br />
touchante dans les écrits <strong><strong>de</strong>s</strong> contemporains1. Et les plus vieux sacramentaires<br />
<strong>de</strong> l’Église franque nous font entendre <strong>la</strong> voix <strong><strong>de</strong>s</strong> évêques <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gaule,<br />
<strong>de</strong>mandant à Dieu, avec les paroles consacrées <strong>de</strong> <strong>la</strong> liturgie catholique, <strong>de</strong> bénir<br />
le roi chrétien <strong><strong>de</strong>s</strong> Francs <strong>et</strong> son royaume2.<br />
A vrai dire, l’initiative d’une politique aussi généreuse <strong>et</strong> aussi hardie n’appartient<br />
pas à Clovis. L’honneur en revient tout d’abord à l’épiscopat <strong><strong>de</strong>s</strong> Gaules, <strong>et</strong> en<br />
particulier, à ce qu’il semble, à l’illustre métropolitain <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième Belgique.<br />
Ce sont les évêques, selon le mot célèbre d’un écrivain protestant, qui ont fait <strong>la</strong><br />
France3 ; telle qu’elle a traversé les siècles, elle est l’œuvre <strong>de</strong> leurs mains. Ils<br />
1 Grégoire <strong>de</strong> Tours, IV, 50 ; V, init. ; VII, 27 : ne quis extraneorum Francorum regnum<br />
au<strong>de</strong>at vio<strong>la</strong>re.<br />
2 Ut regni Francorum nomenis secura libertas in tua, <strong>de</strong>votione semper exult<strong>et</strong>. — Et<br />
Francorum regni a<strong><strong>de</strong>s</strong>to principibus. Et Francorum regum tibi subditum protege<br />
principatum. — Protege regnum Francorum nomenis ubique rectores, ut eorum votiva<br />
prosperitas pax tuorum possit esse populorum. — Et Francorum regni nomenis virtute<br />
tuæ compr<strong>et</strong>uas majestatem. — Hanc igitur ob<strong>la</strong>tionem servitutis nostræ quam tibi<br />
offerimus pro salute <strong>et</strong> incolomitate vel statu regni Francorum, <strong>et</strong>c. V. L. Delisle, Mémoire<br />
sur d’anciens sacramentaires français (Mém. <strong>de</strong> l’Académie <strong><strong>de</strong>s</strong> Inscriptions <strong>et</strong> Belles-<br />
L<strong>et</strong>tres, 1886, pp. 71 <strong>et</strong> 72.)<br />
3 C’est le mot <strong>de</strong> Gibbon, Hist. <strong>de</strong> <strong>la</strong> déca<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> l’Empire romain, t. VII, ch. 38, p. 24,<br />
Paris, 1812. Il ne faut pas cependant, comme l’ont fait <strong>de</strong>puis un siècle une multitu<strong>de</strong><br />
d’écrivains (en <strong>de</strong>rnier lieu Lecoy <strong>de</strong> <strong>la</strong> Marche, La fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> France, 1893, pp. 64