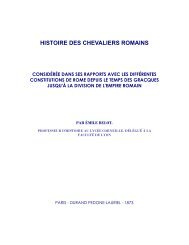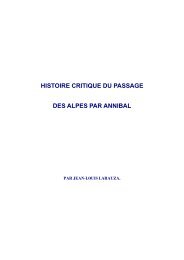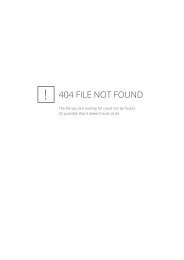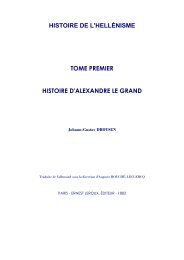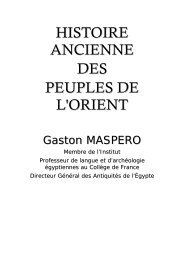clovis - L'Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée
clovis - L'Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée
clovis - L'Histoire antique des pays et des hommes de la Méditerranée
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>de</strong> tous ceux du sixième siècle, se communiqua au monastère <strong>et</strong> à <strong>la</strong> montagne<br />
elle-même. Du haut <strong>de</strong> sa colline, Geneviève fut <strong>la</strong> patronne céleste <strong>de</strong> Paris<br />
adolescent ; <strong>de</strong> là, comme un phare tranquille <strong>et</strong> lumineux, sa pure <strong>et</strong> touchante<br />
mémoire bril<strong>la</strong> sur <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> ville qu’elle aimait, <strong>et</strong> sur <strong>la</strong> dynastie dont le<br />
fondateur reposait à son ombre, comme un client fidèle. Aucune gloire française<br />
n’est composée <strong>de</strong> rayons plus purs ; aucune n’a pénétré à une telle profon<strong>de</strong>ur<br />
dans l’âme du peuple, pas même celle <strong>de</strong> Jeanne d’Arc, c<strong>et</strong>te Geneviève du<br />
quinzième siècle ; sœur cad<strong>et</strong>te <strong>de</strong> <strong>la</strong> vierge <strong>de</strong> Paris. Quoi d’étonnant si, dès les<br />
premières générations après sa mort, elle était pour <strong>la</strong> foule <strong>la</strong> seule habitante<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> basilique du mont Lutèce, tandis que le tombeau <strong>de</strong> Clovis, isolé <strong>de</strong> <strong>la</strong> série<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> sépultures royales qui s’alignaient à Saint-Denis, s’oubliait peu à peu <strong>et</strong> ne<br />
fut bientôt plus connu que <strong><strong>de</strong>s</strong> moines qui le gardaient ?<br />
Que <strong>de</strong>vinrent les sarcophages royaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> crypte <strong>de</strong> Sainte-Geneviève, <strong>et</strong> que<br />
<strong>de</strong>vint en particulier celui <strong>de</strong> Clovis ? Abandonné aux heures du danger par les<br />
moines, qui fuyaient avec <strong>la</strong> châsse <strong>de</strong> <strong>la</strong> sainte, il resta exposé trois fois en un<br />
siècle aux outrages <strong><strong>de</strong>s</strong> Normands, qui vinrent piller les environs <strong>de</strong> Paris en 845,<br />
en 857 <strong>et</strong> en 885. Fut-il violé à l’une <strong>de</strong> ces occasions, ou les cendres<br />
échappèrent-elles à <strong>la</strong> triple profanation du sanctuaire ? Nous l’ignorons ; mais<br />
les multiples tourmentes du neuvième siècle <strong>et</strong> <strong>la</strong> sécu<strong>la</strong>risation <strong><strong>de</strong>s</strong> chanoines<br />
au dixième ne durent pas augmenter à Sainte-Geneviève <strong>la</strong> sollicitu<strong>de</strong> pour un<br />
souvenir qui n’était pas protégé contre l’oubli par l’auréole <strong>de</strong> <strong>la</strong> saint<strong>et</strong>é.<br />
C’est seulement au’ douzième siècle, quand une réforme profon<strong>de</strong> <strong>et</strong> salutaire<br />
eut rappelé les chanoines réguliers dans le cloître tombé en déca<strong>de</strong>nce, qu’on se<br />
souvint enfin du trésor national que <strong>la</strong> France avait confié à <strong>la</strong> gar<strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Génovéfains. L’illustre abbé Étienne <strong>de</strong> Tournai, qui gouverna <strong>la</strong> communauté <strong>de</strong><br />
1176 à 1191, consacra ses quinze années <strong>de</strong> pré<strong>la</strong>ture à <strong>la</strong> restauration morale<br />
<strong>et</strong> matérielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> maison. Le sanctuaire portait encore les traces <strong>la</strong>mentables<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> profanations d’autrefois ; sur les murs calcinés apparaissaient par espaces<br />
les restes <strong><strong>de</strong>s</strong> mosaïques primitives. Étienne répara ces ruines, orna l’église d’un<br />
nouveau p<strong>la</strong>fond <strong>la</strong>mbrissé, <strong>et</strong> couvrit le tout d’une toiture <strong>de</strong> plomb1. Par ses<br />
soins, le tombeau <strong>de</strong> Clovis fut transporté dans l’église supérieure à l’entrée du<br />
chœur. C’était un monument d’élévation médiocre, sur lequel était couchée <strong>la</strong><br />
statue <strong>de</strong> ce roi2. La base en était ornée d’une inscription en vers <strong>la</strong>tins, due à <strong>la</strong><br />
plume d’Étienne lui-même3. Ce mausolée subsista pendant plusieurs siècles dans<br />
1 Sur les travaux d’Étienne à Sainte-Geneviève, il faut lire sa propre correspondance,<br />
l<strong>et</strong>tres 176, 177, 178, 181 <strong>et</strong> 182, édition Desilve, Paris-Valenciennes, 1893.<br />
2 Étienne ne parle pas <strong>de</strong> ce tombeau, mais il est décrit comme un monument <strong>de</strong> peu<br />
d’élévation avec une statue royale couchée <strong><strong>de</strong>s</strong>sus, par Lejuge, l’Histoire <strong>de</strong> sainte<br />
Geneviefve, patronne <strong>de</strong> Paris, 1586, fol. 174, verso, <strong>et</strong> par Dubreuil, le Théâtre <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
antiguitez <strong>de</strong> Paris, 1612, p. 271, qui donne une reproduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> statue, p. 272.<br />
3 C<strong>et</strong>te inscription, faussement attribuée à saint Remi, se trouve dans un manuscrit<br />
d’Aimoin du quatorzième siècle (Bibliothèque nationale, manuscrit 5925, ancien fonds<br />
<strong>la</strong>tin) : mais les meilleurs manuscrits <strong>de</strong> c<strong>et</strong> auteur ne <strong>la</strong> contiennent pas, <strong>et</strong> elle n’est<br />
manifestement pas <strong>de</strong> lui, quoi qu’en dise l’Histoire littéraire, t. III, p. 161 (voir dom<br />
Bouqu<strong>et</strong>, t. II, p. 538, note, <strong>et</strong> t. III, p. 44, note). Elle a donc été composée entre le<br />
onzième <strong>et</strong> le quatorzième siècle. De plus, elle s’est réellement trouvée sur le tombeau<br />
<strong>de</strong> Clovis, où l’a vue Robert Gaguin, Compendium super gestis Francorum, fol. 6, verso.<br />
Nous savons en outre qu’Étienne était poète ; v. sur ce point ses propres paroles dans<br />
ses l<strong>et</strong>tres 43 (au cardinal Pierre <strong>de</strong> Tusculum), <strong>et</strong> 277 (à l’abbé <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sauve). Nous<br />
possédons <strong>de</strong> lui l’épitaphe du roi Louis VII (Desilve, L<strong>et</strong>tres d’Étienne <strong>de</strong> Tournai, p.<br />
443) <strong>et</strong> celle <strong>de</strong> Maurice <strong>de</strong> Sully, évêque <strong>de</strong> Paris. Il a composé aussi un office <strong>de</strong> saint