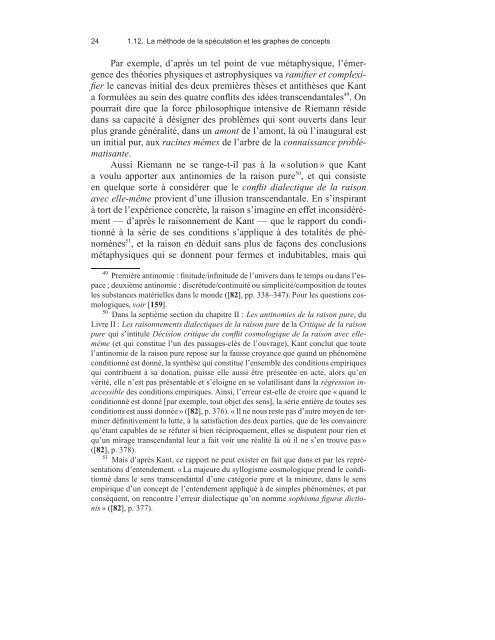Sophus Lie, Friedrich Engel et le problème de Riemann ... - DMA - Ens
Sophus Lie, Friedrich Engel et le problème de Riemann ... - DMA - Ens
Sophus Lie, Friedrich Engel et le problème de Riemann ... - DMA - Ens
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
24 1.12. La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> la spéculation <strong>et</strong> <strong>le</strong>s graphes <strong>de</strong> conceptsPar exemp<strong>le</strong>, d’après un tel point <strong>de</strong> vue métaphysique, l’émergence<strong>de</strong>s théories physiques <strong>et</strong> astrophysiques va ramifier <strong>et</strong> comp<strong>le</strong>xifier<strong>le</strong> canevas initial <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premières thèses <strong>et</strong> antithèses que Kanta formulées au sein <strong>de</strong>s quatre conflits <strong>de</strong>s idées transcendanta<strong>le</strong>s 49 . Onpourrait dire que la force philosophique intensive <strong>de</strong> <strong>Riemann</strong> rési<strong>de</strong>dans sa capacité à désigner <strong>de</strong>s problèmes qui sont ouverts dans <strong>le</strong>urplus gran<strong>de</strong> généralité, dans un amont <strong>de</strong> l’amont, là où l’inaugural estun initial pur, aux racines mêmes <strong>de</strong> l’arbre <strong>de</strong> la connaissance problématisante.Aussi <strong>Riemann</strong> ne se range-t-il pas à la « solution » que Kanta voulu apporter aux antinomies <strong>de</strong> la raison pure 50 , <strong>et</strong> qui consisteen quelque sorte à considérer que <strong>le</strong> conflit dia<strong>le</strong>ctique <strong>de</strong> la raisonavec el<strong>le</strong>-même provient d’une illusion transcendanta<strong>le</strong>. En s’inspirantà tort <strong>de</strong> l’expérience concrète, la raison s’imagine en eff<strong>et</strong> inconsidérément— d’après <strong>le</strong> raisonnement <strong>de</strong> Kant — que <strong>le</strong> rapport du conditionnéà la série <strong>de</strong> ses conditions s’applique à <strong>de</strong>s totalités <strong>de</strong> phénomènes51 , <strong>et</strong> la raison en déduit sans plus <strong>de</strong> façons <strong>de</strong>s conclusionsmétaphysiques qui se donnent pour fermes <strong>et</strong> indubitab<strong>le</strong>s, mais qui49 Première antinomie : finitu<strong>de</strong>/infinitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’univers dans <strong>le</strong> temps ou dans l’espace; <strong>de</strong>uxième antinomie : discrétu<strong>de</strong>/continuité ou simplicité/composition <strong>de</strong> toutes<strong>le</strong>s substances matériel<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> ([82], pp. 338–347). Pour <strong>le</strong>s questions cosmologiques,voir [159].50 Dans la septième section du chapitre II : Les antinomies <strong>de</strong> la raison pure, duLivre II : Les raisonnements dia<strong>le</strong>ctiques <strong>de</strong> la raison pure <strong>de</strong> la Critique <strong>de</strong> la raisonpure qui s’intitu<strong>le</strong> Décision critique du conflit cosmologique <strong>de</strong> la raison avec el<strong>le</strong>même(<strong>et</strong> qui constitue l’un <strong>de</strong>s passages-clés <strong>de</strong> l’ouvrage), Kant conclut que toutel’antinomie <strong>de</strong> la raison pure repose sur la fausse croyance que quand un phénomèneconditionné est donné, la synthèse qui constitue l’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s conditions empiriquesqui contribuent à sa donation, puisse el<strong>le</strong> aussi être présentée en acte, alors qu’envérité, el<strong>le</strong> n’est pas présentab<strong>le</strong> <strong>et</strong> s’éloigne en se volatilisant dans la régression inaccessib<strong>le</strong><strong>de</strong>s conditions empiriques. Ainsi, l’erreur est-el<strong>le</strong> <strong>de</strong> croire que « quand <strong>le</strong>conditionné est donné [par exemp<strong>le</strong>, tout obj<strong>et</strong> <strong>de</strong>s sens], la série entière <strong>de</strong> toutes sesconditions est aussi donnée » ([82], p. 376). « Il ne nous reste pas d’autre moyen <strong>de</strong> terminerdéfinitivement la lutte, à la satisfaction <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux parties, que <strong>de</strong> <strong>le</strong>s convaincrequ’étant capab<strong>le</strong>s <strong>de</strong> se réfuter si bien réciproquement, el<strong>le</strong>s se disputent pour rien <strong>et</strong>qu’un mirage transcendantal <strong>le</strong>ur a fait voir une réalité là où il ne s’en trouve pas »([82], p. 378).51 Mais d’après Kant, ce rapport ne peut exister en fait que dans <strong>et</strong> par <strong>le</strong>s représentationsd’enten<strong>de</strong>ment. « La majeure du syllogisme cosmologique prend <strong>le</strong> conditionnédans <strong>le</strong> sens transcendantal d’une catégorie pure <strong>et</strong> la mineure, dans <strong>le</strong> sensempirique d’un concept <strong>de</strong> l’enten<strong>de</strong>ment appliqué à <strong>de</strong> simp<strong>le</strong>s phénomènes, <strong>et</strong> parconséquent, on rencontre l’erreur dia<strong>le</strong>ctique qu’on nomme sophisma figuræ dictionis» ([82], p. 377).