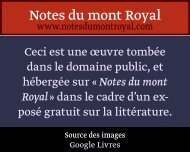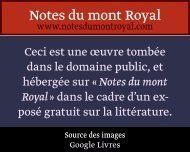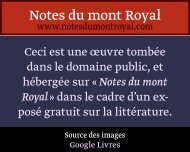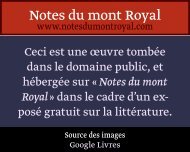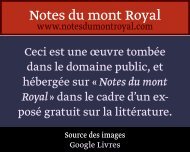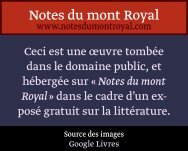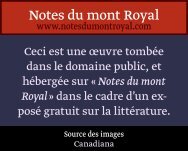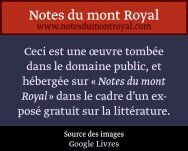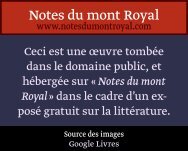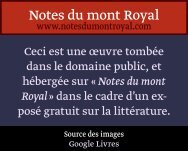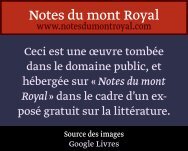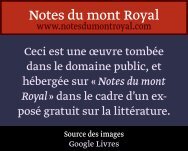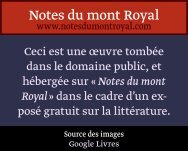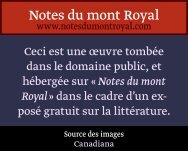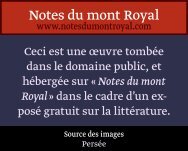la harpe. cours de littérature - Notes du mont Royal
la harpe. cours de littérature - Notes du mont Royal
la harpe. cours de littérature - Notes du mont Royal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ANCIENS. — POÉSIE.<br />
di®iis ebes eux ©ftmt térité-prédcnse, le fon<strong>de</strong>ment<br />
<strong>de</strong> tous les arts d'imitation , et que nos progrès<br />
mânes ten<strong>de</strong>nt ànous faire perdre <strong>de</strong> vue. La simplicité<br />
<strong>de</strong>s anciens peut instruire notre lue ; car ee<br />
mot convient assez à nos tragédies, cpe nous avons<br />
quelquefois un peu trop ornées. Notre orgueilleuse<br />
délicatesse, à forée <strong>de</strong> vouloir tout ennoblir, peut<br />
ncins Mm méconnaître îe charme <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature primitive,<br />
§nl ne perdra jamais ses'droîts sur les hommes.<br />
Cest en ce genre que les Grecs peuvent encore<br />
sons être utiles. Il ne faut pas sans doute les imiter<br />
en tout; mais, dès qu'il s'agit <strong>de</strong> l'expression <strong>de</strong>s<br />
«tîiMiita naturels, rien n'est plus pur que le modèle<br />
qu'Us nous offrent dans leurs bons ouvrages.<br />
Cest là que jamais l'accent <strong>de</strong> rame,' si cher à<br />
l'homme sensible, n 9 @st corrompu ni pr l'affectation<br />
si par le faux esprit. C'est, en un mot, <strong>la</strong><br />
science dont ils sont les véritables maîtres. '<br />
APfWHII€S SUA Là ïaàGÉMg LâTfHB.<br />
Les Latins ont tout emprunté <strong>de</strong>s Grecs, comme<br />
nous avons tout emprunté <strong>de</strong>s uns et <strong>de</strong>s autres.<br />
La tragédie fut connue à Rome dans )e temps <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
secon<strong>de</strong> guerre punique. La <strong>la</strong>ngue n'était pas encore<br />
formée; mais <strong>la</strong> conquête <strong>de</strong> cette partie méridionale<br />
<strong>de</strong> «Italie qn'oin appe<strong>la</strong>it <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong>-Grèce,<br />
et surtout <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sicile et <strong>de</strong> Syracuse, où les Denys<br />
et les ffiérons avaient fait fleurir les lettres grecques<br />
f commenta à familiariser les Romains avec les<br />
beaux arts, et à faire naître le godt <strong>de</strong> <strong>la</strong> poésie et<br />
<strong>de</strong> rétoqaenee. On sait quels progrès ils y firent dans<br />
<strong>la</strong> suite t et 'avec quel • succès ils luttèrent en pins<br />
tfta genre contre leurs maîtres. Aceius et P&cuvîus,<br />
contempoKiiss <strong>de</strong>s Scipïons, passent pour avoir été,<br />
dm <strong>la</strong> Romains, les premiers qui aient écrit dès<br />
tragédies, que les édiles firent représenter. Le temps<br />
m nous a <strong>la</strong>issé que les titres <strong>de</strong> leurs ouvrages el<br />
quelques fragments informes : c'en est assez pour<br />
voir qu'ils ne firent que transporter sur le théâtre <strong>de</strong><br />
lome mm les sujets traités sur celui d'Athènes..<br />
Mais, moins heureuse que l'épopée, <strong>la</strong> tragédie n'eut<br />
point <strong>de</strong> Yïrgiïi. Elle fut pourtant cultivée dans le<br />
beau §iè<strong>de</strong> par <strong>de</strong>s génies supérieurs : nous savons<br />
qu'Ovi<strong>de</strong> fit une Médée, et César un Œdipe. Cicérons'était<br />
amusée mettre en vers <strong>la</strong>tins plusieurs<br />
pièces d'Euripi<strong>de</strong> et <strong>de</strong> Sophocle, dont quelques<br />
<strong>la</strong>mbeaux sont cités dans ses ouvrages. Hais les<br />
•eoles pièces qui soient parvenues jusqu'à nous sont<br />
mm le nom <strong>de</strong> Sénèque. Elles sont au nombre <strong>de</strong><br />
ém : mreukjmrieux, Tkyeeie; les Phéniciennes<br />
mêa TMbmk9A§mmmwM, Mppofyie, OEdipe,<br />
te Tmjfmmm, Hermk uu <strong>mont</strong> œtmf Médée, et<br />
Octet*. Excepté cette <strong>de</strong>rnière, on voit, par les<br />
135<br />
titres mimes, que toutes sont <strong>de</strong>s imitations <strong>de</strong>s<br />
Grecs. Les critiques les plus versés dans l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l'antiquité croient qu'GfFdçpe, Hippo^te, Médée, et<br />
te Trmfmtm, sont <strong>de</strong> Sénèque le philosophe, qu'on<br />
a voulu mal à propos distinguer <strong>du</strong> tragique; et<br />
beaucoup <strong>de</strong> témoignages anciens, qui attribuent au<br />
même auteur le talent <strong>de</strong> <strong>la</strong> poésie, ainsi que celui<br />
<strong>de</strong>là prose, confirment cette opinion. On croît que<br />
les six autres sont <strong>de</strong> divers auteurs qui, dans <strong>la</strong><br />
suite, firent passer leurs tragédies sous un nom accrédité,<br />
comme plusieurs auteurs comiques publièrent<br />
<strong>de</strong>s pièces sous le nom <strong>de</strong> P<strong>la</strong>nte. Ces sortes<br />
<strong>de</strong> frau<strong>de</strong>s étalent assez faciles dans un temps où il<br />
n'y avait point d'Imprimerie. 11 est sûr que les quatre<br />
tragédies que l'on prétend être <strong>de</strong> Sénèque sont<br />
meilleures que les six autres; et to<strong>de</strong>rnïère, Octavie,<br />
qui n'a pu être composée qu'après le règne <strong>de</strong> Néron<br />
f puisquek mort <strong>de</strong> «mépoose et son mariage<br />
avec Poppée ejt font !• sujet, est évi<strong>de</strong>mment <strong>de</strong><br />
quelque mauvais poëte qui -a voûta faire <strong>la</strong> satire<br />
d'un tyran, et <strong>la</strong> publier sous le nom d'un <strong>de</strong>s personnages<br />
célèbres qui avalent été ses victimes. Mais<br />
dans toutes ces pièces, et même dans celles qui passent<br />
pour les meilleures, on trouve en général peu <strong>de</strong><br />
connaissance <strong>du</strong> théâtre et <strong>du</strong> style qui convient à <strong>la</strong> *<br />
tragédie. Ce sont les plus, beau sujets d'Euripi<strong>de</strong><br />
et <strong>de</strong> Sophocle f tra<strong>du</strong>its en quelques endroits, mais<br />
le plus souvent transformés en longues déc<strong>la</strong>mations<br />
<strong>du</strong> style le plus boursouflé. La sécheresse,<br />
l'enflure, <strong>la</strong> monotonie, l'amas <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scriptions gigantesques,<br />
le cliquetis <strong>de</strong>s antithèses recherchées,<br />
dans les phrases une concision entortillée, et une<br />
Insupportable diffusion dans les pensées, sont les<br />
caractères dominants <strong>de</strong> ces Imitations ma<strong>la</strong>droites<br />
et malheureuses, qui ont <strong>la</strong>issé leurs auteurs si loin<br />
<strong>de</strong> leurs modèles.<br />
11 ne faut pourtant pas croire que les pièces <strong>de</strong><br />
Sénèque soient absolument sans mérite. Il y a <strong>de</strong>s<br />
beautés, et les bons esprits qui savent tirer parti<br />
<strong>de</strong> tout ont bien su les apercevoir. On y remarque<br />
<strong>de</strong>s pensées Ingénieuses et fortes, <strong>de</strong>s traits bril<strong>la</strong>nts<br />
, et même <strong>de</strong>s morceaux éloquents et <strong>de</strong>s idées<br />
théâtrales. Racine a bien so profiter <strong>de</strong> rmppolyte,<br />
qui est en effet ce qu'il y a <strong>de</strong> mieux dans Sénèque ;<br />
Il en a prisses principaux moyens, et s'est rapproché<br />
<strong>de</strong> loi dons son p<strong>la</strong>n beaucoup plus que d'Euripi<strong>de</strong>.<br />
C'est d'après lui qu'il a feit <strong>la</strong> scène où Phè<br />
dre déc<strong>la</strong>re elle-même sa passion à Hlppoiyte, au<br />
lieu ^ef dans Euripi<strong>de</strong>, c'est <strong>la</strong> nourrice qui se<br />
charge <strong>de</strong> parler pour <strong>la</strong> relue. Le poëte <strong>la</strong>tin eut<br />
donc le double mérite d'éviter un défaut <strong>de</strong> bienséance,<br />
et <strong>de</strong> risquer une scène très-délicate à manier<br />
; et le poëte français fa Imité dans l'un et dans