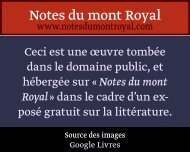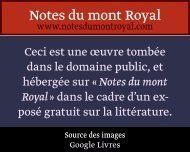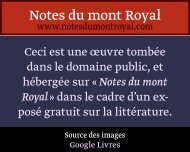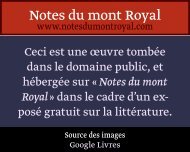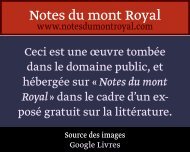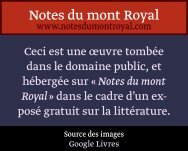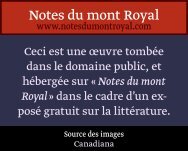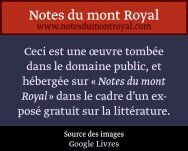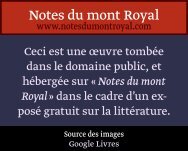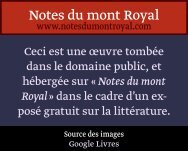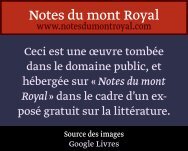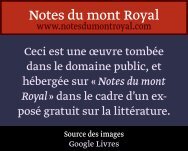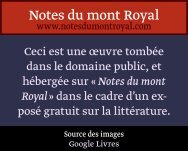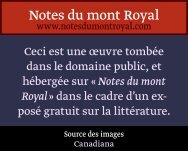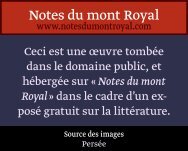- Page 1 and 2:
Notes du mont Royal www.notesdumont
- Page 4:
tàiis, —»TYrocnAMiK PK wmmm DID
- Page 10:
NOTICE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE
- Page 14:
NOTICE SUE LA HARPE. honorable. 11
- Page 18:
PRÉFACE. Qw cet outrage soit
- Page 22:
Mettaitfteénte sur l'ait fféertw,
- Page 26:
de la morale, a gravé pour rinnior
- Page 30:
1NT10DUCTI0N. plat bien concis t le
- Page 34:
INTRODUCTION. moins, comme on a plu
- Page 38:
gnorance et l'en?ie ; mais sons, qu
- Page 44:
C0U1S DE UTTÉRATURE. 18 sent et de
- Page 48:
30 est sujet à s'égarer, c'est qu
- Page 52:
21 COU1S DE LITTÉ1A1UEE. le déran
- Page 56:
%4 GQUB& DE -LITTÉMT11E. plus souv
- Page 60:
36 COURS DE LITTÉRATURE. wi» devi
- Page 64:
28 et décide en faveur de la trag
- Page 68:
30 COU1S DE LITTÉMTOiP. Mais âfâ
- Page 72:
•a Il s'y a de bon dans tout cela
- Page 76:
34 guÉeordioalMiiieiit/qiiilui don
- Page 80:
3i 'COURS DE LITTÉIÀIUEE. 1er, ai
- Page 84:
CODES DE UTTiRATUHE. as ^ . utile
- Page 88:
40 G0U1S DE LITTÉ1ATUEE. de moins
- Page 92:
43 ceux dos Latins sont incomplets;
- Page 96:
44 COtJMS DE LITTÉRATURB. Il s'en
- Page 100:
411 de l'Allemagne, el le grée des
- Page 104:
48 les mots petites! entrer dam tou
- Page 108:
COU1S DE LITTÉIATUEE. sa choses tr
- Page 112:
COUES DE LITTÉBATUli. ouvrages tus
- Page 116:
64 COUES BE L1TTÉ1ATUME. été l'o
- Page 120:
C0U1S DE LITTÉ1ATU1E. 66 à péné
- Page 124:
mère, n'ont pas songé qu'il n'en
- Page 128:
•0 CUBES DE UTTtHATUB& Un des rep
- Page 132:
CODES DE LITTÉ1ATU1E. cour à soa
- Page 136:
64 iïie édition qui liftât bient
- Page 140:
COUES DE LITTÉRATURE. 66 part des
- Page 144:
68 COUES DE L1YTÉBATU1E. aa âta t
- Page 148:
7® COURS DE LITTÉRATURE. une iMmm
- Page 152:
72 COUES DE LITTÉEATURÈ. avec un
- Page 156:
74 gloire de ma perte est réservé
- Page 160:
TC toutes les démarches furent alo
- Page 164:
78 COU1S DE LITTÉMTU1E. Tkéogmit
- Page 168:
80 est fort mauTaisef et la diction
- Page 172:
COU1S DE LITFÉEâTIJlE. sa Sans au
- Page 176:
84 GOUBS DE IXnftUTUBE. de savoir l
- Page 180:
86 C0U1S DE LITTÉIATUIE. Ewnéaitt
- Page 184:
8S C0D1S M MTTÉMTC1E. La sang Inon
- Page 188:
m tiucni. Eitae à moi .Juste ciel!
- Page 192:
m . Qu'allume en moi « mîle a mon
- Page 196:
i4 COllS DE LmÉRATDBE. pi demande
- Page 200:
m inutilement essayé de sauter sa
- Page 204:
os c'est un moyen a¥orté, ce qui
- Page 208:
pas que ces kitres ne soient curieu
- Page 212:
COURS DE UTTÉlATUiyE. bas; il s'en
- Page 216:
104 COURS DE LITOÉMTIJIE. Cest la
- Page 220:
|06 CÔUES DE JLHTEEATDEE. rat aui
- Page 224:
106 COUftS DE OTTÉB^TUM. « Asmlwt
- Page 228:
lit Ailleurs eette eipresrion pourr
- Page 232:
111 OÛU1S DE 1JTTÉMTIJ1E. guère
- Page 236:
CODES DE IITIÉRATDBE. 114 vêtemen
- Page 240:
lift C001S DE UTTÉMTII1E. voiles s
- Page 244:
118 COtJBS Dl' UITtÊATOBEL Grècef
- Page 248:
120 fririons pas qu'ayant eu ^art
- Page 252:
COUtS DE UTltRATUBE. 1» quand on l
- Page 256:
114 COD1S DE TilT&ATOBE. Le ۤek
- Page 260:
126 l'autre. 11 lu! doit aussi rid
- Page 264:
138 entortillées @t liemdeiises. C
- Page 268:
C0U1S DB UTnftlkATDHB. ISO tan avec
- Page 272:
•l • . ! • , CODES DE L1TT
- Page 276:
J34. COURS DE LITTÉRATURE . m Si Y
- Page 280:
CÛUES DE UTTÉMTUM. 136 mandait to
- Page 284:
138 COURS DE LITTÉRATURE. affaires
- Page 288:
C0D1S DE LnTÉBàTDBE. 140 rire, n'
- Page 292:
C0U1S DE UTTÉ1ATU1E. 143 achève d
- Page 296:
144 C0U1S DE LITTÉEATU1E. radoube,
- Page 300:
140 COURS DE UTTÉRAXUBE. Pampblie
- Page 304:
148 quoiqu'on n f ait encore jamais
- Page 308:
ISO mms DE onÉiATiJiE. bâti une v
- Page 312:
COURS DE LlTfÉEATOlE. 159 sentir l
- Page 316:
154 Quand tu trompes toi i SU te ns
- Page 320:
156 î9 qui est la même dans tous
- Page 324:
158 raison ; il se prêche pas la v
- Page 328:
1*0 COUS DE UTTÉRATDBB. recette»
- Page 332:
eprend, que l'on corrige? Est-ce l
- Page 336:
164 rés. I recommande sans cesse c
- Page 340:
tm C0U1S DE UTTtRATUBB. M dais Hora
- Page 344:
168 heure à la pfiilosopliie stoï
- Page 348:
nu G0U1S DE L1TTÉ1ATUBE. il n'est
- Page 352:
172 COORS DE LITTÉMTOfiE» €hw»
- Page 356:
174 mour et de ffllusion ; mais il
- Page 360:
176 C0U1S DE LITT1EATU1E. d'une ima
- Page 364:
178 vous verrez ce qu'il deviendra.
- Page 368:
180 et qui aime plus fie moi son ta
- Page 372:
181 ' CODES DE LITTÉRATUIE. verset
- Page 376:
184 CODES DE OTTÉMTUEE. pas là le
- Page 380:
COU1S DE MTTÉEATIJ1E. mm eài-écr
- Page 384:
ISS COU1S DE LITTÉMTU1E. mit pas l
- Page 388:
190 maîne est celai de la plante.
- Page 392:
ttl COU1S DE MTTÉ1ATU1E. le récit
- Page 396:
194 « Qu'elles sont grandes s é m
- Page 400:
196 C0U1S Bl UTTÉBATDBB. ©rirait
- Page 404:
COOIS DE L1TTÉ1ATIJML tm prié ain
- Page 408:
200 COCOS MB ÙTTÉBATOBB. théâtr
- Page 412:
102 tout te monde, et ses détails
- Page 416:
§04 CODES DE UTt.fcRATURR. mat plu
- Page 420:
106' règles; et sH fit eoumcelles
- Page 424:
208 tin peut comporter, mais m que
- Page 428:
210 facilité, qui n'est étonnante
- Page 432:
211 COUES DE UTTEftATUHB. ëm$lê$
- Page 436:
COCUS DE UTTÉ1ATIIBE 214 lui mettr
- Page 440:
216 Cteéroa faisait à en témoin
- Page 444:
218 CXMJ15 DE UTTEMTUBEL les gens l
- Page 448:
OOU1S DR OTTÊIAÏOift dans Fan t l
- Page 452:
cette règle lorsque a dit, en parl
- Page 456:
S94 CODES DE UTTÉBATDBE. cet endro
- Page 460:
faut bien que tes leçons aident la
- Page 464:
m COURS DE LITTÉRATURE. nombreuse
- Page 468:
MO COURS DE UTTÉMTHRE. tiae ici pr
- Page 472:
232 G0C1S Bl UTTÉBATDUL Il tend co
- Page 476:
1S4 COOIS DE UTTÉRATUHE. ifedetass
- Page 480:
)S6 GOUBS DE UTIEBATD1I. * Qu'y a-t
- Page 484:
1S8 COUBS WR UTrmATDBE. naturel qui
- Page 488:
C0U1S Dl LITTÉIATUIE. 240 subtilit
- Page 492:
Î42 OOVBS DE UTTÉMTU1E. i est inf
- Page 496:
GOUES DE LITTÉIATOIE. 244 citation
- Page 500:
246 COURS DE- LITTÉEATUML nissemen
- Page 504:
248 COUfiS DE LITTÉiATUEE. Jurés
- Page 508:
CODES DE LITTÉMTIJEE, KO d'éfiYô
- Page 512:
C0U1S DE UlTÉBATUBE. 3SJ tours? Qu
- Page 516:
S64 COUBS DE mTÉMTUlE. humaine : o
- Page 520:
§56 COUMS DE LITTÉEATÏÏ1E. mauv
- Page 524:
laes la forme du couronnement ordon
- Page 528:
260 ? erta, quoique la destinée, i
- Page 532:
963 COURS DE LITTÉRATURE. tendu la
- Page 536:
264 COURS m LITTÉRATU1E. prétendu
- Page 540:
S66 COURS DE LITTÉRATURE. er*. Ver
- Page 544:
COUES DE L1TTÉMTD1I. « Terres CDA
- Page 548:
370 CXHJBS DE LUTEBATU1E. qu'as mom
- Page 552:
279 perversité bizarre qui fait qu
- Page 556:
174 COBIIS DE- IJTTÊMTOIM, „we
- Page 560:
COURS DE UTTEHATUBE. à celle ie CI
- Page 564:
27i idée, et n'insista sur la pein
- Page 568:
280 COTES DE LITTEMTU1R ,. saieiît
- Page 572:
C0UBS DE IARÉBATOIE. il n'y » pan
- Page 576:
S84 • • 'COURS DE UTTÉRATDBÈ.
- Page 580:
280 lotit coule de source et va au
- Page 584:
•COURS DE L1TTÉ1ATURR Î88 d'uni
- Page 588:
290 chose a «tinte? Et en eft%tf n
- Page 592:
fSJ COURS m LITTÉRATURE. wenapit t
- Page 596:
294 C0U1S .DE LITTÉMTOIE. sar et C
- Page 600:
296 OOU!S DE UTTËMTOfŒ. Tir ; qui
- Page 604:
%m COURS DE UTTÉMTU1E. qu'ils s'y
- Page 608:
son use sorte de parenté, qui cons
- Page 612:
lot GOCBS DE UTTÉEÂTDBE. anciens
- Page 616:
êêé COURS DE UTTÉBATDBB. Démos
- Page 620:
adulateur ? Jusqu'à ce qu'on me ci
- Page 624:
SOS COUS DE UTT&BATDRE. marchands
- Page 628:
310 nier sceau à toute corruption,
- Page 632:
812 pies utiles à présenter dans
- Page 636:
C0U1S DE UTIÉBÀTinOL. 314 giratoi
- Page 640:
116 COII1S DE LITTÉ1ATU1E. à fesp
- Page 644:
SIS COURS DE LITTÉBATCRE. et ses c
- Page 648:
C0U1S DE UTTÉBATUBR. eselsve; cl q
- Page 652:
ia guerre i fut chargé pendant plu
- Page 656:
324 que» autres; mais un philosoph
- Page 660:
S2§ C0U1S DE OTTÉEATCBE. mettre d
- Page 664:
338 CÛUtS DE LHTÉMTU1E. Juvénal
- Page 668:
ait C0U1S DE UTTMATUBE. humain, ém
- Page 672:
M) COC1S DE UTTÉ1AT01E. tt lui éi
- Page 676:
184 m»ares qu'il nous t laissées
- Page 680:
quand lome est menacée, quand renm
- Page 684:
338 que avec mol. Que te malheur pa
- Page 688:
340 0ÛU1S DE LnTÉMTOlE, rouf part
- Page 692:
342 00U1S DE UTTÉMTIJ1E. fièremen
- Page 696:
344 •COU1S BE LITTÉRATURE. mêl
- Page 700:
346 GODES BE UTTÉMTU1K pour f ous
- Page 704:
348 COURS DE UTTÉKATUBE. doat plus
- Page 708:
860 C0B1S Bl UTTÉ1ATU1R qu'il para
- Page 712:
3S2 COU1S DE LITTÉMTUER tin mof en
- Page 716:
§54 COURS DE LITTÊEATÏÏ1B. < Or
- Page 720:
Uê C0U1S DE LITTÉEATU1E. afestsel
- Page 724:
SS8 ment de réélit et de la riche
- Page 728:
860 sont pas, à beaucoup près, le
- Page 732:
869 COUtS DE UTTÊEATU1E. absolumen
- Page 736:
864 but qoedefalreadôpterdaiis tou
- Page 740:
36-6 erreur des sens postait contre
- Page 744:
MB COC1S DE UTTÉEATDEE. itefeifti
- Page 748:
S70 foctneui 011 d'inoomplet ne doi
- Page 752:
S7* COURS DE LITTÉRATURE. ife notr
- Page 756:
374 cyniques; Il n'y a rien d'éton
- Page 760:
876 COURS DE LITTÉRATURE. aurait g
- Page 764:
3?S €»U1S DE UTTÉRâTUiR gertat
- Page 768:
88® l'homme, c'estMh* son àm, et,
- Page 772:
S83 COURS DE LlTTÉlâTUlE. sérén
- Page 776:
COUES DE L1TFÉEATC1E. 384 Me sève
- Page 780:
986 C0IJ1S DE UTTEHAXURE. craindre
- Page 784:
SS8 CODIS DE LRTÉRATDRB. et Gieér
- Page 788:
C0U1S DE LITTÉIATUIE. 8i0 « An fo
- Page 792:
-S9) % (MJËS DE LltrÉMTUlB. Sén
- Page 796:
•§4 taie et quelque impiété. M
- Page 800:
896 Angleterre f où Ton connaît u
- Page 804:
MM Ils s* y prennent trop tard p@er
- Page 808:
400 CODES BE OTTÉ1AT01E. mature de
- Page 812:
C0U1S DE UTTÉMTOEE. pas le calme e
- Page 816:
404 , COU1S DE L1TTÉRATU1E. tuteur
- Page 820:
406 COU1S DE UCTÉMTUML Mires,-quoi
- Page 824:
40S et îmimm quoque habere. Et §1
- Page 828:
410 lié» de goût, qu'il s'abstie
- Page 832:
413 COU1S DE UTTÉRATUBE. être mal
- Page 836:
414 CÛU1S DE UTTÉIATOML que, quan
- Page 840:
416 CODES DE LITTÉEATC1E J'ai fait
- Page 844:
418 d'Agrippine, personne n'y aurai
- Page 848:
410 même étaient beaucoup plus su
- Page 852:
4n Tfanséas a?ail prononcé dès l
- Page 856:
C0U1S DE LITTÉMTU1E. 424 d'histoir
- Page 860:
SECONDE PARTIE. - SIÈCLE DE LOUIS
- Page 864:
428 COURS DE L1TTEEATHEE. mmmt la d
- Page 868:
4S0 COU1S DE LITTÉ1ATU1E. fade ign
- Page 872:
COURS DE LITTÉRATURE. 432 paré le
- Page 876:
484 C0U1S DE LITTÉRATURE. lectures
- Page 880:
GOURS DE UTTÉIATUEE, 416 mais fui,
- Page 884:
438 COUÈS DE LITTÉiâTIJBB. des l
- Page 888:
440 C0U1S DE LITTÉIÂTOIE. sance,e
- Page 892:
441 COURS DM UTTIIATUIE. siècle, e
- Page 896:
444 C0ÏÏ1S DE UTIEsUTUBE. liarit
- Page 900:
4M GOCHS DE UIIÉBATDKB. féventa d
- Page 904:
448 COUBS DE UrraiATURE. de nof jou
- Page 908:
45* CODES DE LÏTTÉEATUEE. El là
- Page 912:
462 COUES DE LITTÉRATURE. De me ca
- Page 916: 454 GOUBS BE LITFEiATORE. Souris à
- Page 920: 456 COURS DE IJTTÉMTU1B. Mtoàt»
- Page 924: 468 CGU1S Dl LITIÉBATUBE; sont en
- Page 928: C0U1S DE L1TTÉMTUÉE. 460 réponil
- Page 932: 403 grâce ? Je dis des diamants :
- Page 936: 4G4 préaux pour les envoyer I celt
- Page 940: 466 goôf. Le style ut cessait d'ê
- Page 944: COUS BE UTTÉBÀTUIE. 4êê &mm qns
- Page 948: 470 les-plus renommés , dominait d
- Page 952: 41% dinaire. la faisant de suite un
- Page 956: 474 COURS DE LITTÉRàTUU. rei, fuo
- Page 960: 47* OOUtS DE LITTÉEATUIE, dûment
- Page 964: 478 une situation qui est m oUo-mé
- Page 970: utopie méprise trèsnistanlle, san
- Page 974: SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 978: SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 982: SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 986: acte , rempli do traits de force et
- Page 990: SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 994: le spectateur, qui n'a rien aperçu
- Page 998: SIÈCLE NE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1002: SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1006: SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1010: SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1014: SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.'
- Page 1018:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1022:
ees subtilités sont beaucoup trop
- Page 1026:
SIÈCLE DB IDUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1030:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE B
- Page 1034:
tufiuiee, et que les oumgei d'Homè
- Page 1038:
Tautreattachait les regards parées
- Page 1042:
SIÈCLE DE LOUIS XI?. — POÉSIE.
- Page 1046:
peine Agrippioe fa-t-elle qaitté,
- Page 1050:
Mais de tout faillie» quel sera te
- Page 1054:
dant du rang suprême et contre J'o
- Page 1058:
Combien « mot cruel est affreux qu
- Page 1062:
SIÈCLE DE LOUIS XIY. — fOÉSIE.
- Page 1066:
SIÈCLE DE LOUIS XI?. — POÉSIE.
- Page 1070:
m convenir, que c'est y à mon gré
- Page 1074:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1078:
àms fort» du eekle attend note©
- Page 1082:
Ao-dearas i«'&w flot» ss naufrage
- Page 1086:
Des hamismêÊ M beau tertio!»» C
- Page 1090:
forme à oettejuste ferlé» si nat
- Page 1094:
SIÈCLE DE MMHS XIV. — MÉSDL IM
- Page 1098:
Et Jamais dans La** un Me le raviss
- Page 1102:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1106:
41 ! nalhwfetix âreai ! te m'as tr
- Page 1110:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1114:
connu du reste de l'armée. Us autr
- Page 1118:
il produit à la fois sur une mère
- Page 1122:
l'Innocent Hippolyte, plutôt que s
- Page 1126:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1130:
mm amour pour HIppolyte avec beauco
- Page 1134:
pir lorsque je me trou?a entre toi
- Page 1138:
SIÈCLE DE LOU» XIV. — POÉSIE.
- Page 1142:
fÉlntB. Ah! mâchera Aride»' H «
- Page 1146:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1150:
f«#i Aaeine était capable 9 011 s
- Page 1154:
'SIèCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1158:
MQI énoncé présenté une sorte d
- Page 1162:
On a déjà fti dans ce peu de vers
- Page 1166:
tère, et ries se Fa eu depuis. Tou
- Page 1170:
effet, parce qu'elle succède à un
- Page 1174:
teur ne condamne tout ce dont Matha
- Page 1178:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POÉSIE, qu
- Page 1182:
SIÈCLi; DE LOUIS XIV.' — POÉSIE
- Page 1186:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1190:
SIÈCLE DE LOUIS HV. — POÉSIE. d
- Page 1194:
SIÈCLE DE LOUIS XI?. — POÉSIE.
- Page 1198:
SIÈCLE BB LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1202:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1206:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1210:
Corneille n'est pas moins grand dan
- Page 1214:
Ta veto KM puisants étage» s Donn
- Page 1218:
Votre mmumme kmmeur lui M toujours
- Page 1222:
Ka suer, an nom d'amour, et par pli
- Page 1226:
ailles* Os conçoit encore moins qu
- Page 1230:
de mort très-légalement renie, qu
- Page 1234:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1238:
SIÈCLE m LOUIS XIV. — POÉSIE. q
- Page 1242:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1246:
pli» à propos de la faire connaî
- Page 1250:
Smm mon audace, AfMn, Je me cache
- Page 1254:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1258:
Quînault C'était an reste du goû
- Page 1262:
SIÈCLE DK LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1266:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1270:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1274:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POÉSIE. n'
- Page 1278:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POESIE. 68i
- Page 1282:
le ntsttaMlral toq|oait, morilles,
- Page 1286:
Quand on entend cet excellent dialo
- Page 1290:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1294:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1298:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1302:
lesser les bienséances, ce qui ; s
- Page 1306:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1310:
des procédés. On sait que Boiieau
- Page 1314:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1318:
•SIÈCLE Dl LOUIS XIV. — POÉSI
- Page 1322:
grande qu v elle peut Titre, le con
- Page 1326:
SIÈCLE BI LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1330:
L'opéra tel qu'il a été depuis Q
- Page 1334:
Ce ftit ter ton diamant rlva§e Que
- Page 1338:
qu'elle fat l'époque de Fiiion de
- Page 1342:
SIÈCLE BE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1346:
Us songe iffceoz m'Inspire nue fure
- Page 1350:
SIÈCLE DE LOUIS XIY. — POÉSIE.
- Page 1354:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1358:
?er ik la monotonie; et l'un sait l
- Page 1362:
Et qui, des pieds touchant la terre
- Page 1366:
Et glacer ses rives d'effroi : Tel
- Page 1370:
SIÈCLE DE LOUIS X1Y. — POÉSIE.
- Page 1374:
les lauriers de César ; mais la ra
- Page 1378:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POESIE. for
- Page 1382:
Tous tes lecteurs mit l«i» goûts
- Page 1386:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1390:
SIÈCLE DE LOUIS XIY. — POÉSIE.
- Page 1394:
un homme qui joignit au génie dram
- Page 1398:
Traîné du fond des bols un cerf
- Page 1402:
SIÈCLE DE LOUIS avec peu d'effet.
- Page 1406:
SIÈCLE DI LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1410:
te*** djmpnmer «arment : Si le bur
- Page 1414:
Mais vous f pair es parier, vous y
- Page 1418:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE-
- Page 1422:
SIÈCLE DE LOUIS X1Y. — POÉSIE.
- Page 1426:
seule férité qu'il y ait dans cel
- Page 1430:
SIÈCLE DE. LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1434:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1438:
SIÈCLE DE LOUIS XIY. — POÉSIE.
- Page 1442:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE d
- Page 1446:
Yen, au lieu d'aller partout décri
- Page 1450:
n Sait 6)*une ¥olx légère, « Pa
- Page 1454:
SIÈCLE m LOUIS XIV. — POÉSIE. f
- Page 1458:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1462:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1466:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1470:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1474:
SIECLE DE LOUIS XIY. — POÉSIE. 7
- Page 1478:
fialiiir à tep ÉMs • te irten d
- Page 1482:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1486:
Qu'en solvant cet objet dont vous
- Page 1490:
* Comme on ¥@§t quelquefois par l
- Page 1494:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POESIE Jvee
- Page 1498:
erger : les frais bergers ne parlen
- Page 1502:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1506:
TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS