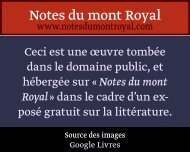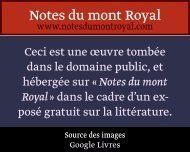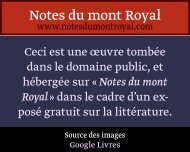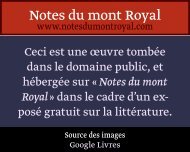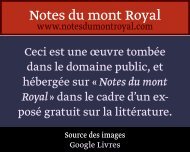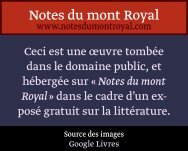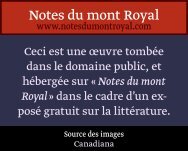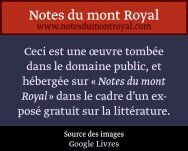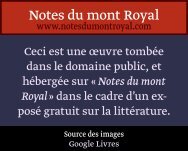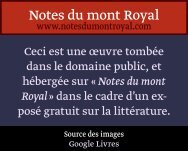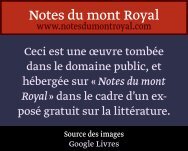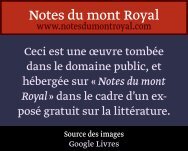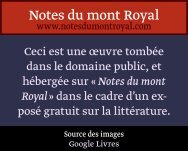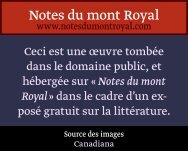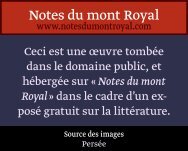la harpe. cours de littérature - Notes du mont Royal
la harpe. cours de littérature - Notes du mont Royal
la harpe. cours de littérature - Notes du mont Royal
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ANCIENS. — POÉSIE.<br />
pour Mr intérêt réciproque, que le plus dons et<br />
le plQs aimable donne <strong>la</strong> IoiY et que celui <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
qui apporte dans m commerce le plus d'agrément<br />
et <strong>de</strong> doues»* y ait aussi le plus d'kËuenee. Alors<br />
a dé •'établir le prâeip <strong>de</strong> ne jamais prononcer<br />
<strong>de</strong>?ant les femmes as mot fui pût les faire rougir :<br />
<strong>de</strong> là ce respect qu'aura toujours pour elles tout<br />
homme un peu délicat; sorte d'hommage qui peut<br />
les f<strong>la</strong>tter encore plus que le désir <strong>de</strong> leur p<strong>la</strong>ire,<br />
parce que l'un tient à l'attrait général <strong>du</strong> sexe, et<br />
que F autre est un témoignage d'estime ; <strong>de</strong> là ces<br />
égards que l'on doit à <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>stie qui leur est naturelle<br />
, et qui doit nous être à nous-mêmes d'au*<br />
tant plus précieuse 9 que c'est encore en elles une<br />
grâce <strong>de</strong> plus et un charme nouveau qui se mile à<br />
l'expression <strong>de</strong> leur sensibilité.<br />
Tel était l'excellent ton <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> Louis XI Y,<br />
celui qui se fut sentir dans tous les monuments<br />
qui nous en restent 9 celui qui servit <strong>de</strong> modèle aux<br />
autres nations <strong>de</strong> l'Europe, et qui a fixé le caractère<br />
<strong>de</strong> l'urbanité française. C'est encore à ces traits<br />
que l'on reconnaît aujourd'hui <strong>la</strong> bonne compagnie,<br />
celle qui mérite véritablement ce nom. Sans doute<br />
<strong>la</strong> nation ne renoncera jamais à l'un <strong>de</strong>s avantagea<br />
les plus aimables qui l'aient distinguée jusqu'ici. On<br />
ne détruira pas le respect <strong>de</strong>s convenances sociales,<br />
sous prétexte d'égalité, et l'on ne nous dtera pas <strong>la</strong><br />
politesse <strong>de</strong>s nations civilisées ni <strong>la</strong> décence <strong>de</strong>s<br />
moeurs et <strong>du</strong> <strong>la</strong>ngage, sous prétexte <strong>de</strong> nous rendre<br />
ta gaieté. Ce serait au contraire une preuve que nous<br />
Taurions per<strong>du</strong>e, cette gaieté dont on nous parle,<br />
si l'os n'en pouvait plus avoir qu'aux dépens <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pu<strong>de</strong>ur publique. Ce genre <strong>de</strong> gaieté est heureusement<br />
celui <strong>de</strong> tous dont on se dégoûte le plus vite.<br />
Ceux qui seraient tentés d'y avoir re<strong>cours</strong> y renonceront<br />
bientôt f ne fût-ce que par amour-propre. On<br />
y réussit à peu <strong>de</strong> frais; et c'est <strong>de</strong> toutes les sortes<br />
d'esprit celle dont les sots tirent le plus <strong>de</strong> parti.<br />
Ainsi, quoique d'honnêtes gens, entraînés-par <strong>la</strong><br />
curiosité ou par <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>, puissent s'amuser un moment<br />
<strong>de</strong> ces spectacles subalternes, comme on s'arrête<br />
quelquefois dans <strong>la</strong> ne <strong>de</strong>vant le théâtre <strong>de</strong><br />
Polichinelle, ils ne croiront jamais que <strong>la</strong> gaieté<br />
française aille prendre <strong>de</strong>s leçons â ces farces grossières<br />
9 qui auraient été affilées dans les <strong>cours</strong> <strong>de</strong><br />
Tenailles par les valets <strong>de</strong> pied <strong>de</strong> Louis XIV.<br />
•moi n. — De <strong>la</strong> ccnéite <strong>la</strong>tine.<br />
Il s'y a point, à proprement parler, <strong>de</strong> comédie<br />
<strong>la</strong>tine, puisque les <strong>la</strong>tins ne firent que tra<strong>du</strong>ire ou<br />
imiter les pièces grecques ; que jamais ils ne mirent<br />
sur le théâtre un seul personnage romain ; et que $<br />
dans tontes leurs pièces, c'est^toujours une ville<br />
grecque qui est le ieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> scène. Qu'est-ce que<br />
ISO<br />
<strong>de</strong>s comédies tartines où rien n f est <strong>la</strong>tin que le <strong>la</strong>ngage<br />
? Ce n'est pas là sans doute un spectacle national.<br />
Le nêtre lui-même n'a mérité ee titre que <strong>de</strong>puis<br />
Molière : avant loi, toutes nos pièces étaient espagnoles<br />
, parce que Lopez <strong>de</strong> Vega, Caldéron, Roxas,<br />
et d'autres, ftirent les premiers modèles <strong>de</strong> nos<br />
auteurs. Cest un tribut que payent en tout genre<br />
les nations qui viennent les <strong>de</strong>rnières dans <strong>la</strong> carrière<br />
<strong>de</strong>s arts : maïs quand on arrive après les autres,<br />
il reste une ressource ; c*est d'aller plus loin qu' eux ;<br />
et les Français ont eu cette gloire, qui a manqué<br />
aux Romains.<br />
Ennius, Nevfus, Ceeilioi, Aquîlius, et beaucoup<br />
d'autres, tous imitateurs <strong>de</strong>s Grecs, ne sont point<br />
venus jusqu'à nous. Il nous reste vingt et une pièces<br />
<strong>de</strong> P<strong>la</strong>nte, qui écrivait dans le temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong><br />
guerre punique. Épichaf me, Diphilus, Dénriophile,<br />
et Philémon $ furent ceux dont il emprunta le<br />
plus. Si l'on en juge par ses imitations, on n'aura<br />
pas une gran<strong>de</strong> idée <strong>de</strong> ses modèles. Le comique<br />
<strong>de</strong> P<strong>la</strong>nte est très-défectueux : il est si borné dans<br />
ses moyens, si uniforme dans son ton, qu'on peut<br />
Fappeler un comique <strong>de</strong> convention, tel qu'a été<br />
longtemps celui <strong>de</strong>s Italiens, c'est-à-dire, un canevas<br />
dramatique retourné en plusieurs façons, mais<br />
dont les personnages sont toujours les mêmes. C'est<br />
toujours une jeune courtisane, un vieil<strong>la</strong>rd ou une<br />
vieille femme qui <strong>la</strong> vend, un jeune homme qu! Fa*<br />
chète; et qui se sert d'un valet fourbe pour tirer <strong>de</strong><br />
l'argent <strong>de</strong> ton père ; joignez-y un parasite, espèce<br />
<strong>de</strong> comp<strong>la</strong>isant <strong>du</strong> plus bas étage 9 et dont le méfier,<br />
à Athènes comme à Rome, était d'être prêt à tout<br />
faire pour le patron qui lui donnait à manger; <strong>de</strong><br />
plus, un soldat fanfaron, dont <strong>la</strong> jactance extra va*<br />
pute et burlesque a servi <strong>de</strong> modèle aux eapîtam,<br />
aux maêmmorm <strong>de</strong> notre vieille comédie, qui ne reparaissent<br />
plus aujourd'hui, même sur nos tréteaux :<br />
voilà les caractères qu! se représentent sans cesse<br />
dans les pièces <strong>de</strong> P<strong>la</strong>nte. Cette uniformité <strong>de</strong> personnages<br />
et d'intrigues n'est que fastidieuse; celle<br />
<strong>du</strong> style et <strong>du</strong> dialogue est dégoûtante. Tous ces<br />
gens-là n'ont qu'un <strong>la</strong>ngage dans toutes les situations<br />
; c*est celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> bouffonnerie, souvent <strong>la</strong> plus<br />
p<strong>la</strong>te et <strong>la</strong> plus grossière. Vieil<strong>la</strong>rds, jeunes gens,<br />
femmes, esc<strong>la</strong>ves, soldats, parasites, tous sont <strong>de</strong>s<br />
bouffons qui ne s'expriment guère que par <strong>de</strong>s<br />
quolibets et <strong>de</strong>s turlupina<strong>de</strong>s. 11 paraît que P<strong>la</strong>ute<br />
et ceux qui! a suivis se sont entièrement mépris<br />
sur l'espèce <strong>de</strong> gaieté qui doit régner dans Sa comédie<br />
, et sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>isanterie qui convient au théâtre.<br />
Elle doit être naturelle et conforme à <strong>la</strong> situation<br />
et au caractère. Les personnages d'une comédie ne<br />
sont point <strong>de</strong>s ba<strong>la</strong>dins qui ne songent qu'à faire