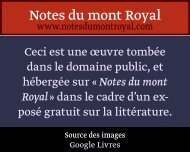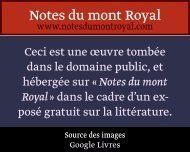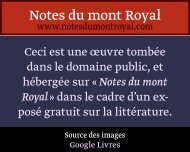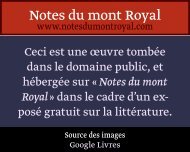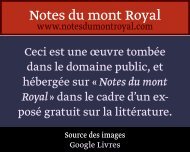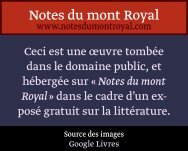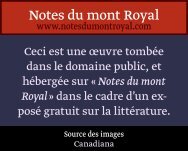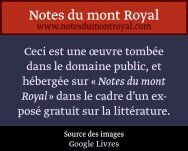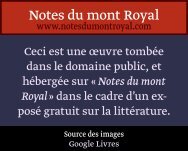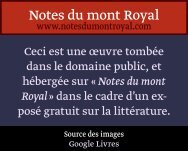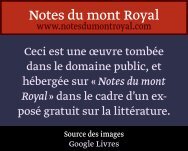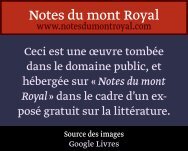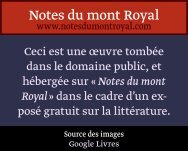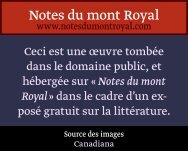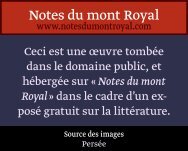- Page 1 and 2:
Notes du mont Royal www.notesdumont
- Page 4:
tàiis, —»TYrocnAMiK PK wmmm DID
- Page 10:
NOTICE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE
- Page 14:
NOTICE SUE LA HARPE. honorable. 11
- Page 18:
PRÉFACE. Qw cet outrage soit
- Page 22:
Mettaitfteénte sur l'ait fféertw,
- Page 26:
de la morale, a gravé pour rinnior
- Page 30:
1NT10DUCTI0N. plat bien concis t le
- Page 34:
INTRODUCTION. moins, comme on a plu
- Page 38: gnorance et l'en?ie ; mais sons, qu
- Page 44: C0U1S DE UTTÉRATURE. 18 sent et de
- Page 48: 30 est sujet à s'égarer, c'est qu
- Page 52: 21 COU1S DE LITTÉ1A1UEE. le déran
- Page 56: %4 GQUB& DE -LITTÉMT11E. plus souv
- Page 60: 36 COURS DE LITTÉRATURE. wi» devi
- Page 64: 28 et décide en faveur de la trag
- Page 68: 30 COU1S DE LITTÉMTOiP. Mais âfâ
- Page 72: •a Il s'y a de bon dans tout cela
- Page 76: 34 guÉeordioalMiiieiit/qiiilui don
- Page 80: 3i 'COURS DE LITTÉIÀIUEE. 1er, ai
- Page 84: CODES DE UTTiRATUHE. as ^ . utile
- Page 88: 40 G0U1S DE LITTÉ1ATUEE. de moins
- Page 94: ANCIENS. — POÉSIE. Bière à iai
- Page 98: Mite a mis : ANCIENS. — POÉSIE.
- Page 102: ANCIENS. — POÉSIE. que les nêtr
- Page 106: ANCIENS. — POÉSIE. •ksi ie ses
- Page 110: ANCIENS. — POÉSIE. 61 Fa précé
- Page 114: quité. Le Tasse et Mlllon y ont su
- Page 118: ANCIENS. — POÉSIE. dangers qui F
- Page 122: ANCIENS. — POÉSIE, puissance de
- Page 126: fourni que quelques détails brilla
- Page 130: ANCIENS, — POÉSIE. igore # Achil
- Page 134: âNCIENS. — POÉSIE. itiit dit b
- Page 138: ANG1ENS. - POÉSIE. manier© à fai
- Page 142:
sotie l'effet des 'contrastes et pa
- Page 146:
flrfile : qu'il était moins diffic
- Page 150:
Ne nous plaignons pas de la nature,
- Page 154:
mer. La MMI m m couchant était env
- Page 158:
Et Uni tout entier au Talus amuseme
- Page 162:
force de légiste? à leurs reproch
- Page 166:
ANCIENS. seul outrage* Il est vrai,
- Page 170:
ANCIENS. — POÉSIE, pméMê §ta?
- Page 174:
ANCIENS. - POÉSIE. SS. wÊms* Lê
- Page 178:
ANCIENS. — POÉSIE. iensdesHess I
- Page 182:
De trouver œ pKrrfar prtt à se me
- Page 186:
ANCIENS. — POÉSIE, •f Orast»,
- Page 190:
AUCUNS. — FOÉSHL ?era dans l'Oly
- Page 194:
le dois mm Vmmm : son teisirtniieex
- Page 198:
êmte9 Mt*Ëf éMfêèti§wétpmimF
- Page 202:
etaré que le pays où Œdipe chois
- Page 206:
Hites-vous Y Faeure approetie, eatr
- Page 210:
ANCIENS. — POÉSIE* que eâm àm
- Page 214:
meut. La volcL U a recommandé ses
- Page 218:
ANCIENS, — POÉSIE. taira n'a pu
- Page 222:
Fœâipe mi m h PMtoetèle. Je nt t
- Page 226:
Bouffante* Cett en- ? Ma que In ét
- Page 230:
ANCIENS. — POÉSIE. ikt mm aeifoi
- Page 234:
ANCIENS. — POÉSIE. m s'écartent
- Page 238:
ANCIENS — POÉSIE. ils» et pour
- Page 242:
'ANCIENS. — POÉSIE. d la vwteêi
- Page 246:
CeilsetMm d'Héetbe, dans l v origi
- Page 250:
Aicms. — POÉSIE. fiait défendre
- Page 254:
ANCIENS. — POÉSIE. «sut» -ut I
- Page 258:
ANCIENS. — POÉSIE. di®iis ebes
- Page 262:
AMCONS. — POÉSIE. CHAPITRE ¥1.
- Page 266:
•ANCIENS. — POÉSIE. une emmêM
- Page 270:
ANQEfS. • aapembléas 9 m Mm de d
- Page 274:
CâmrtpMk. M y est, et il n'y est p
- Page 278:
AUCUNS. — POÉSIE. tant emprunté
- Page 282:
ANCIENS. — POÉSIE. le plus grand
- Page 286:
ANCIENS. — POÉSIE. pour Mr inté
- Page 290:
entre Mereure et la Nuit. Mais il e
- Page 294:
lance des deux frères est le resso
- Page 298:
ANCIENS. — POÉSIE. 145 •eron p
- Page 302:
Il sagesse de son élè?a an désor
- Page 306:
«ne disposition très-prompte à r
- Page 310:
ANCIENS. — POÉSIE. mce iMac, tan
- Page 314:
Ml*!» #èf« profuie* le itfessjs
- Page 318:
ANCIENS. — POÉSIE. CHAPITEE VII.
- Page 322:
ANCIENS. de les wnfenner toutes dan
- Page 326:
ANCIENS, ssngenit qu'à m garantir
- Page 330:
ANCIENS. — POÉSIE. Ost qu'en eff
- Page 334:
ANCIENS. — POÉSIE. «in premier
- Page 338:
ANCIENS, - POÉSIE. les sa Pkormh,
- Page 342:
ANCIENS. — POÉSIE, mépris injus
- Page 346:
AUCUNS. — POÉSIE. smtiéii où I
- Page 350:
AUCUNS. — POÉSIE. suivit songoit
- Page 354:
ANCIENS. — POÉSIE. 17» ment des
- Page 358:
ANCIENS. — POÉSIE. mène à Cynt
- Page 362:
DISCOURS SUE U STYLE DES PROPHÈTES
- Page 366:
noiit^Deft ? ¥ en i-t»§i cafta»
- Page 370:
ANCIENS. — POÉSIE. leur poésie,
- Page 374:
ce qui est sacré en le rapprochant
- Page 378:
ANCIENS. — FOÉUL 181 fail import
- Page 382:
ANCIENS. — POÉSIE. ces rapproche
- Page 386:
ANCIENS. — POÉSIE. 189 Mali pour
- Page 390:
ANCIENS. — POÉSIE. 191 île nos-
- Page 394:
ANCIENS POESIE. phète Mm raéchan^
- Page 398:
m ne mm point écarté de votre loi
- Page 402:
ANCIENS. — POÉSIE. s'il le TOII,
- Page 406:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. «if le at
- Page 410:
de jorimaiato et d'avocat. L'éloqu
- Page 414:
ANCIENS. — ÉLOQUBiaL long travai
- Page 418:
ANCIENS..— ÉLOQUENCE. lêê a ri
- Page 422:
ANCIENS. - ÉLOQUENCE. apprend 1 10
- Page 426:
ANCIENS. - ÉLOQUENCE. so§ d'appar
- Page 430:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. •t 1 leu
- Page 434:
de Bossuet et de Fléehîer, dans l
- Page 438:
ANGDBB. — ÉUMHMNCai. Huait de im
- Page 442:
ANCam S. — tiLOQlflBICR. gtylteot
- Page 446:
mcnis. — dite, on l'agrément les
- Page 450:
ANCIENS. — ÉL0QU1NCB. ni surtout
- Page 454:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. des exempl
- Page 458:
ANCIEWS. — ÉLOQUENCE. unes qui s
- Page 462:
ANCIENS; — •f près île Terreu
- Page 466:
mus la vieille autorité de deux ma
- Page 470:
presque mtlèmmmtàf mm it Crassus.
- Page 474:
flou mr les monstres qui f m vMmt l
- Page 478:
nom leur médiocrité, nommaient me
- Page 482:
de ce wm4à. DèMmtrer, ceci BOUS,
- Page 486:
AUCUNS. — ÉLOQUENCE. p'iin disco
- Page 490:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. tirés gé
- Page 494:
C'est précisément limage de Démo
- Page 498:
êevetar , F amitié 9 là mmmàê
- Page 502:
" ^CIENS, — ALOQUKNQL #IM grand h
- Page 506:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. à sa fort
- Page 510:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. tflfif mê
- Page 514:
dtâkms de la pâli, ne fous a-t-il
- Page 518:
à défendre? il s'agissait de just
- Page 522:
'ANCIENS. — ÉLOQUENCE. chose que
- Page 526:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. use Isvasl
- Page 530:
temps et du laigap, mais qui. alors
- Page 534:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. d'Athènes
- Page 538:
ANCIENS. — ÉLOQUJENC& Lorsqu'il
- Page 542:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. mmml objet
- Page 546:
net allés, tendis que, depuis tint
- Page 550:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. Geéron ,
- Page 554:
AlOENS. — ÉLOQUENCE. masquait pa
- Page 558:
« J'en #§ wmmâ ilst ctevaHen kmm
- Page 562:
moment de crise : il savait que les
- Page 566:
AUCUNS. — ÉLOQUENCE. « Matstena
- Page 570:
point en Colère. — Mais efet on
- Page 574:
AUCUNS. — ÉLOQUENCE. t;toot m*an
- Page 578:
faas les esprits élites vie fores
- Page 582:
.ANCIENS. — ÉMIQUENCE. de plus e
- Page 586:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. «te hôte
- Page 590:
•JtsîMMqirttdsiWÉMtoBip é^»Mm
- Page 594:
ANCIENS. — ÉLOQUENCElysepa? qué
- Page 598:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. torrat eja
- Page 602:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. dais le se
- Page 606:
paru qu'elle Pétait, c'est-à-dire
- Page 610:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. cUes-même
- Page 614:
AHCRR S. — ÉLOQUENCE, ?aît plus
- Page 618:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE US kir. 11
- Page 622:
ANCIENS. — ÉLOQUUCE. d'Antoine.
- Page 626:
ANCIENS. - ÉLOQUENCE. 909 ne la fr
- Page 630:
étroit et escarpé, oà tout le mo
- Page 634:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. lessost»i
- Page 638:
ANCIENS- — ÉLOQUENCE. fruits qu'
- Page 642:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. après, le
- Page 646:
ANCIENS. — ÉLOQUENCE. 319 nom y
- Page 650:
cette inclination que l'on attribue
- Page 654:
suis cas vrai fatoêant. Cependant
- Page 658:
pfobabilités su? celle de nos idé
- Page 662:
ceftiî nous est resté \ U avait
- Page 666:
a fuir bien moins tr&falllé que qu
- Page 670:
I m'est dont pas étonnant que des
- Page 674:
iolae, etle parallèle deèe princt
- Page 678:
ANCIINS. — garni vouloir dire, av
- Page 682:
tar c'est ce qui arrive te plus sou
- Page 686:
mmèmu&mlMtimÊMèêMlmm9 produits
- Page 690:
connut parmi nous, et pi lai Irent
- Page 694:
ANCIENS. — PHILOSOPHE. 843 ierra
- Page 698:
ANCIENS. — PH0LOSOPHIB. la douleu
- Page 702:
la leetun de Platon fui détermina
- Page 706:
gouvernements est la tmmmhk, et le
- Page 710:
ANCIENS. — PHILOSOPHE. lion est c
- Page 714:
voir et.de la vertu. Mais on se put
- Page 718:
même transportés sur la scène f
- Page 722:
l'humilité f il It f oir une fois
- Page 726:
ANCIENS. — PHILOSOPHIE. S59 petit
- Page 730:
l'amitié seule peut la porter. »
- Page 734:
ANCIENS. — PHILOSOPHIE. 3§S pass
- Page 738:
ANCIENS. — PHILOSOPHIE. S65 têt
- Page 742:
ANCHOIS. — PHILOSOPHIE. qu'ils é
- Page 746:
de persuasion dans la chose où il
- Page 750:
misme9 ©a -stït qu'il Tairait pri
- Page 754:
. ANCIENS. pendant six cents ans ;
- Page 758:
il fuppute les plus rares, et se se
- Page 762:
Ce mot, l'effroi de cour et l'effro
- Page 766:
a?m déjà vu dans Socrtte 9 dans P
- Page 770:
ANCIENS. — PHILOSOPHE. m qui est
- Page 774:
seul fui ait été en titre pur son
- Page 778:
'AUCUNS. — PHILOSOPHE. 18$ f«tir
- Page 782:
ANCIENS. — PMLOSOPim Éfj»l§tl
- Page 786:
idée boite, grande! prqfittwk, est
- Page 790:
ANCIENS. — PHILOSOPHE. 391 est fi
- Page 794:
d'une ?I# f Mat et entière à une.
- Page 798:
saisis de la justesse de «s rappor
- Page 802:
-ANciDi& — dn médmnt. Mais là c
- Page 806:
ANCIENS. — PHUJOSOPMIL m§ le lai
- Page 810:
* que le fer eût mmillé l'âme ic
- Page 814:
m par la fougue delà Jeunesse, si
- Page 818:
Cela paraissait plus commode à Mon
- Page 822:
je n'a?ais jamais songé qu'il fall
- Page 826:
ANCIENS. - VBBMOPBnL MB ici opposer
- Page 830:
ANCIENS. — PHILOSOPHIE. 411 pocrU
- Page 834:
AUCUNS. — PHILOSOPHIE. 413 d'amou
- Page 838:
ANCIENS. - PHILOSOPHIE £ ï ^ " '
- Page 842:
ANCIENS. — PHILOSOPHIE. publie es
- Page 846:
ANCIENS. — PHILOSOPHIE. ¥@m acnl
- Page 850:
ANCIENS. — PHILOSOPHIE. 421 m se
- Page 854:
ANCIENS. — LITTÉEAT01E MÊLÉE.
- Page 858:
ANCIENS. — L1TTÉ1ATU1E MÊLÉE.
- Page 862:
SIèCLE 1» wwis xnr. — Dmopucrio
- Page 866:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — INTRODUCT
- Page 870:
SIÈCLE Dl LOCIS XIV. — INflOBlIC
- Page 874:
SIÈCLE DK LOUIS IIV. — INTRODUCT
- Page 878:
SIECLE DE LOUIS XIV. — IOT10DHCTK
- Page 882:
SIÈCLE DB LOUIS XIV. — nOBGDUCII
- Page 886:
SIÈCLE JMË LOUIS XIV. — 1NTEOBU
- Page 890:
«si agréable en elle-même, comme
- Page 894:
S1ÈCIJE DE LOUIS M?. — JPQÉSH.
- Page 898:
Usa tutnt pin mocm se I De n'assail
- Page 902:
pli f iiiit ©et «droit au 1 dil m
- Page 906:
H OU8 Ftf oiis ¥» tout à rfaeure
- Page 910:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE,
- Page 914:
SIÈCLE DE LOUIS XI?. — POÉSIE.
- Page 918:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 922:
et fort intéressant pour le roi go
- Page 926:
Vil autre tombe-t-il en défaillanc
- Page 930:
SIÈCLE DS IOTIS XIV. — POÉSIE.
- Page 934:
SIÈCLE DE LOUIS XIY. — POÉSIE.
- Page 938:
SIÈCLE DE LOUIS X|V. — POÉSIE.
- Page 942:
SIÈCLE DE LOUIS XW. - POÉSIE. est
- Page 946:
traité lept fois pour la scène fr
- Page 950:
SIÊCJLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 954:
monologue do Médée, imité de Sé
- Page 958:
11 est de plus Intéressait, puisqu
- Page 962:
considérer rartdramatique. C'est
- Page 966:
SIÈCLE Bl WMJ1S XIV. — FOÉm Mai
- Page 970:
utopie méprise trèsnistanlle, san
- Page 974:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 978:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 982:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 986:
acte , rempli do traits de force et
- Page 990:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 994:
le spectateur, qui n'a rien aperçu
- Page 998:
SIÈCLE NE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1002:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1006:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1010:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1014:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.'
- Page 1018:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1022:
ees subtilités sont beaucoup trop
- Page 1026:
SIÈCLE DB IDUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1030:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE B
- Page 1034:
tufiuiee, et que les oumgei d'Homè
- Page 1038:
Tautreattachait les regards parées
- Page 1042:
SIÈCLE DE LOUIS XI?. — POÉSIE.
- Page 1046:
peine Agrippioe fa-t-elle qaitté,
- Page 1050:
Mais de tout faillie» quel sera te
- Page 1054:
dant du rang suprême et contre J'o
- Page 1058:
Combien « mot cruel est affreux qu
- Page 1062:
SIÈCLE DE LOUIS XIY. — fOÉSIE.
- Page 1066:
SIÈCLE DE LOUIS XI?. — POÉSIE.
- Page 1070:
m convenir, que c'est y à mon gré
- Page 1074:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1078:
àms fort» du eekle attend note©
- Page 1082:
Ao-dearas i«'&w flot» ss naufrage
- Page 1086:
Des hamismêÊ M beau tertio!»» C
- Page 1090:
forme à oettejuste ferlé» si nat
- Page 1094:
SIÈCLE DE MMHS XIV. — MÉSDL IM
- Page 1098:
Et Jamais dans La** un Me le raviss
- Page 1102:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1106:
41 ! nalhwfetix âreai ! te m'as tr
- Page 1110:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1114:
connu du reste de l'armée. Us autr
- Page 1118:
il produit à la fois sur une mère
- Page 1122:
l'Innocent Hippolyte, plutôt que s
- Page 1126:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1130:
mm amour pour HIppolyte avec beauco
- Page 1134:
pir lorsque je me trou?a entre toi
- Page 1138:
SIÈCLE DE LOU» XIV. — POÉSIE.
- Page 1142:
fÉlntB. Ah! mâchera Aride»' H «
- Page 1146:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1150:
f«#i Aaeine était capable 9 011 s
- Page 1154:
'SIèCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1158:
MQI énoncé présenté une sorte d
- Page 1162:
On a déjà fti dans ce peu de vers
- Page 1166:
tère, et ries se Fa eu depuis. Tou
- Page 1170:
effet, parce qu'elle succède à un
- Page 1174:
teur ne condamne tout ce dont Matha
- Page 1178:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POÉSIE, qu
- Page 1182:
SIÈCLi; DE LOUIS XIV.' — POÉSIE
- Page 1186:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1190:
SIÈCLE DE LOUIS HV. — POÉSIE. d
- Page 1194:
SIÈCLE DE LOUIS XI?. — POÉSIE.
- Page 1198:
SIÈCLE BB LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1202:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1206:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1210:
Corneille n'est pas moins grand dan
- Page 1214:
Ta veto KM puisants étage» s Donn
- Page 1218:
Votre mmumme kmmeur lui M toujours
- Page 1222:
Ka suer, an nom d'amour, et par pli
- Page 1226:
ailles* Os conçoit encore moins qu
- Page 1230:
de mort très-légalement renie, qu
- Page 1234:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1238:
SIÈCLE m LOUIS XIV. — POÉSIE. q
- Page 1242:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1246:
pli» à propos de la faire connaî
- Page 1250:
Smm mon audace, AfMn, Je me cache
- Page 1254:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1258:
Quînault C'était an reste du goû
- Page 1262:
SIÈCLE DK LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1266:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1270:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1274:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POÉSIE. n'
- Page 1278:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POESIE. 68i
- Page 1282:
le ntsttaMlral toq|oait, morilles,
- Page 1286:
Quand on entend cet excellent dialo
- Page 1290:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1294:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1298:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1302:
lesser les bienséances, ce qui ; s
- Page 1306:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1310:
des procédés. On sait que Boiieau
- Page 1314:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1318:
•SIÈCLE Dl LOUIS XIV. — POÉSI
- Page 1322:
grande qu v elle peut Titre, le con
- Page 1326:
SIÈCLE BI LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1330:
L'opéra tel qu'il a été depuis Q
- Page 1334:
Ce ftit ter ton diamant rlva§e Que
- Page 1338:
qu'elle fat l'époque de Fiiion de
- Page 1342:
SIÈCLE BE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1346:
Us songe iffceoz m'Inspire nue fure
- Page 1350:
SIÈCLE DE LOUIS XIY. — POÉSIE.
- Page 1354:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1358:
?er ik la monotonie; et l'un sait l
- Page 1362:
Et qui, des pieds touchant la terre
- Page 1366:
Et glacer ses rives d'effroi : Tel
- Page 1370:
SIÈCLE DE LOUIS X1Y. — POÉSIE.
- Page 1374:
les lauriers de César ; mais la ra
- Page 1378:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POESIE. for
- Page 1382:
Tous tes lecteurs mit l«i» goûts
- Page 1386:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1390:
SIÈCLE DE LOUIS XIY. — POÉSIE.
- Page 1394:
un homme qui joignit au génie dram
- Page 1398:
Traîné du fond des bols un cerf
- Page 1402:
SIÈCLE DE LOUIS avec peu d'effet.
- Page 1406:
SIÈCLE DI LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1410:
te*** djmpnmer «arment : Si le bur
- Page 1414:
Mais vous f pair es parier, vous y
- Page 1418:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE-
- Page 1422:
SIÈCLE DE LOUIS X1Y. — POÉSIE.
- Page 1426:
seule férité qu'il y ait dans cel
- Page 1430:
SIÈCLE DE. LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1434:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1438:
SIÈCLE DE LOUIS XIY. — POÉSIE.
- Page 1442:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE d
- Page 1446:
Yen, au lieu d'aller partout décri
- Page 1450:
n Sait 6)*une ¥olx légère, « Pa
- Page 1454:
SIÈCLE m LOUIS XIV. — POÉSIE. f
- Page 1458:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1462:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1466:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1470:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1474:
SIECLE DE LOUIS XIY. — POÉSIE. 7
- Page 1478:
fialiiir à tep ÉMs • te irten d
- Page 1482:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1486:
Qu'en solvant cet objet dont vous
- Page 1490:
* Comme on ¥@§t quelquefois par l
- Page 1494:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POESIE Jvee
- Page 1498:
erger : les frais bergers ne parlen
- Page 1502:
SIÈCLE DE LOUIS XIV. — POÉSIE.
- Page 1506:
TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS