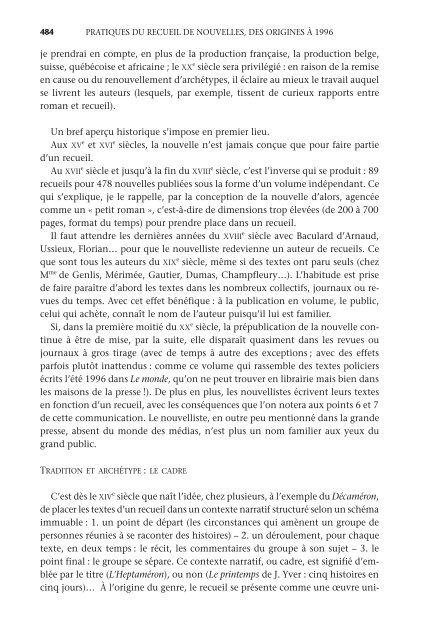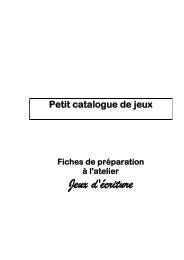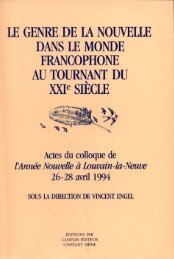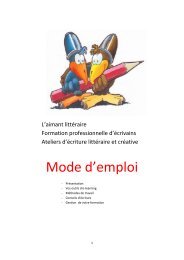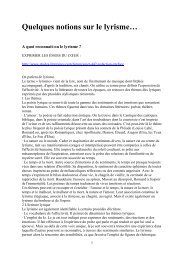- Page 1 and 2:
La nouvelle de langue française au
- Page 3 and 4:
PRÉAMBULE Trois ans après la publ
- Page 5 and 6:
FLORENCE BOUCHET 7 LA NOUVELLE À L
- Page 7 and 8:
FLORENCE BOUCHET 9 et médiévales,
- Page 9 and 10:
FLORENCE BOUCHET 11 Autre fait marq
- Page 11 and 12:
FLORENCE BOUCHET 13 clenche les his
- Page 13 and 14:
FLORENCE BOUCHET 15 Thomas de Saluc
- Page 15 and 16:
FLORENCE BOUCHET 17 refuse pour res
- Page 17 and 18:
FLORENCE BOUCHET 19 couper la tête
- Page 19 and 20:
FLORENCE BOUCHET 21 sonnages, on pa
- Page 21 and 22:
PROPOS D’ANTICHAMBRE : LES PIÈCE
- Page 23 and 24:
MADELEINE JEAY 25 commerce - l’im
- Page 25 and 26:
MADELEINE JEAY 27 velles, qui devra
- Page 27 and 28:
MADELEINE JEAY 29 y reprend le moti
- Page 29 and 30:
MADELEINE JEAY 31 conséquences sur
- Page 31 and 32:
MADELEINE JEAY 33 situe le contexte
- Page 33 and 34:
MADELEINE JEAY 35 n’ont rien à v
- Page 35 and 36:
MADELEINE JEAY 37 versité de Lyon
- Page 37 and 38:
MADELEINE JEAY 39 68 Ibid., p.␣ 1
- Page 39 and 40:
GABRIEL PÉROUSE 41 vis/deviser␣
- Page 41 and 42:
GABRIEL PÉROUSE 43 ment, etc. 13 )
- Page 43 and 44:
GABRIEL PÉROUSE 45 voulu intituler
- Page 45 and 46:
GABRIEL PÉROUSE 47 narrations brè
- Page 47 and 48:
LE PROBLÈME DU GENRE DANS LES COMP
- Page 49 and 50:
CLAUDE LA CHARITÉ 51 Cent nouvelle
- Page 51 and 52:
CLAUDE LA CHARITÉ 53 mensonger. Ro
- Page 53 and 54:
CLAUDE LA CHARITÉ 55 cul␣ », da
- Page 55 and 56:
CLAUDE LA CHARITÉ 57 G.␣ Mathieu
- Page 57 and 58:
37. aiant fourny son compte (p.␣
- Page 59 and 60:
CLAUDE LA CHARITÉ 61 6 Gabriel-A.
- Page 61 and 62:
ALAIN CULLIÈRE 63 d’Europe, fort
- Page 63 and 64:
ALAIN CULLIÈRE 65 nent au recueil
- Page 65 and 66:
ALAIN CULLIÈRE 67 Tout à fait car
- Page 67 and 68:
ALAIN CULLIÈRE 69 gulaires, qui n
- Page 69 and 70:
ALAIN CULLIÈRE 71 4. Recueil de pl
- Page 71 and 72:
ALAIN CULLIÈRE 73 5. Le quatorziè
- Page 73 and 74:
ALAIN CULLIÈRE 75 [36] (Pauli-Guic
- Page 75 and 76:
LES OBJETS DE LA MIMESIS : ENQUÊTE
- Page 77 and 78:
CHRISTINE NOILLE-CLAUZADE 79 explic
- Page 79 and 80:
CHRISTINE NOILLE-CLAUZADE 81 tion t
- Page 81 and 82:
CHRISTINE NOILLE-CLAUZADE 83 Cette
- Page 83 and 84:
Ce que Racine reprend ainsi : CHRIS
- Page 85 and 86:
CHRISTINE NOILLE-CLAUZADE 87 Le vé
- Page 87 and 88:
CHRISTINE NOILLE-CLAUZADE 89 d’un
- Page 89 and 90:
DELPHINE DENIS 91 des Nouvelles␣
- Page 91 and 92:
DELPHINE DENIS 93 qu’on introduit
- Page 93 and 94:
DELPHINE DENIS 95 Il y a encore à
- Page 95 and 96:
DELPHINE DENIS 97 J’en voudrois u
- Page 97 and 98:
DELPHINE DENIS 99 «␣ espagnole
- Page 99 and 100:
DELPHINE DENIS 101 dévotes du règ
- Page 101 and 102:
NOTES DELPHINE DENIS 103 1 Celinte,
- Page 103 and 104:
DELPHINE DENIS 105 35 Telle est en
- Page 105 and 106:
DELPHINE DENIS 107 77 Les nouvelles
- Page 107 and 108:
DE L’ACTUALITÉ DE LA NOUVELLE MA
- Page 109 and 110:
MARIE-CHRISTINE PIOFFET 111 manièr
- Page 111 and 112:
MARIE-CHRISTINE PIOFFET 113 dent l
- Page 113 and 114:
MARIE-CHRISTINE PIOFFET 115 offre l
- Page 115 and 116:
MARIE-CHRISTINE PIOFFET 117 5 lle A
- Page 117 and 118:
L’ENCHÂSSEMENT DES RÉCITS AU XV
- Page 119 and 120:
ANNE-ÉLISABETH SPICA 121 Si l’au
- Page 121 and 122:
ANNE-ÉLISABETH SPICA 123 et de la
- Page 123 and 124:
ANNE-ÉLISABETH SPICA 125 espagnole
- Page 125 and 126:
ANNE-ÉLISABETH SPICA 127 pendant v
- Page 127 and 128:
ANNE-ÉLISABETH SPICA 129 Je ne tro
- Page 129 and 130:
ANNE-ÉLISABETH SPICA 131 16 Ibid.,
- Page 131 and 132:
DOLORES TOMA 133 les déserts, dans
- Page 133 and 134:
DOLORES TOMA 135 L’ancienne esth
- Page 135 and 136:
NOTES DOLORES TOMA 137 1 DU PLAISIR
- Page 137 and 138:
IOANA MARASESCU 139 XVIII e siècle
- Page 139 and 140:
IOANA MARASESCU 141 commune, les hi
- Page 141 and 142:
IOANA MARASESCU 143 tion d’une no
- Page 143 and 144:
IOANA MARASESCU 145 du siècle, la
- Page 145 and 146:
MARIE-EMMANUELLE PLAGNOL-DIÉVAL 14
- Page 147 and 148:
MARIE-EMMANUELLE PLAGNOL-DIÉVAL 14
- Page 149 and 150:
MARIE-EMMANUELLE PLAGNOL-DIÉVAL 15
- Page 151 and 152:
MARIE-EMMANUELLE PLAGNOL-DIÉVAL 15
- Page 153 and 154:
MARIE-EMMANUELLE PLAGNOL-DIÉVAL 15
- Page 155 and 156:
NOUVELLE, LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL
- Page 157 and 158:
FRANCE VERNIER 159 pour définir un
- Page 159 and 160:
FRANCE VERNIER 161 près de la chro
- Page 161 and 162:
FRANCE VERNIER 163 dre et de piquer
- Page 163 and 164:
NOTES FRANCE VERNIER 165 1 J’util
- Page 165 and 166:
MYRIAM WATTHÉE-DELMOTTE 167 Le liv
- Page 167 and 168:
MYRIAM WATTHÉE-DELMOTTE 169 Et si
- Page 169 and 170:
MYRIAM WATTHÉE-DELMOTTE 171 bien r
- Page 171 and 172:
MYRIAM WATTHÉE-DELMOTTE 173 Après
- Page 173 and 174:
MYRIAM WATTHÉE-DELMOTTE 175 26 Let
- Page 175 and 176:
JEAN-MICHEL WITTMANN 177 veté, se
- Page 177 and 178:
JEAN-MICHEL WITTMANN 179 mains d’
- Page 179 and 180:
JEAN-MICHEL WITTMANN 181 nouvelle,
- Page 181 and 182:
JEAN-MICHEL WITTMANN 183 En marge d
- Page 183 and 184:
JEAN-MARC DEFAYS 185 pris les forme
- Page 185 and 186:
JEAN-MARC DEFAYS 187 que sorte les
- Page 187 and 188:
JEAN-MARC DEFAYS 189 ses protagonis
- Page 189 and 190:
JEAN-MARC DEFAYS 191 simplicité ou
- Page 191 and 192:
L’ADAPTATION DES NOUVELLES DE TCH
- Page 193 and 194:
MARIE GRIBOMONT 195 dialogues sont
- Page 195 and 196:
MARIE GRIBOMONT 197 Gabriel Arout s
- Page 197 and 198:
NOTES MARIE GRIBOMONT 199 1 Ces mê
- Page 199 and 200:
PAUL MORAND NOUVELLISTE : DU PORTRA
- Page 201 and 202:
IMMACULADA ILLANES ORTEGA 203 utili
- Page 203 and 204:
IMMACULADA ILLANES ORTEGA 205 cultu
- Page 205 and 206:
IMMACULADA ILLANES ORTEGA 207 Par c
- Page 207 and 208:
IMMACULADA ILLANES ORTEGA 209 On pe
- Page 209 and 210:
IMMACULADA ILLANES ORTEGA 211 Parti
- Page 211 and 212:
L’ÉVOLUTION DU FANTASTIQUE DANS
- Page 213 and 214:
ALICIA PIQUER DESVAUX 215 Montrer l
- Page 215 and 216:
ALICIA PIQUER DESVAUX 217 Nous disi
- Page 217 and 218:
ALICIA PIQUER DESVAUX 219 disparaî
- Page 219 and 220:
ALICIA PIQUER DESVAUX 221 Dans ce r
- Page 221 and 222:
ALICIA PIQUER DESVAUX 223 Essayons
- Page 223 and 224:
MIREILLE HILSUM 225 fiction. Les pr
- Page 225 and 226:
MIREILLE HILSUM 227 du journal, qui
- Page 227 and 228:
MIREILLE HILSUM 229 tour en arrièr
- Page 229 and 230:
MIREILLE HILSUM 231 Tel était déj
- Page 231 and 232:
MIREILLE HILSUM 233 17 «␣ La sai
- Page 233 and 234:
MICHEL GUISSARD 235 cueils peut ré
- Page 235 and 236:
MICHEL GUISSARD 237 texte encadrant
- Page 237 and 238:
MICHEL GUISSARD 239 Avant de saisir
- Page 239 and 240:
MICHEL GUISSARD 241 dans la vie deu
- Page 241 and 242:
MICHEL GUISSARD 243 12 «␣ La veu
- Page 243 and 244:
MARCEL AYMÉ, OU L’ART D’ABRÉG
- Page 245 and 246:
PEDRO PARDO JIMENEZ 247 conçu comm
- Page 247 and 248:
PEDRO PARDO JIMENEZ 249 du destin d
- Page 249 and 250:
PEDRO PARDO JIMENEZ 251 Un dernier
- Page 251 and 252:
AUX CONFINS DU GENRE. TRAITEMENT DE
- Page 253 and 254:
BÉRENGÈRE DEPREZ 255 sait de ne p
- Page 255 and 256:
BÉRENGÈRE DEPREZ 257 - Le pouvoir
- Page 257 and 258:
NOTES BÉRENGÈRE DEPREZ 259 1 Il s
- Page 259 and 260:
ELS WOUTERS 261 Selon Giddey, la lo
- Page 261 and 262:
ELS WOUTERS 263 dix ans avant l’a
- Page 263 and 264:
ELS WOUTERS 265 un moyen dont l’u
- Page 265 and 266:
ELS WOUTERS 267 de ne pas en omettr
- Page 267 and 268:
ELS WOUTERS 269 En tout cas, bien q
- Page 269 and 270:
LUC BONENFANT 271 QUAND LA NOUVELLE
- Page 271 and 272:
LUC BONENFANT 273 Patrice, le père
- Page 273 and 274:
LUC BONENFANT 275 En utilisant des
- Page 275 and 276:
LUC BONENFANT 277 prose avec le ré
- Page 277 and 278:
LUC BONENFANT 279 texte de «␣ L
- Page 279 and 280:
NOTES LUC BONENFANT 281 1 Robert HA
- Page 281 and 282:
UN UNIVERS DE LA DIFFRACTION : ANDR
- Page 283 and 284:
MICHEL LORD 285 Pour mieux faire co
- Page 285 and 286:
MICHEL LORD 287 moitié gelé dans
- Page 287 and 288:
MICHEL LORD 289 bien la réalité,
- Page 289 and 290:
MICHEL LORD 291 gueurs intitulés :
- Page 291 and 292:
MICHEL LORD 293 Je n’écoute plus
- Page 293 and 294:
NOTES MICHEL LORD 295 1 Andrée MAI
- Page 295 and 296:
MADELEINE HAGE 297 JACQUELINE HARPM
- Page 297 and 298:
TEMPORALITÉ ET SPATIALITÉ MADELEI
- Page 299 and 300:
MADELEINE HAGE 301 le narrateur (le
- Page 301 and 302:
MADELEINE HAGE 303 cette «␣ infi
- Page 303 and 304:
NOTES MADELEINE HAGE 305 1 Dernier
- Page 305 and 306:
AGNÈS MAILLOT 307 bliées dans cet
- Page 307 and 308:
AGNÈS MAILLOT 309 Voilà donc l’
- Page 309 and 310:
AGNÈS MAILLOT 311 tout le contrair
- Page 311 and 312:
AGNÈS MAILLOT 313 On ne détruit p
- Page 313 and 314:
BRUNO BLANCKEMAN 315 NOUVELLE ET AU
- Page 315 and 316:
BRUNO BLANCKEMAN 317 sive l’essen
- Page 317 and 318:
BRUNO BLANCKEMAN 319 structure en l
- Page 319 and 320:
JEAN-PHILIPPE IMBERT 321 La nouvell
- Page 321 and 322:
JEAN-PHILIPPE IMBERT 323 qu’il y
- Page 323 and 324:
JEAN-PHILIPPE IMBERT 325 de vue str
- Page 325 and 326:
JEAN-PHILIPPE IMBERT 327 de par son
- Page 327 and 328:
JEAN-PHILIPPE IMBERT 329 réel. Si
- Page 329 and 330:
NOTES JEAN-PHILIPPE IMBERT 331 1 Ag
- Page 331 and 332:
BEATRICE BARBALATO 333 tente de per
- Page 333 and 334:
BEATRICE BARBALATO 335 exemplificat
- Page 335 and 336:
BEATRICE BARBALATO 337 L’histoire
- Page 337 and 338:
BEATRICE BARBALATO 339 quées dans
- Page 339 and 340:
BEATRICE BARBALATO 341 fendre, non
- Page 341 and 342:
BEATRICE BARBALATO 343 Quand pourta
- Page 343 and 344:
BEATRICE BARBALATO 345 36 G. CELATI
- Page 345 and 346:
«␣ TROMPE-LA-MORT 6 ␣» DE MAR
- Page 347 and 348:
NICOLE BAJULAZ-FESSLER 349 On noter
- Page 349 and 350:
NICOLE BAJULAZ-FESSLER 351 devient
- Page 351 and 352:
NICOLE BAJULAZ-FESSLER 353 6 Marc P
- Page 353 and 354:
JEAN-PIERRE BLIN 355 Frédéric Mor
- Page 355 and 356:
JEAN-PIERRE BLIN 357 homme qui tire
- Page 357 and 358:
JEAN-PIERRE BLIN 359 des d’expres
- Page 359 and 360:
JEAN-PIERRE BLIN 361 d’une des Vi
- Page 361 and 362:
JEAN-PIERRE BLIN 363 8 Raymond CARV
- Page 363 and 364:
FRANCO DELVECCHIO 365 De manière p
- Page 365 and 366:
FRANCO DELVECCHIO 367 nouvelle. La
- Page 367 and 368:
FRANCO DELVECCHIO 369 NOTES 1 À no
- Page 369 and 370:
RÉGIS DUQUÉ 371 aux seuls romanci
- Page 371 and 372:
RÉGIS DUQUÉ 373 La présence souv
- Page 373 and 374:
RÉGIS DUQUÉ 375 Ne retrouve-t-on
- Page 375 and 376:
LA NOUVELLE ET LE TEXTE DRAMATIQUE
- Page 377 and 378:
JEAN-PAUL DUFIET 379 L’espace, ou
- Page 379 and 380:
JEAN-PAUL DUFIET 381 dépossédé.
- Page 381 and 382:
JEAN-PAUL DUFIET 383 évolution psy
- Page 383 and 384:
JEAN-PAUL DUFIET 385 théâtralité
- Page 385 and 386:
RENÉ AUDET 387 LE RECUEIL DE NOUVE
- Page 387 and 388:
RENÉ AUDET 389 cours de cette pér
- Page 389 and 390:
RENÉ AUDET 391 fictions narratives
- Page 391 and 392:
RENÉ AUDET 393 Chaque nouvelle con
- Page 393 and 394:
RENÉ AUDET 395 15 Tables des mati
- Page 395 and 396:
CARMEN CAMERO PEREZ 397 suite du th
- Page 397 and 398:
CARMEN CAMERO PEREZ 399 histoire :
- Page 399 and 400:
NOTES CARMEN CAMERO PEREZ 401 1 R.
- Page 401 and 402:
ÉVELYNE BALLANFAT 403 nouvelles qu
- Page 403 and 404:
ÉVELYNE BALLANFAT 405 n’est pas,
- Page 405 and 406:
ODETTE, JEANINE, SIMONE, THÉRÈSE
- Page 407 and 408:
LAURENT MARIE 409 intersections ne
- Page 409 and 410:
LAURENT MARIE 411 Les petites fille
- Page 411 and 412:
LAURENT MARIE 413 les nouvelles «
- Page 413 and 414:
LAURENT MARIE 415 15 Le magazine li
- Page 415 and 416:
CHRISTINE MASUY 417 constater combi
- Page 417 and 418:
CHRISTINE MASUY 419 raison entre le
- Page 419 and 420:
CHRISTINE MASUY 421 celui de l’au
- Page 421 and 422:
CHRISTINE MASUY 423 Car ce sont bel
- Page 423 and 424:
CHRISTINE MASUY 425 la RTBF. Cf. Do
- Page 425 and 426:
OLIVIER DEZUTTER ET FRANCINE SOHIER
- Page 427 and 428:
OLIVIER DEZUTTER ET FRANCINE SOHIER
- Page 429 and 430:
OLIVIER DEZUTTER ET FRANCINE SOHIER
- Page 431 and 432: INTRODUCTION LA STATISTIQUE LEXICAL
- Page 433 and 434: CÉDRICK FAIRON 435 Représentation
- Page 435 and 436: CÉDRICK FAIRON 437 porain 18 , ét
- Page 437 and 438: CÉDRICK FAIRON 439 Le graphique sy
- Page 439 and 440: CÉDRICK FAIRON 441 cette symétrie
- Page 441 and 442: CÉDRICK FAIRON 443 19 B.U., §␣
- Page 443 and 444: MARY GALLAGHER 445 Pour sonder plus
- Page 445 and 446: MARY GALLAGHER 447 Il y avait aussi
- Page 447 and 448: MARY GALLAGHER 449 nant dans les co
- Page 449 and 450: MARY GALLAGHER 451 19 Gisèle PINEA
- Page 451 and 452: MICHEL NAUMANN 453 anciens, elle le
- Page 453 and 454: MICHEL NAUMANN 455 pourrons éviter
- Page 455 and 456: Le poème d’introduction est à c
- Page 457 and 458: MICHEL NAUMANN 459 et dangereux pou
- Page 459 and 460: LA NOUVELLE AFRICAINE FRANCOPHONE D
- Page 461 and 462: GUY OSSITO MIDIOHOUAN 463 ment 4 -,
- Page 463 and 464: GUY OSSITO MIDIOHOUAN 465 Fatim d
- Page 465 and 466: GUY OSSITO MIDIOHOUAN 467 Les même
- Page 467 and 468: GUY OSSITO MIDIOHOUAN 469 Plus souv
- Page 469 and 470: GUY OSSITO MIDIOHOUAN 471 13 Il fau
- Page 471 and 472: LA VOIX DES CONTES Le mot prononcé
- Page 473 and 474: G. OTTILIA MATE 475 Dans le cas du
- Page 475 and 476: G. OTTILIA MATE 477 La vision d’u
- Page 477 and 478: G. OTTILIA MATE 479 auprès de la t
- Page 479 and 480: G. OTTILIA MATE 481 15 Le héros, h
- Page 481: PRATIQUES DU RECUEIL DE NOUVELLES D
- Page 485 and 486: RENÉ GODENNE 487 - La jeunesse du
- Page 487 and 488: RENÉ GODENNE 489 3. n’utiliser a
- Page 489 and 490: RENÉ GODENNE 491 Ce sera encore en
- Page 491 and 492: RENÉ GODENNE 493 Le troisième, J.
- Page 493 and 494: RENÉ GODENNE 495 bre), les textes
- Page 495 and 496: RENÉ GODENNE 497 la mode (J. Ray)
- Page 497 and 498: RENÉ GODENNE 499 recherche d’uni
- Page 499 and 500: RENÉ GODENNE 501 D.␣ Daeninckx (
- Page 501 and 502: DE L’EMPÊCHEMENT LYRIQUE DE LA N
- Page 503 and 504: THIERRY OZWALD 505 Que dire de ce p
- Page 505 and 506: THIERRY OZWALD 507 Détail intéres
- Page 507 and 508: THIERRY OZWALD 509 En vérité s’
- Page 509 and 510: THIERRY OZWALD 511 1. que la nouvel
- Page 511 and 512: LA NOUVELLE, UNE FORME POÉTIQUE ?
- Page 513 and 514: le garçon a les yeux si clairs pui
- Page 515 and 516: COLETTE NYS-MAZURE 517 Nous remarqu
- Page 517 and 518: COLETTE NYS-MAZURE 519 Il suffit de
- Page 519 and 520: ALEXANDRE GEFEN 521 de la brièvet
- Page 521 and 522: ALEXANDRE GEFEN 523 isolés sont in
- Page 523 and 524: ALEXANDRE GEFEN 525 effet de réel,
- Page 525 and 526: ALEXANDRE GEFEN 527 Mais des appels
- Page 527 and 528: ALEXANDRE GEFEN 529 D’autres desc
- Page 529 and 530: ALEXANDRE GEFEN 531 P.␣ Michon, o
- Page 531 and 532: ALEXANDRE GEFEN 533 de la Pléiade
- Page 533 and 534:
ALEXANDRE GEFEN 535 en souffrance q
- Page 535 and 536:
GAËTAN BRULOTTE 537 performatifs i
- Page 537 and 538:
GAËTAN BRULOTTE 539 montre, et, ce
- Page 539 and 540:
GAËTAN BRULOTTE 541 Sur le seuil,
- Page 541 and 542:
GAËTAN BRULOTTE 543 roman (il y a
- Page 543 and 544:
JOHNNIE GRATTON 545 Un corollaire i
- Page 545 and 546:
JOHNNIE GRATTON 547 D’une part, d
- Page 547 and 548:
JOHNNIE GRATTON 549 même est morti
- Page 549 and 550:
ÉVELYNE BALLANFAT 551 LA NOTION DE
- Page 551 and 552:
ÉVELYNE BALLANFAT 553 l’effroi.
- Page 553 and 554:
L’APOLOGUE Riche, quand il maria
- Page 555 and 556:
JEAN CLAUDE BOLOGNE 557 Inutile de
- Page 557 and 558:
JEAN CLAUDE BOLOGNE 559 détournée
- Page 559 and 560:
JEAN CLAUDE BOLOGNE 561 moralité.
- Page 561 and 562:
JEAN CLAUDE BOLOGNE 563 sairement c
- Page 563 and 564:
JEAN CLAUDE BOLOGNE 565 qu’il gé
- Page 565 and 566:
TABLE DES MATIÈRES Préambule (V.
- Page 567:
JEAN CLAUDE BOLOGNE 569 APPROCHES D