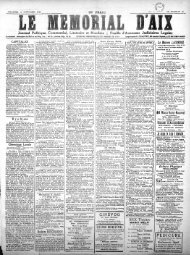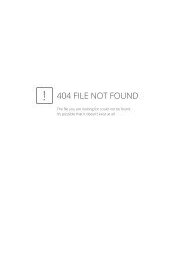- Page 2 and 3:
AVANT PROPOSLe Plein emploi est une
- Page 5 and 6:
10° Les effets du chômage P : 235
- Page 10 and 11:
Alors que, vers 1800, la France ét
- Page 12 and 13: droite, où TARDIEU 15 lance un pla
- Page 14 and 15: est usé et vétuste, dans la mesur
- Page 16 and 17: Graphique II : Taux de croissance d
- Page 18 and 19: Le Produit Intérieur Brut - PIB me
- Page 20 and 21: éforme du fermage et du métayage,
- Page 22 and 23: C’est donc sur ses propres forces
- Page 24 and 25: anques (lois DEBRE de 1966 et 1967,
- Page 26 and 27: Cette politique de concentration s
- Page 28 and 29: Graphique VI : Taux de croissance a
- Page 30 and 31: En réalité, les choix effectués
- Page 32 and 33: adopté en 1975 par le Premier mini
- Page 34 and 35: inéluctable du chômage et les dé
- Page 36 and 37: À partir de 1987, cependant, le no
- Page 38 and 39: Le dernier aspect de la modernisati
- Page 40 and 41: La première moitié des années 90
- Page 42 and 43: qu'elles n'avaient pas réussi à a
- Page 44 and 45: approches nouvelles comme la « gri
- Page 46 and 47: 1° La crise d’un systèmeLa soud
- Page 48 and 49: 2° Approches et méthodesAprès un
- Page 50 and 51: L'environnement logistique est impo
- Page 52 and 53: Sans doute, cette «liberté» éta
- Page 54 and 55: travail contre argent. La relation
- Page 56 and 57: 2° Vers la société salarialeAu t
- Page 58 and 59: La tendance est évidente: même le
- Page 60 and 61: pratique a été réglementée afin
- Page 64 and 65: d’activité, peuvent prendre des
- Page 66 and 67: d’utilité, effectuée comme une
- Page 68 and 69: productive. Elle se traduit par un
- Page 70 and 71: L'émergence de la conception moder
- Page 72 and 73: juridique ou de politique des resso
- Page 74 and 75: la main d'œuvre, un taux d'utilisa
- Page 76 and 77: inchangé. Toute situation où le p
- Page 78 and 79: théorie de la croissance (TINBERGE
- Page 80 and 81: Le progrès technique se trouve ain
- Page 82 and 83: La première étape est de rassembl
- Page 84 and 85: l'équivalent de ce que le pays pro
- Page 86 and 87: Cet exemple américain trouve son p
- Page 88 and 89: (ils n'apprécient pas nettement le
- Page 90 and 91: Le concept de Nairu (Non-Accelerati
- Page 92 and 93: De la controverse, plusieurs résul
- Page 94 and 95: sont plus dès que l'on introduit q
- Page 96 and 97: * Le second effet est plus décisif
- Page 98 and 99: Ces quatre traits dessinent une ré
- Page 100 and 101: 4° La psychologie du travailLa psy
- Page 102 and 103: Les champs d’étude précédents
- Page 104 and 105: du double principe de l’absolutis
- Page 106 and 107: considérer que la protection à la
- Page 108 and 109: mission des syndicats était exclus
- Page 110 and 111: Mais avec l’arbitrage, on entre d
- Page 112 and 113:
de jugement; en outre, la procédur
- Page 114 and 115:
l’un ou l’autre aspect. Dans ce
- Page 116 and 117:
C’est un principe de liberté qui
- Page 118 and 119:
Le contrat de travail ne livre cepe
- Page 120 and 121:
salarié tient finalement à ce qu
- Page 122 and 123:
excéder deux ans. Le contrat doit
- Page 124 and 125:
Par rémunération, il faut entendr
- Page 126 and 127:
Mais cette autonomie extérieure au
- Page 128 and 129:
mêmes de sa part d’autonomie per
- Page 130 and 131:
8° Le pouvoir dans l’entrepriseU
- Page 132 and 133:
Le second aspect de l’activité i
- Page 134 and 135:
Plus précisément, il faut disting
- Page 136 and 137:
Ces changements impliquent une cour
- Page 138 and 139:
travail. Elle efface tous les proce
- Page 140 and 141:
d’orientation professionnelle. Le
- Page 142 and 143:
magasins à grande surface, les ban
- Page 144 and 145:
Les activités :* le type d'activit
- Page 146 and 147:
- La polyvalence par enrichissement
- Page 148 and 149:
Quatre erreurs majeures ont été c
- Page 150 and 151:
C’est un plan d’action, précis
- Page 152 and 153:
Cinquième défaut : le suivi indiv
- Page 154 and 155:
Le programme 7 concerne le retour
- Page 156 and 157:
phénomène résiduel qui devait se
- Page 158 and 159:
Depuis la crise des années 1970, l
- Page 160 and 161:
Par exemple un chômeur reportera s
- Page 162 and 163:
plus gros programme mondial de subv
- Page 164 and 165:
En cumulant les deux effets, l’au
- Page 166 and 167:
(1988-1991). C’est un rythme comp
- Page 168 and 169:
comme un problème social, mais com
- Page 170 and 171:
La notion de chômage est relativem
- Page 172 and 173:
Tableau 6 : récapitulatif des diff
- Page 174 and 175:
Selon les époques, on accuse contr
- Page 176 and 177:
Comme précédemment évoqué, le c
- Page 178 and 179:
Graphique XXV : Evolution du taux d
- Page 180 and 181:
La baisse des impôts (TVA, taxe d'
- Page 182 and 183:
l’ensemble des ménages, tandis q
- Page 184 and 185:
chômeurs et inactifs, n’est pas
- Page 186 and 187:
Le problème habituellement posé e
- Page 188 and 189:
les travailleurs d’origine étran
- Page 190 and 191:
occupée. Plus le chômage est réd
- Page 192 and 193:
1. l’attitude des chômeurs que l
- Page 194 and 195:
L’intégration du chômeur au mon
- Page 196 and 197:
Alors qu’en 1932 les femmes priv
- Page 198 and 199:
prend l’insertion sociale au mêm
- Page 200 and 201:
croissance et l’entrée inélucta
- Page 202 and 203:
sérieux. Le krach lui-même peut s
- Page 204 and 205:
Tel est le contexte où intervient
- Page 206 and 207:
dette (I. FISHER, 1933 254 ) ou les
- Page 208 and 209:
L’issue à la dépression des ann
- Page 210 and 211:
Cependant, ces événements présen
- Page 212 and 213:
L’idée que la période 1973-1979
- Page 214 and 215:
laisse filer à la hausse les taux
- Page 216 and 217:
Un autre économiste avait « prév
- Page 218 and 219:
Les chocs pétroliers de 1973 et 19
- Page 220 and 221:
du déficit budgétaire. Ces thèse
- Page 222 and 223:
s’est voulue résolument graduali
- Page 224 and 225:
sens purement analytique, et ne com
- Page 226 and 227:
économie. Comme l’a dit R.RAYMON
- Page 228 and 229:
Deux suggestions ont été faites p
- Page 230 and 231:
contrôler ces restructurations. Il
- Page 232 and 233:
La baisse des prélèvements soutie
- Page 234 and 235:
Détruire des emplois pour créer d
- Page 236 and 237:
10° Les effets du chômageL’effe
- Page 238 and 239:
prévu une mise en jachère de 15 %
- Page 240 and 241:
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Pan
- Page 242 and 243:
conséquence de la baisse des recet
- Page 244 and 245:
La montée du chômage contribue ai
- Page 246 and 247:
soviétiques: «Ils font semblant d
- Page 248 and 249:
nouvelles font peser sur les salari
- Page 250 and 251:
La seconde importante crise financi
- Page 252 and 253:
l'activation des dépenses passives
- Page 254 and 255:
Il en va de même du terme chômage
- Page 256 and 257:
entreprises n'ont pas de commandes
- Page 258 and 259:
II - L’EMPLOI : REPRESENTATION ET
- Page 260 and 261:
D’où un double programme; l’un
- Page 262 and 263:
concurrence. Le marché unique, ét
- Page 264 and 265:
Adam SMITH en 1776, en s’opposant
- Page 266 and 267:
facteurs complémentaires (« un ho
- Page 268 and 269:
OHLIN-VANEK, postérieur à LEONTIE
- Page 270 and 271:
formulation qui aboutit à des rés
- Page 272 and 273:
sensibilité à des chocs extérieu
- Page 274 and 275:
développement, d’une part, et la
- Page 276 and 277:
usse était-il tombé que les march
- Page 278 and 279:
et des effets de réallocation de p
- Page 280 and 281:
L’analyse comparée des systèmes
- Page 282 and 283:
technologies et de l’information.
- Page 284 and 285:
d’autorité les conditions de tra
- Page 286 and 287:
protection et au maintien de l’em
- Page 288 and 289:
autour d’une table de négociatio
- Page 290 and 291:
Nous pouvons tirer les conclusions
- Page 292 and 293:
Parmi les économies industrialisé
- Page 294 and 295:
B. LES DELOCALISATIONSUn récent ra
- Page 296 and 297:
ingénieur de recherche ou spécial
- Page 298 and 299:
la dynamique de « destruction cré
- Page 300 and 301:
L'apport théorique de Eli HECKSHER
- Page 302 and 303:
Graphique XXVIII : Cycle de vie d
- Page 304 and 305:
Si l'intérêt du libre-échange en
- Page 306 and 307:
ajoute que, sur les 30.000 départs
- Page 308 and 309:
production, afin de fabriquer ou de
- Page 310 and 311:
Le premier est la diminution de la
- Page 312 and 313:
économiques extérieures 373 du mi
- Page 314 and 315:
suivie de réouverture à l'étrang
- Page 316 and 317:
sont détectées dans une entrepris
- Page 318 and 319:
et une en 2000-2001- mais leur ampl
- Page 320 and 321:
délocalisation remonte en amont (h
- Page 322 and 323:
vers les pays où la main d’œuvr
- Page 324 and 325:
maintien des avantages acquis» qui
- Page 326 and 327:
conçus avec l’objectif, au dépa
- Page 328 and 329:
2° Le droitUn droit à la négocia
- Page 330 and 331:
On peut faire des observations anal
- Page 332 and 333:
par une convention ou accord collec
- Page 334 and 335:
pas moins que, pour les représenta
- Page 336 and 337:
Très tôt, par conséquent, il a
- Page 338 and 339:
l’entreprise ou dans un lieu mis
- Page 340 and 341:
contrat conclu entre l’ANPE (UTR)
- Page 342 and 343:
licenciement la priorité de réemb
- Page 344 and 345:
la priorité de réembauchage prév
- Page 346 and 347:
que le licenciement a été effectu
- Page 348 and 349:
section sont applicables. Le temps
- Page 350 and 351:
D. QUELQUES COURANTS DE PENSEELes p
- Page 352 and 353:
manière parfaitement cohérente. L
- Page 354 and 355:
Cette allocation des ressources ent
- Page 356 and 357:
concurrence parfaite ainsi entendue
- Page 358 and 359:
socialisme est beaucoup plus brève
- Page 360 and 361:
salariat, on rencontre les objectio
- Page 362 and 363:
est le moyen de la participation de
- Page 364 and 365:
Une bonne approximation de l’équ
- Page 366 and 367:
additionnelles appellent une augmen
- Page 368 and 369:
3° Les autres économistes et le c
- Page 370 and 371:
E. LE LICENCIEMENTLa mise à pied p
- Page 372 and 373:
accidentés du travail...).Tout lic
- Page 374 and 375:
Lorsqu’en application de l’arti
- Page 376 and 377:
alinéa, est due. Selon l’article
- Page 378 and 379:
L’ASSEDIC ne peut agir par la voi
- Page 380 and 381:
sanction est très important. En ef
- Page 382 and 383:
émunérés au mois et de 2/10 ème
- Page 384 and 385:
La loi définitive de modernisation
- Page 386 and 387:
« De quelle façon les investisseu
- Page 388 and 389:
le salarié doit justifier au minim
- Page 390 and 391:
convention aux salariés de plus de
- Page 392 and 393:
motif économique est supérieur à
- Page 394 and 395:
pour raison économique. L’adhés
- Page 396 and 397:
limite de deux mois et n’effectue
- Page 398 and 399:
orientation approfondie ou une pér
- Page 400 and 401:
minimum 6 mois, toujours avec une p
- Page 402 and 403:
défaut, prendra plus d’ampleur e
- Page 404 and 405:
Cela n’améliore pas la situation
- Page 406 and 407:
Cette nouvelle convention prévoit
- Page 408 and 409:
à la suspension et à la suppressi
- Page 410 and 411:
sur 11,43 milliard d‘€ (75 Mds)
- Page 412 and 413:
Les bénéficiaires doivent être l
- Page 414 and 415:
stratégie européenne pour l'emplo
- Page 416 and 417:
que les dispositifs profitant à de
- Page 418 and 419:
Enfin, du point de vue du degré de
- Page 420 and 421:
l’agence d’interim Start, qui a
- Page 422 and 423:
concernait son champ de compétence
- Page 424 and 425:
contexte favorable, il est aussi po
- Page 426 and 427:
DIAMANTOPOULOU 224 , a annoncé à
- Page 428 and 429:
mais l’important est l’appropri
- Page 430 and 431:
salariés dans les conseils d’adm
- Page 432 and 433:
- Danone : mobilisation généraleS
- Page 434 and 435:
aux salariés des droits leur perme
- Page 436 and 437:
Dans une lettre aux préfets datée
- Page 438 and 439:
Comment se sentir concerné par ces
- Page 440 and 441:
cours des 18 derniers mois (contre
- Page 442 and 443:
Évolution depuis juin 1997 - 1 062
- Page 444 and 445:
« Les salariés en prennent un cou
- Page 446 and 447:
Total des accords, accords sollicit
- Page 448 and 449:
Martine AUBRY précise elle-même q
- Page 450 and 451:
dans les grosses PME qui attendent
- Page 452 and 453:
libre à la négociation entre patr
- Page 454 and 455:
RESUME DE LA PARTIE II, L’EMPLOI
- Page 456 and 457:
III. LE RECLASSEMENT DES SALARIESA
- Page 458 and 459:
L'UTR accompagne le salarié dans s
- Page 460 and 461:
modalités d'application de la prot
- Page 462 and 463:
comme l'entreprise X, doivent faire
- Page 464 and 465:
Suite à de nombreux refus de poste
- Page 466 and 467:
A plus forte raison, le nombre des
- Page 468 and 469:
Il résulte des dispositions de l'a
- Page 470 and 471:
Pour réaliser chacune de ces étap
- Page 472 and 473:
Il existe plusieurs solutions de tr
- Page 474 and 475:
* Le financement qui peut provenir
- Page 476 and 477:
sociales ou de qualification rendan
- Page 478 and 479:
apport avec les résultats. Les sal
- Page 480 and 481:
mutuel. Les échanges sont nombreux
- Page 482 and 483:
TPE. Mais, si 2/3 des entreprises l
- Page 484 and 485:
483Fiche 4Décider Gérer Diriger A
- Page 486 and 487:
Comparaison des résultatsPrincipal
- Page 488 and 489:
Sciences politiques économiques Am
- Page 490 and 491:
Fiche 8 : SynthèseVos principalesc
- Page 492 and 493:
Nouveau projet en s'appuyant sur le
- Page 494 and 495:
Faire de même avec tous les thème
- Page 496 and 497:
Degré de conviction : fiche 7Axe d
- Page 498 and 499:
Le projetLa définition de votre pr
- Page 500 and 501:
S'INFORMER sur les composantes du m
- Page 502 and 503:
L'argumentaire est actualisable en
- Page 504 and 505:
Avec votre carnet d'adresse, constr
- Page 506 and 507:
Fiche 15 : Passer une annonceUtilis
- Page 508 and 509:
Fiche 23 : Entreprendre une formati
- Page 510 and 511:
Sur le plan budgétaire, la répart
- Page 512 and 513:
est évidement long et difficile. A
- Page 514 and 515:
3° Les instruments de suivi des pl
- Page 516 and 517:
l'intervention de l'État. Résulta
- Page 518 and 519:
été amenées à mettre en oeuvre.
- Page 520 and 521:
constatés en 1994 et 1995 ont nota
- Page 522 and 523:
Les dispositions législatives et r
- Page 524 and 525:
La contribution DELALANDE échappe
- Page 526 and 527:
entreprises aux préretraites avait
- Page 528 and 529:
Depuis le milieu des années 1970,
- Page 530 and 531:
L’effet de restriction des embauc
- Page 532 and 533:
(après au moins trois mois de chô
- Page 534 and 535:
la mesure où le choix des fenêtre
- Page 536 and 537:
travailleurs les plus âgés sont s
- Page 538 and 539:
dispositif. Pour les femmes, on ne
- Page 540 and 541:
orientés vers des mesures de trait
- Page 542 and 543:
une frontière entre la gestion pr
- Page 544 and 545:
partie d'un groupe, les possibilit
- Page 546 and 547:
de fond qui avaient débouté les d
- Page 548 and 549:
Cette disposition, inscrite dès l'
- Page 550 and 551:
convention du 19 octobre viseront s
- Page 552 and 553:
l'autorité du ministre, est le seu
- Page 554 and 555:
nuancer fortement ce constat et de
- Page 556 and 557:
violence est aussi la conséquence
- Page 558 and 559:
ce que je vais faire. J'avais l'imp
- Page 560 and 561:
contacts pris, le suivi de la prosp
- Page 562 and 563:
Psychologiquement pour éviter :- b
- Page 564 and 565:
31.12.1997 sont suivis jusqu'au 30.
- Page 566 and 567:
La définition des conditions de d
- Page 568 and 569:
salariés tant dans leur dynamisme
- Page 570 and 571:
- aux salariés dont la durée du t
- Page 572 and 573:
La faisabilité technique :- Le sav
- Page 574 and 575:
Le transfert de la production de l
- Page 576 and 577:
conversion, certains cas particulie
- Page 578 and 579:
L’entreprise X a déposé auprès
- Page 580 and 581:
des entretiens, sa candidature ne r
- Page 582 and 583:
AVES J Ouvrier BEP/CAP M +50 Couple
- Page 584 and 585:
PANO Ouvrier Sans M + 50 Couple EMT
- Page 586 and 587:
76 33 LEGAUCHE ETAM Bac + F 30-49 A
- Page 588 and 589:
120 63 SIDO Ouvrier BEP/CAP M - 30
- Page 590 and 591:
133 73 VAN ETAM M 30-49 Couple CDI1
- Page 592 and 593:
Les procédures de restructuration
- Page 594 and 595:
les protège autant des autres que
- Page 596 and 597:
Les politiques de développement de
- Page 598 and 599:
) Des raisons structurelles liées
- Page 600 and 601:
ou telle opération de réalisation
- Page 602 and 603:
- telle division n'est plus profita
- Page 604 and 605:
DELMAS-MARTY, M., FRONZA, E., LAMBE
- Page 606 and 607:
RIVERO, J. et SAVATIER, J. Droit du
- Page 608 and 609:
BONNAZ H., COURTOT N. et NIVAT D.,
- Page 610 and 611:
OSTERMAN, P., Systemes d’emploi a
- Page 612 and 613:
MEYERSON, I, thèse Les Fonctions p
- Page 614 and 615:
(Unicomi) (1973-1975).Sa riche exp
- Page 616 and 617:
donnée comme légale au coup d'Ét
- Page 618 and 619:
suppression du régime féodal» pa
- Page 620 and 621:
Peugeot, et Jean DROMER, ancien PDG
- Page 622 and 623:
même année. Il signe la Loi du 3
- Page 624 and 625:
1949 il entre au cabinet de Christi
- Page 626 and 627:
différence profonde qui désormais
- Page 628 and 629:
prépare l’insurrection du 12 mai
- Page 630 and 631:
collaborationniste Jacques DORIOT l
- Page 632 and 633:
BRAUDEL, Fernand (1902- 1985), agr
- Page 634 and 635:
dégrade : chômage en hausse, effo
- Page 636 and 637:
CHIRAC Jacques, fils d'un administr
- Page 638 and 639:
de ramener la stabilité en Somalie
- Page 640 and 641:
par CLOWER dans 1967 comme expressi
- Page 642 and 643:
gauche aux élections régionales d
- Page 644 and 645:
ce titre, il est l'un des initiateu
- Page 646 and 647:
des membres du POB qui était favor
- Page 648 and 649:
prolétariat font partie. Aussi le
- Page 650 and 651:
démarcation entre la théorie marx
- Page 652 and 653:
gauche plurielle aux législatives
- Page 654 and 655:
SCHOPENHAUER. FICHTE conquit vite l
- Page 656 and 657:
véridique et attrayante». Telle e
- Page 658 and 659:
de plusieurs mois pour la baisse de
- Page 660 and 661:
majeur dans la construction europé
- Page 662 and 663:
nationale d'administration. De 1974
- Page 664 and 665:
plus que l’émanation d’une mê
- Page 666 and 667:
lourde. L'Algérie s'est lancée da
- Page 668 and 669:
1965. Il militera d'ailleurs à l'U
- Page 670 and 671:
même sujet sur TF1. Son interventi
- Page 672 and 673:
preuve le président des États-Uni
- Page 674 and 675:
prépare l’intégration de la th
- Page 676 and 677:
de diminuer les charges de l'Etat-P
- Page 678 and 679:
démographique du bas Moyen Âge fa
- Page 680 and 681:
RENAULT, qui espérait faire de Fra
- Page 682 and 683:
l’un des plus grands présidents
- Page 684 and 685:
domicile est perquisitionné par la
- Page 686 and 687:
classes ne révèlent pas (et ne r
- Page 688 and 689:
MEGRET, Bruno (1949- ) est un homme
- Page 690 and 691:
Battu à l'élection présidentiell
- Page 692 and 693:
MITTERAND, François (1916 - 1996)
- Page 694 and 695:
d’État chargé du Conseil de l'E
- Page 696 and 697:
des enfants. La nécessité d’un
- Page 698 and 699:
«crétinisante» de la presse du P
- Page 700 and 701:
provoqué par cette vision pallie l
- Page 702 and 703:
caractère agissant, car elles sont
- Page 704 and 705:
fascistes. Au début de 1923, il n
- Page 706 and 707:
PHILLIPS Alban William, 1914-1975 e
- Page 708 and 709:
PIGOU Arthur Cecil (1877-1959) éta
- Page 710 and 711:
REYNAUD, Paul né le 15 octobre 187
- Page 712 and 713:
des communistes à son égard ne co
- Page 714 and 715:
ROOSEVELT Franklin Delano (1882-194
- Page 716 and 717:
même. En évolution son libéralis
- Page 718 and 719:
entre les faits et l’opinion (Le
- Page 720 and 721:
et démocratie lui vaut une réputa
- Page 722 and 723:
accusé de libéralisme, sur Jacque
- Page 724 and 725:
autres l’économie politique et p
- Page 726 and 727:
atteindre les analyses de son coll
- Page 728 and 729:
en Europe. Christian STOFFAËS est
- Page 730 and 731:
source de pertes immenses. Il pense
- Page 732 and 733:
MALLARME, Paul VALERY privilégia t
- Page 734 and 735:
Augustin COURNOT, un condisciple de
- Page 736 and 737:
CNPF : Conseil National du Patronat
- Page 738:
TRILD : Temps Réduit Indemnisé de